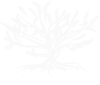Claude 🎓 - Les Américains
Depuis quelques jours, le village s’agitait, bouillonnait d’impatience. Plus encore, il était en pleine effervescence : Les Américains arrivaient !
Les Américains arrivaient, cela était certain. La B.B.C. l’annonçait à chaque émission, les gens bien informés le savaient, ceux qui ne savaient pas le sentaient dans l’air. Le bétail et la volaille "démangeaient" affirmaient les fermiers pour qui, certains signes ne manquent pas. Il faut dire aussi qu’on entendait de sourds grondements dans le nord et que de très nombreux avions alliés, en rase-mottes, fouillaient toutes les routes, les bois, les gués, comme chiens de chasse un jour d’ouverture.
Le gibier n’avait pas attendu pour déguerpir, laissant Fritzou en rade, Fritzou qui se terrait prudemment. Les villageois, quant à eux, n’attendaient que l’arrivée des Américains pour pavoiser et les accueillir à coups de piquettes et de fleurs. Ainsi bardés, attirail et galonnés fussent-ils, nos maquisards ne pouvaient prétendre à l’accueil que nous réservions pour les G.I.
Les maquisards, qui avaient d’abord établi leur Poste de Commandement dans la remise du corbillard, l’avaient bientôt transféré au bistrot, le "Café de la Libération". Là, au Quartier Général, s’élaborait les audacieuses stratégies et se débattaient les grands concepts universels auxquels Nodier, le postier, prêtait son vigoureux concours truffé de Marx et de Lénine. Lénine, à la rigueur, on connaissait un peu.
Nodier jouissait d’un statut spécial en cette heure décisive car, de son bureau de poste il restait en contact avec la centrale de Poitiers qui lui communiquait les dernières enivrantes nouvelles. Mais le pauvre était rongé par la joie et l’exaltation générale d’une part, et le dépit de n’être point libéré par les fils de Saint Joseph d’autre part. La percée américaine, il l’avait apprise par un collègue qui lui-même venait d’en être informé par un relais qui tenait ces renseignements de sources sûres…Nodier s’était précipité en face, chez Guérin et, immédiatement, le village avait pris feu ! Quelle exubérance ! Quelle agitation !
Eh, le gars Nodier…Vous savez, mère unetelle, quoi qu’il dit ? les Américains y v’nant pour sûr ! (Le lavoir aussi bouillonnait)
Le mécanicien en commanda un autre verre de blanc et on vit Porteau qui gesticulait en bas de la côte pour attirer l’attention du curé.
- Oh ! Monsieur le Curé ! Monsieur le Curé ! Les Américains arrivent !
Et pour un peu, le curé serait descendu au pont pour voir… mais il avait écouté la B.B.C. et savait déjà. Savait aussi qu’il n’y avait pas besoin de tant s’agiter car "Ils" étaient encore loin.
- Merci, Porteau ! Merci, il ne faut pas trop remuer !…On ne sait jamais !…
Mais Porteau était déjà sur le chemin de la victoire, en arrivant chez Guérin, commanda un verre, " Non ! Une bouteille de ton meilleur !"
A la B.B.C. les villageois préféraient les "dernières de Nodier" :
«Ils arrivent !» L’écho avait transporté l’onde de joie de pas-de-porte à pas-de-porte, sauté les murettes, balayé le lavoir, couru à travers le champ de foire et atteint les deux bouts du village en un rien de temps…Ils avaient été aperçus de l’autre côté de Tours…Ils approchaient de Chatellerault…Ils soufflaient devant Poitiers…Ils avaient lâché une, deux, trois Divisions de parachutistes dans le bocage… Pour un peu, on s’attendait à les voir déboucher en rangs serrés dans l’Allée des Écrevisses !
Nodier jouissait donc d’une attention universelle. Il distribuait l’espoir par bribes qu’il jugeait bon de sélectionner selon la ligne que le Parti eut certainement prise et dont il devenait le garant isolé, héroïque, fidèle. Pour rassurer son esprit un peu désemparé par l’évidence américaine dans toute sa gloire capitaliste et par les mots d’ordre que le Parti lui avait vissés dans la cervelle lors de son apprentissage au Réseau, il prenait tout son temps pour divulguer les secrets dont les P.T.T. le faisaient détenteur. Il les prodiguait gravement au compte-gouttes. Mais Nodier était mortifié.
Il devait l’être plus encore lorsque nos maquisards, qui rongeaient leur frein, se décidèrent à faire un grand coup et coupèrent la ligne de téléphone : Nodier fut alors obligé, comme tout le monde, de se mettre à l’écoute de la B.B.C. pour se tenir au courant. Non seulement se rafraîchir à une source capitaliste mais aussi ne plus être le centre de l’attention et de la considération générale ! Mortifié ! Plus de courrier depuis des semaines et, maintenant, plus de téléphone ! Le malheureux se morfondait, les camarades ne manquaient de rire au Café de la Libération.
Et alors, Joseph t’a pas parlé aujourd’hui ?
Qu’est-ce que tu vas faire de ton drapeau rouge, Nodier ?
Le Camarade Maréchal t’a rien dit ?
Ils le blaguaient, le houspillaient bien que plusieurs Coulignalais souscrivaient à ses idées gauchistes.
Tas d’andouilles ! se fâchait Nodier en haussant les épaules. Ce sont vos Amerloques qui vont gagner la guerre ?
Brouhaha et rires redoublés …
Ah, Nodier, tu vas pas recommencer ! Tu préfères les Mongols ? lui lança un retraité.
Les Mongols, les Mongols ! C’est tout ce que vous avez à la bouche ! Et vous, c’est les indiens, les Peaux-rouges que vous voulez ?
Quelqu’un, un mec sec, tout chauve qui travaille à la Coopérative, prit la balle au vol :
Moi, les Peaux-rouges, ils vont pas me raser les tifs ! Et toute l’assemblée de s’esclaffer :
Tandis que tes Mongols…tu vas voir ta moustache !
Pandémonium général auquel se mêlaient les cliquettements des verres et des armes, le crissement d’une bouteille d’eau minérale sous pression. Pandémonium parce que Nodier abordait depuis quelque temps de grosses bacchantes ainsi qu’une casquette prolétarienne de son invention.
Moi, dit Nadine en faisant la moue : J’en voudrais pas des Mongols. Qu’on dit qu’ils puent le cheval !
Gros rires et exclamations.
Ouais ! qu’ils puent le cheval. Tiens ! Demande à Monsieur Blanchon ; lui, il sait…
Et comment qu’il sait, Monsieur Blanchon ? Hein, dis ! Lui rétorqua un gros fermier qui empilait des bouteilles dans un panier d’osier.
L’est Maître d’école, non ! Il sait. Demande lui !
Ah, elle est bonne, celle là enchaîna Nodier, et tu préfères toi aussi les cow-boys …
Un rire courut dans l’assistance et Nadine ne saisit pas sur le moment l’allusion que celait la réplique du postier. Mais elle avait la répartie facile :
- Tu crois, gros bêta, qu’ils vont arriver sur des bourrins, les Américains ? Ils ont des tanks ! les Américains, ils ont des camions…On dit que leurs automobiles sont grandes…tiens ! plus grandes que le comptoir, ouais, c’te comptoir-là ! et elle relevait le menton, pleine de défi et de sûreté.
Guérin qui rigolait déjà, ne put s’empêcher d’intervenir :
Et tu sais, petite, ce qu’ils ont de grand aussi…? Déclenchant l’hilarité générale. Quelques loustics se mirent même à chanter sur un ton de fausset aviné :
Nadine, Nadine, tu aimes les belles di-dines !…
Ce fut un beau tohu-bohu ! Mais Nadine n’allait pas se laisser malmener, elle contre-attaqua :
Moi, j’men fous de c’que vous dites ! leur cria-t-elle de sa voix éraillée. On verra bien qui rira le dernier ! et elle mit son visage tout près de celui d’un campagnard rougeaud qui portait un képi lavassé : - Et toi, mon gros, tu devras me payer en dollars !…
Le gros s’étranglait à faire le malin mais Nadine lui soufflait au nez :
T’en a des dollars ? t’en as, toi ? C’est moi qui chanterai : Tintin les roustins ! tu reviendras demain !
Des dollars ! des dollars ! Nodier rugissait. Manque plus que ça ! des dollars ! Exploitation !
- C’est bien ! fit Guérin en lui tapant sur l’épaule, T’as raison pour l’exploitation, mais donnes-moi tout de même trente balles !
- ça va ! ça va ! Je vais t’le payer ton blanc !
- Non, pas mon blanc, ton blanc ! Tu préférais du rouge ? Allez, Monsieur Trotzky, donnes-moi trente roubles. Nodier laissa tomber des pièces sur le comptoir, sortit visiblement ulcéré. Le peuple ! Le peuple ignorant se disait-il. Comment faire la révolution avec de telles têtes de buis !
Les barbares poursuivaient gaillardement leur badinage :
- Eh, Nadine ! Reste ici ! Dis-nous…C’est-y vrai que t’as redécoré ta chambre ? lui jeta un homme accoudé au comptoir.
La réponse de Nadine fut fulgurante : - Eh, tu ne sais pas ? Où t’avais donc les yeux, l’autre soir ?
Un autre la pelota au passage.
- Bas les pattes ! T’as entendu : en dollars !
Nadine n’était pas bégueule. Elle s’assit sur un coin de la table, étala et brossa sa jupe légèrement, puis mignardement…
- Ouais, je l’ai redécorée…
- Dis-nous, Nadine…t’as mis des photos… fit un solide gars en clignant de l’œil pour le grand amusement des autres présents… Dis-nous Nadine…
- ça va ! prononça calmement Guérin, ça va ! laisse tomber ! et le gars s’effaça en riant un peu pour ne pas perdre la face.
Nadine, elle, songeait. Elle songeait peut-être à ces jeunes hommes pleins de force et d’enthousiasme qui viendraient bientôt de l’autre continent. Les dollars ? Cela lui était bien égal. Elle en avait assez de ce petit village où elle vivotait depuis deux ans bientôt. Retourner à Nantes ? Cette perspective ne l’enchantait pas d’avantage. Elle se sentait prête aux grandes choses. Quoi exactement ? Elle ne savait pas mais elle sentait confusément que les temps allaient changer pour elle aussi. Enfin ?
Porteau venait d’entrer.
Nadine, eh, Nadine ! Tu es songeuse !
Nadine sourit, rajusta sa ceinture, sauta de son coin de table, sortit par la porte de derrière pour gagner son petit logis dans la cour.
- Baille, Nadine…» fit un des maquisards et le reste de sa phrase se perdit dans la conversation générale qui menait bon train.
Nodier revint à ce moment là :
- Vous avez entendu ? Ils bombardent …
Tout le monde se pressa dehors. De vastes roulements sourds faisaient trembler la route…des explosions très lointaines…et puis le silence…
- Les Boches viennent de faire sauter les ponts de la Loire. déclara un galonné.
- Si loin ? rétorqua le boulanger qui était, lui aussi, sur son pas-de-porte. Pas possible…
- Si Très possible. Ce n’étaient pas des bombes. Une explosion de mines. L’officier s’y connaissait. Il s’était évadé d’un camp de travail à côté de Munich et, avant son évasion, avait assisté à de nombreux bombardements des usines bavaroises par les américains. «Des tapis, des tapis de bombes. Le son et les tremblements vous arrivent par vagues. Mais là, c’était seulement un seul et vaste tremblement qui ne pouvait provenir que d’une mine ou d’un train de munitions…»
Après plusieurs minutes de silence, les consommateurs rentrèrent au café, reprirent leurs discussions avec les maquisards attablés dans le fond de la salle, leurs armes posées contre la barre de cuivre devant le miroir.
- Comment qu’ils passeront la Loire, alors ? Le père Nattin, qui n’était pas trop malin, venait de lancer la question qui courait maintenant à travers toutes les têtes mais que personne n’osait formuler car, évidemment, si les ponts étaient coupés…
Le Capitaine maquisard rassura l’assemblée avec une autorité calme et précisa :
- Les américains sont bien équipés. Ils avancent avec des ponts portatifs pour les petits cours d’eau comme la Soule ou la Seine. Vous verrez : Il ne leur faudra pas très longtemps pour passer. Et puis beaucoup de leurs camions et même de leurs tanks sont amphibies…
C’est quoi ça, amphi…? C’était Nattin de nouveau mais personne ne sourit…
- Cela veut dire, reprit le capitaine, des engins qui peuvent aussi bien manœuvrer sur terre que sur l’eau.
- C’est formidable ! dit Nattin, éberlué, et les gens de hocher la tête en approuvant la déclaration spontanée du vannier.
Oui, les Américains…ils étaient équipés. New York, Chicago, le " Farouest" enfin, on avait vu leurs bombardiers…par vagues qui passaient, très haut, des milliers ! Les Boches étaient foutus. Et on serait bientôt libérés.
- Mais on est libérés ! Jappa un des maquisards, un jeune qui portait un bandeau et se curait les ongles avec un poignard allemand à croix gammée prélevé sans doute au cours d’une opération.
- Ne te fâches pas ! intervint Guérin aussitôt : Il voulait dire qu’on les verrait bientôt, les américains. Forcément, ils voudront prendre La Rochelle par derrière…alors ils devront bien passer par ici. La Rochelle…On les a encerclés à La Rochelle. Sortiront plus…pris dans la souricière !
Qui parle de souricière ? fit un nouveau venu, le chef de gare adjoint, qui venait se rafraîchir et se délasser car il n’y avait plus de circulation sur la voie de chemin de fer depuis deux semaines…depuis la destruction du viaduc de Prensé.
- Tu sais quelque chose, toi ?
Non, je ne sais rien… et il entreprit d’exposer ses opinions logistiques qui ne corroboraient pas du tout avec la stratégie énoncée plus tôt par le capitaine. Pourquoi ils s’emmerderaient avec La Rochelle. Les Boches y sont coincés, comme dit le p’tit, et n’ont pas envie de sortir se faire étriller…n’ont rien à gagner.
Le capitaine admit le bon sens du raisonnement, mais exhorta l’assemblée à se méfier des réactions d’une bête sauvage aux abois…
Pendant ce temps, dans d’autres parties du village, l’animation, les rumeurs galopaient. Au lavoir, naturellement. Mais là, nulle stratégie. Les laveuses ne faisaient que répéter ce qu’elles avaient entendu au cours de leurs emplettes ou par dessus les murettes dans les jardins. Elles espéraient toutes que leurs hommes n’allaient pas trop s’échauffer la tête et attirer des malheurs.
Le Curé allait et venait, s’évertuant à calmer sa paroisse tout en préparant un accueil digne aux libérateurs. Il mettrait la sacristie à la disposition des soldats et souhaitait ardemment que son clocher, réparé avec si grand soin et amour par Julot, ne servirait pas de poste d’observation au risque d’être détruit par l’artillerie allemande. Il y avait dans la bibliothèque la "Grand Illustration" de la Grande Guerre et les photographies du Front ne manquaient jamais de clochers en ruines pour avoir justement servis d’observatoires.
Les Métanet ne se montraient guère. Janine et son bébé se tenaient constamment dans la courette, sous la tonnelle. Ils avaient cousu, eux aussi, un drapeau Français, avec la Croix de Lorraine, bien sûr.
Dédé, notre bon copain, voulait que nous nous installions sur le haut du four à chaux pour voir venir les américains. Nous avions eu toutes les peines du monde à persuader Grand-mère de nous laisser y aller. Le deuxième jour d’attente, elle céda en nous faisant promettre de nous réfugier immédiatement dans le bois s’il y avait des combats.
En fait, il ne pouvait y avoir des combats puisque tous les allemands, excepté Fritzou évidemment, s’étaient retirés au nord de la Loire depuis une grande semaine. Grand-mère craignait, non sans raison, les déserteurs Indous ou Mongols qui, paraît-il, erraient à travers la campagne et pourchassaient sans succès les Commandos maquisards.
L’autre centre névralgique du village, c’était la guinguette de la mère Heurtaud, à la sortie sur la route de Niort. Si son emplacement et ses trois tables de terrasse ne lui accordaient pas la priorité pour accueillir les américains, par contre la proximité de la Mairie, juste en face, lui donnerait sans aucun doute une valeur stratégique incontestable. Parce que, c’est bien connu, les américains occuperont la Mairie et y établiront leur Etat Major. La vieille le savait, elle qui avait servi dans les ambulances du côté de Romilly pendant la Grande Guerre. La Mairie, c’était toujours pour l’État Major et elle ne cessait de raconter comment elle avait rencontré le Maréchal Foch et le Général Pershing dont elle avait sorti les photographies pour les mettre bien en évidence dans l’unique salle de son minuscule Débit.
Un groupe s’était donc formé chez la mère Heurtaud, les mêmes discussions, les mêmes affirmations, les mêmes espoirs y voyaient le jour. Quelques maquisards s’y étaient établis…en cas ! On ne sait jamais…si des fois, les allemands de La Rochelle effectuaient une percée…
Il y avait eu un léger incident chez la mère Heurtaud, un incident qui aurait pu causer des larmes mais qui, heureusement, ne se traduisait que par quelques dégâts matériels insignifiants. Un maquisard avait laissé tomber sa mitraillette qui déchargea la moitié d’un chargeur dans le mur et le plafond ! Les lambris déchiquetés et le plâtre éclaté ainsi que le bruit des détonations avaient naturellement effrayés la vieille ainsi que les quelques clients qui se trouvaient assemblés. Personne ne fut touché ! Un vrai miracle !
Un autre incident similaire s’était produit aussi, avant celui-ci ou après, je ne me rappelle plus, chez le coiffeur. Un maquisard avait buté la crosse de son arme sur le plancher et elle s’était déchargée dans le plafond, lui rasant le visage ! Décidément, ces Sten étaient dangereuses ! Et c’était aussi pour cette raison que les maquisards préféraient une bonne Schemeisser s’ils pouvaient mettre la main dessus.
Toujours était-t-il que nous attendions les américains. Les américains qui prenaient leur temps ! Les maquisards partaient en opération tôt le matin, battaient la campagne toute la journée à la recherche de traînards et, quelques fois, tombaient sur d’autres maquisards qui, eux aussi, fouillaient dans tous les recoins. Aux abords des fermes, dans les chemins creux, à la lisière des bois, partout, ils cherchaient des traces qui leur auraient donné certains renseignements en plus des alarmes des paysans. Mais rien ! Ils ne voyaient rien ! Le soir, ils se concertaient pour établir les plans de ratissage systématiques. Le lendemain, ils se retrouvaient bredouilles. Coulignan avait vu passer l’Histoire à côté sans s’arrêter et on craignait bien, du moins parmi les combattants, de terminer cette guerre dans l’oisiveté, sans honneur. Heureusement, les américains arrivaient.
Monsieur Blanchon et sa femme ne se plaignaient pas de l’Histoire, ni le Curé, ni Grand-mère, ni un bon nombre de gens ; la très grande majorité satisfaits de ce manque de gloire. Le monument aux Morts de 14 – 18 était suffisamment glorieux ! Mais les jeunes !
- Monsieur le Curé. se lamentait la belle-fille Fauchereau dont le mari, prisonnier en Allemagne, n’avait pas donné de nouvelles depuis des mois. Monsieur le Curé, vous croyez pas qu’ils sont fous avec leurs armes ? Ils vont faire un malheur !
- Ne vous faites pas de souci, mon enfant. D’abord, il n’y a plus de combat dans la région et puis le Pierre, il reviendra. J’en suis sûr. Le Bon Dieu y veillera.
Le curé, peu rassuré lui-même, se devait bien de rassurer ses ouailles, il affichait une belle contenance d’espoir et de sérénité. Mais au fond de lui-même, il se demandait…il se posait un tas de questions que le Bon Dieu ne pouvait satisfaire. C’était dur d’être curé alors !
Le deuxième jour, après le minage des ponts ou l’explosion d’un train de munitions, se termina fort paisiblement dans l’attente allègre et enjouée de tout le village. On veilla très tard sur le pas des portes, dans les courettes. Il faisait bon, doux, on mangeait des poires en devisant tranquillement. Et puis, chacun alla se coucher.
Nous, les gosses, réveillés de très bonne heure, espérions être les premiers à saluer les américains, Dédé, Gabriel et moi étions allés nous poster au four à chaux…mais rien ! Seulement des bombardiers, toujours aussi hauts qui volaient en formation compacte vers l’Est. Même plus de chasseurs, même pas le moindre avion d’observation et, du côté de Poitiers, le silence !
On attendit toute la journée tandis que les stratèges du Café de la Libération s’éparpillaient, ceux-là chassant le loup-garou, ceux-ci accomplissant les travaux des champs et de la ferme qui, américains ou non, ne pouvaient attendre.
Nous, nous savions que les américains allaient nous donner du chewing-gum et peut-être des oranges, parce que la dernière affiche de propagande de Vichy nous mettait sur les gardes : "Les américains et les anglais distribuaient des oranges empoisonnées ! Les Juifs aussi !" Mensonges tout cela, nous en étions absolument certains.
Quant aux Juifs, nous avions un gentil camarade de classe qui avait, cousue sur son pull, une étoile jaune fut ramassé en 1943. Lui, sa famille, leurs amis, auraient été incapables de faire une telle chose. Mais c’est que les Juifs…comment vous dire…pour une raison que je ne pouvais expliquer alors, mais que je vis combien plus clairement par la suite, les Juifs n’étaient pas très aimés de nos oncle et tante. Grand-mère ne se prononçait pas. L’oncle notaire, il les détestait. Pourquoi ? Nous ne comprenions pas.
Toujours est-il que nous allions recevoir des oranges et des chewing-gums. Allons, qu’ils viennent ! Comme nous étions impatients ! Et j’avais appris par cœur les paroles de l’hymne américain sans en connaître encore l’air ! Le God Save the King, je le savais pour l’avoir entendu plusieurs fois à la B.B.C. et aussi parce que Monsieur Blanchon nous l’avait chanté une fois.
Il parlait anglais, Monsieur Blanchon. École Normale. Et, depuis plusieurs mois, il parfaisait sa connaissance en lisant et relisant ses livres de classe. Quand il traversait la cour de récréation ou quand il allait faire des courses dans le village, on pouvait le voir et surtout l’entendre marmotter quelque chose, comme un tic : il se parlait en anglais !
On savait aussi que Monsieur Blanchon écrivait un livre. Un livre sur Coulignan et les événements. Sa profession, l’ascendant qu’il avait (sa femme aussi) sur les parents d’élèves et ce livre en gestation lui attiraient beaucoup de sympathie et de respect.
Ah, bonjour Monsieur Blanchon ! Heureux de vous voir. Vous prendrez bien un verre. A la maison. Si, si ! Nous insistons ! Et madame Guérin se joignait à son mari pour aller saluer le maître d’école car ils avaient un fils en terminale et une fille en troisième année. Et puis Guérin voulait aussi poursuivre une carrière politique, se faire élire au Conseil Général ; aussi tous les appuis lui seraient précieux. Et il y avait ce livre…
Madame Blanchon aussi attirait les marques d’attention :
Comment allez-vous madame Planchon ? Une miche de quatre ? Tenez ! Il nous reste des croissants ; je vous en mets deux. lui susurrait-on en douce tandis que le marmiton s’empressait d’enrouler la miche dans du papier de soie.
Chez Santoni, le marchand de vin, l’accueil était d’autant plus chaleureux que le bonhomme se voulait écrivain, composait des poèmes et voulait les faire publier. Mais, avec les temps qui courraient, il n’avait pas réussi à trouver preneur aussi espérait-il toujours que les Blanchon, qui avaient été à l’Ecole, pourrait lui procurer ce plaisir et cette gloire. Santoni était fort loin d’être idiot mais il lui manquait le bagage…Les Blanchon le conseillaient et il s’en montrait reconnaissant. Sa femme, plus âgée, moins romantique que lui, ne lui était pas d’un grand secours littéraire mais elle se montrait excellente gérante… et psychologue de premier ordre…
- Alors, Monsieur Blanchon, dites-nous, vous qui savez, parce que ces vieux fous, chez Guérin, ils e savent rien à rien. Les américains quand c’est-y qu’ils viennent ?
Monsieur Blanchon n’en savait pas plus que les autres mais il avait entendu, par le truchement d’un conseiller qui buvait le pot chez Guérin, la remarque du jeune maquisard et l’avait trouvée très sensée.
- Madame Santini, je ne sais pas. Je ne voudrais pas…Comment dirai-je ? Je ne voudrais pas vous décevoir mais je me demande maintenant si les Américains vont descendre jusqu’ici… admettait-il avec un peu de tristesse.
-
Eh bien, moi, je vais vous le dire, Monsieur Blanchon, les américains, les…alliés, quoi ! pourquoi qu’ils viendraient à Coulignan ? Pourquoi ? Y a rien ici.
Ce jugement logique blessait un peu monsieur Blanchon qui non seulement révisait studieusement son anglais, mais qui avait aussi préparé une grande banderole :
" WELCOME TO OUR ALLIES "
Passer à côté de l’Histoire ! Il ne pouvait imaginer, monsieur Blanchon, que le sort après avoir protégé Coulignan pendant toute la guerre, devait aussi divertir le cours des événements et nous laisser en rade, comme Fritzou, oubliés comme lui !
Entre parenthèses, Fritzou ne se morfondait pas du tout. Rendu à la vie civile et occupé à pétrir la pâte dans l’arrière-fond de la boulangerie, Fritzou se la coulait douce. Il ne se souciait que de sa famille naturellement. Mais quant à témoigner de l’Histoire, c’était bien son dernier souci. Il avait assez témoigné.
Le troisième jour arriva. Dans le plus grand calme. Nos maquisards avaient transféré leur Poste de Commandement en "amont" vers Poitiers, sur la ligne de chemin de fer, dans une petite bourgade blottie au milieu d’un vallon tout couvert de bois et creusé de ravins permettant de se camoufler ou préparer une embuscade.
Mais ils n’y restèrent pas longtemps car les lieux étaient disputés par les F.T.P. moins bien armés sans doute, mais plus organisés et surtout plus affermis dans leurs convictions politiques, ce qui pouvait les rendre agressifs et dangereux. En fait, il y eut des escarmouches, du côté de Loudun, entre F.F.I. et F.T.P. aussi le Capitaine des nôtres décida-t-il de changer d’horizon une fois de plus et il porta ses troupes sur les bords du Clain.
Cela devait se passer vers le cinquième ou sixième jour après la démolition du pont (ou l’explosion d’un train de munitions), c’est à dire que nous attendions toujours les américains ! La Taverne d’Or, n’ayant plus de clients, avait fermé ses portes depuis plusieurs semaines et les Arthaud vaquaient à d’autres occupations : le jardin, les ruches et la mise en bouteilles des haricots verts.
Gabriel et moi détestions les haricots verts, non par goût, mais parce que, après les avoir récoltés, chaque soir nous devions aider Grand-mère à les trier, équeuter avant de les mettre en bouteilles ! Tout le monde, Dédé, Janine, dans chaque foyer, on mettait en bouteilles. Et en bocaux. Poires, cerises, que sais-je ! Travail bien utile et très précieux, conserves qui suppléaient aux maigres rations. Gabriel et moi nous disions que tout cela était inutile puisque les américains allaient arriver d’un moment à l’autre et nous gaver de bonnes choses.
Oui mais voilà, les Américains ne venaient toujours pas ! Du moins, ils progressaient très rapidement vers Paris et semblaient nous oublier. On avait beau patienter, brûler des cierges à l’église…Rien ! Les grondements lointains s’étaient calmés et les avions eux-mêmes se faisaient plus rares.
Pourtant, un midi ensoleillé comme il n’est pas possible, une escadrille de superbes appareils à double fuselage, comme de puissants martinets, avait survolé le village en réponse manifeste aux vœux de tous. La Comtesse de Rémusseau, qui était réapparue pour pleurer sur l’état de son château, ne se sentit plus au passage bruyant des appareils et, se précipitant au dehors, avait agité les bras avec frénésie : - Herbert ! Herbert ! Herbert, mon chéri ! La vieille bonne dut la calmer et lui faire reprendre les sens. La pauvre femme avait oublié la mort de son fils en 1940 et restait persuadée qu’il pilotait toujours un avion, n’importe quel avion, un gros bombardier, un chasseur ; du moment que ça volait, c’était Herbert ! Elle ne s’en remit jamais, du reste. Elle divaguait tout en s’affairant au nettoyage de sa triste demeure qui devait servir pour le moins au Général Eisenhower.
Et nous ? Eh bien nous étions préparés avec tous nos drapeaux prêts à placer la "Bannière étoilée" sur la droite des autres si ils arrivaient par la route de Poitiers ou par l’allée des Écrevisses, ou sur la gauche, pour le cas bien improbable d’une entrée par la route de Niort. La maison de Grand-mère était confortable, nous y avions réservée une belle chambre qui donnait sur la prairie pour un américain, un bon lit avec des draps propres, un broc d’eau fraîche, des serviettes… Enfin nous nous préparions joyeusement à accueillir la généreuse Amérique.
Une semaine se passa. Puis deux. Paris fut libérée. Dédé quitta la maison de ses parents, à leur grand chagrin, pour s’engager. Le père Fauchereau fit le tour des vignes et, en anticipation de l’événement annuel, sortit la presse. Nadine vint dire adieu et prit la route de Paris… Espérons qu’elle y fit fortune. Gaigne vint couper les peupliers dans la prairie, ce qui donna à grand-mère une petite rentrée d’argent : Elle nous acheta des souliers de cuir ! De cuir ! Semelles aussi !
Après les vendanges, ce fut la rentrée des classes. Les camarades. Quelques uns manquaient à l’appel, d’autres avaient profité de l’occasion pour faire comme Dédé et je sais que nous étions tous jaloux, envieux, vexés presque de manquer le coche ! Notre prof d’allemand était revenu mais Dieu ! si blanchi ! si amaigri ! Nous ne pouvions pas comprendre. Le proviseur, toujours aussi raide. Des copains portaient foulards de soie de parachute (en fait, du nylon) de toutes les couleurs et quelques uns des casquettes de laine U.S.Army. Comme ils en avaient de la chance ! Certains nous racontaient les combats qui avaient eu lieu autour de leur village. Pas toujours joli, mais si excitant ! A la mi-octobre, nous recevions la première lettre de nos parents, toujours en Afrique Centrale ! Joie ! Photographies de nos jeunes frères que nous ne connaissions évidemment pas. Quelles perspectives de réunions prochaines ! A quelque temps de là, l’arrivée des premiers colis de nourriture : Lait concentré, gâteaux vitaminés, sucre, cacao etc…etc…etc. C’était merveilleux !
Et puis, versions et thèmes, compositions, science, Histoire, Géo et autres cours, mais aussi, football, sorties du jeudi et du dimanche, les films nouveaux…en couleurs…Quel automne !
Oh, les Américains ? je ne crois pas qu’un seul d’entre eux se soit aventuré au sud de la Loire. En tous cas, pas à Coulignan. Pas même l’ombre d’un cow-boy.