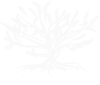Jacques Bourlaud 🩺 - Sur le chemin des écoliers
En octobre 1927, j'avais été admis à entrer en 8e, équivalent au Cours Moyen Première Année (CM1). Je n'avais pas encore tout à fait huit ans. Cela n'avait rien d'extraordinaire car, à l'époque, les règlements interdisant dans les écoles publiques d'enseigner la lecture aux enfants avant qu'ils n'aient atteint l'âge de six ans révolus n'existaient pas encore. Aussi beaucoup d'entre eux, dégrossis dans leurs familles, commençaient-il leur scolarité à quatre ans et demi ou cinq ans, connaissant parfaitement les lettres de l'alphabet et assez bien leur utilisation. De plus, au lycée de Poitiers - comme dans presque tous les autres lycées - on avait ouvert des «petites classes» où, de la 12ème à la 7ème, était dispensé l'enseignement primaire. On n'y préparait pas le Certificat d'Études mais l'entrée en 6e. Cet enseignement n'était pas gratuit aussi les élèves se recrutaient-ils dans des milieux relativement aisés (professions libérales, commerçants, fonctionnaires).

En tous cas, j'étais maintenant en 8e, dans la catégorie des «grands» ... dans la classe de Monsieur Pucelle, un personnage grand et mince dont le sourire bienveillant et la barbe blanche faisaient penser au Père Noël. J'avais cru entendre dire à des camarades nettement «plus grands» qu'il portait un drôle de nom pour un homme de cinquante ans, père de famille... Mais, après tout, n’était-ce pas le nom de Jeanne d'Arc ? Alors, pourquoi tant de chuchotements à ce sujet ? C'était vraiment sans importance...
Considérant sans doute mon ascension dans la hiérarchie écolière, ma famille décréta un beau matin que je n'avais plus besoin d'être accompagné pour effectuer quatre fois par jour le trajet reliant la maison au Lycée.
C'était peut-être pour ma mère ou mes sœurs la libération d'une astreinte. Mais, pour moi, c'était une consécration. Enfin on reconnaissait mon âge ! J'étais presque devenu un adulte... Déjà, pour l'anniversaire de mes sept ans, on m'avait expliqué que j'avais atteint l'âge de raison et que j'étais dorénavant responsable de mes paroles et de mes actes. En conséquence je ne devais plus espérer de circonstances atténuantes devant les sanctions justifiées par mon inconduite...
N'ayant pas encore «fréquenté» le catéchisme, les notions de péché étaient assez vagues pour moi. Pourtant on m'avait dressé un tableau montrant la noirceur de la désobéissance, du mensonge, de la paresse et de la gourmandise. Mais, en compensation, on m'avait accordé le port d'une paire de bretelles qui me faisait envie depuis longtemps et me faisait entrer définitivement dans le cercle des hommes... Quelques semaines plus tard ces bretelles me furent retirées à la suite d'une sombre histoire où se mêlaient justement le mensonge et la désobéissance. Dégradation infamante ! Mais restitution quelques jours après : réhabilitation eu égard à des efforts louables de bonne conduite.
Je pourrai donc fièrement aller tout seul au Lycée et en revenir.
Seulement si la Déclaration des Droits de l'Homme expose largement ceux-ci, elle demeure assez pudique au sujet des Devoirs qui en découlent. Il a donc bien fallu que la famille s'empresse de me les rappeler, ces devoirs. D'abord courir dans la rue n'était vraiment pas apprécié. Si on courait, on s'échauffait et on transpirait ; ensuite on subissait un refroidissement brutal et c'était la porte ouverte à toutes les maladies...
On me citait l'histoire de mon frère Louis qui était revenu du Lycée en courant et en transpirant si abondamment que l'on disait qu'il était «en nage». En rentrant il s'était précipité sur un grand verre d'eau froide... Résultat : une «fluxion de poitrine»... Et puis, si on court, on n'a pas le temps de faire attention à son chemin ; on peut tomber mais surtout bousculer des passants ou encore descendre du trottoir sans regarder derrière soi et se faire accrocher par une bicyclette ou une auto.
Enfin, ne pas oublier que j'habitais «rue de la Tranchée» et ne pas vouloir imiter les garnements de «la Tranchée» qui, eux, ne se gênaient pas pour courir... (Il me paraît utile d'expliquer qu'en ces temps où subsistaient encore quelques vestiges de l'esprit du XIXe siècle, les «bourgeois» qui habitaient avant la grille d'entrée latérale du parc de Blossac estimaient qu'ils étaient «rue de la Tranchée», alors que les derniers numéros de la rue où s'entassaient des familles plus modestes étaient désignés sous la dénomination de «la Tranchée». Dans les années quatre-vingts, deux de mes enfants ont loué un appartement très agréable dans «la Tranchée» ; c'était, heureusement, après la mort de leur grand-mère...). La course était tolérée sur de courtes distances pour rattraper un camarade ou si on avait peur d'être en retard. Mais cette dernière éventualité n'avait aucune raison d'être puisque l'on me laissait sortir de la maison suffisamment tôt pour ne pas avoir à me presser.
Deuxième recommandation, encore plus importante : il fallait ne pas oublier de saluer les gens que je connaissais, me montrer bien poli en soulevant mon béret et en descendant du trottoir si c'était nécessaire. Si je rencontrais quelqu'un de la famille, je devais aller l'embrasser.
Je devais donc prouver que j'étais un petit garçon bien élevé et d'ailleurs mon itinéraire était jalonné de regards inquisiteurs qui se feraient un devoir de signaler à ma famille toutes mes turpitudes...

Cet itinéraire avait été l'objet de discussions et de concertations avant d'avoir été fixé d'une façon péremptoire. En effet pour effectuer le trajet entre le 35 bis rue de la Tranchée et la porte la moins éloignée du Lycée - soit environ huit cents mètres - plusieurs possibilités se présentaient. La plus simple consistait à remonter la rue de la Tranchée jusqu'à son origine où elle se prolonge par la rue Carnot ; puis, avant d'atteindre la Place d'Armes, un changement de direction à 90° sur la droite conduisait directement à la rue du Lycée, faisant suite à la rue Saint Nicolas. Seulement c'était une voie très encombrée. La circulation dans les deux sens - qui était loin d'égaler son intensité actuelle - n'était cependant pas négligeable. Il y avait d'abord l’aller-retour du tramway sur une voie unique, d'où la nécessité d'une zone de croisement commençant juste à quelques pas de la maison entre la rue Lecesve (du nom d'un évêque «jureur») et la rue du Château d'Eau (actuellement rue Léopold Thézard, un illustre inconnu) le long du mur clôturant la cour du Doyenné Saint-Hilaire occupé à l'époque par l'École Normale des Instituteurs. L'ensemble, sur une trentaine de mètres, s'étalait sur presque toute la largeur de la chaussée. Puis il y avait tous les engins roulants possibles et imaginables : automobiles et camions bien sûr, mais aussi bicyclettes, charrettes à bras, chars à bancs des paysans se rendant au marché, voitures du laitier ou du livreur de pain dont les chevaux, connaissant parfaitement leur travail s'arrêtaient d'eux-mêmes devant la porte de chaque client, chariots des marchands de charbon ou du marchand de vin, tombereaux des éboueurs, les «ramasse-bourrier» (bourrier étant le nom poitevin pour désigner les ordures ménagères). Le tout circulait sans trop d'excès de vitesse mais comme les trottoirs étaient étroits, cela représentait malgré tout un risque pour un petit garçon étourdi et plongé dans ses rêveries. Donc itinéraire strictement interdit !
Un autre m'était recommandé, plus compliqué, pas plus long, mais plus sécurisant ; la circulation y était calme et, dans l'ensemble, les trottoirs étaient nettement plus larges.
Il fallait donc quitter la rue de la Tranchée en prenant à droite la rue du Château d'Eau jusqu'à l'entrée principale du parc de Blossac, suivre la rue de Blossac et tourner à gauche pour remonter sur une vingtaine de mètres la rue Scheurer-Kestner (du nom d'un Président du Sénat en 1870) ; puis, après un quart de tour à droite, enfiler la rue d'Alsace-Lorraine dans sa totalité. On parvenait alors à un carrefour complexe où débouchait la rue de Magenta, que bordait un petit marché couvert, actuellement remplacé par un immeuble de rapport. La rue de Magenta nous conduisait jusqu'à un croisement avec, à gauche, la rue Saint-Nicolas et, à droite, la rue du Lycée (actuellement rue Louis Renard, du nom d'un Résistant).

Je n'avais donc plus qu'à m'élancer sur le grand chemin, le cœur plein de fierté mais quelque peu soucieux de la présence de délateurs éventuels. D'ailleurs la porte de la maison était-elle à peine refermée derrière mon dos qu'il me fallait passer devant le numéro 35, appartenant à ma grand-mère et occupé par trois locataires. Au rez-de-chaussée, l'épicerie de Madame Pineau qui se faisait parfois aider par ses deux filles. J'y étais bien connu : j'étais le voisin le plus direct, le petit-fils de la propriétaire et on m'y envoyait souvent chercher du beurre ou du gruyère râpé. Et puis il y avait Madame Matignon, mariée à un ancien ouvrier de l'entreprise Bourlaud. De sa fenêtre, au second étage, elle dominait la situation et pouvait voir tout ce qui se passait dans la rue. C'était une femme aux cheveux blancs surmontés d'un chignon pointu et il lui arrivait parfois de descendre et de se tenir sur le pas de la porte pour discuter avec les uns et les autres. Lorsqu'elle me trouvait, elle ne manquait pas de me gratifier de sa conversation. La troisième locataire, Madame Brault, mariée également à un ancien ouvrier du bâtiment, ne pouvait pas m'apercevoir car son appartement n'avait pas d'ouverture sur la rue. Donc aucun risque de ce coté-là.
Un peu plus loin, il me fallait avancer avec prudence sur un trottoir étroit entre les rails du tramway et le regard de la «Quatre Oreilles» (je n'ai jamais su son nom). Elle habitait au rez-de-chaussée d'une maison très ancienne qui se trouvait en contre bas par rapport à la rue ; celle-ci, au fil des ans et même des siècles, avait atteint un niveau plus élevé. Avec son nez pointu et sa chevelure grise hérissée elle surgissait à sa fenêtre comme un diable en boite, son visage arrivant à la hauteur de la ceinture des passants adultes et du mien en raison de ma taille. De ce poste de guet, elle écoutait tout, observait tout et faisait des commentaires judicieux...
Encore quelques pas et j'arrivais à l'entrée de la rue du Château d'Eau encadrée d'un côté par un petit hôtel particulier rococo, démoli depuis une vingtaine d'années et remplacé par un immeuble de rapport, de l'autre côté par une boulangerie qui existe encore. L'hôtel particulier était la propriété de Madame de Touzalin, une personne assez grande, vêtue à la mode de la Reine d'Angleterre... et portant à longueur d'année un manteau de couleur marron-orangée lui descendant aux chevilles. Elle vivait avec son fils, un homme d'une quarantaine d'années, très «fin de race», et que l'on disait avare. Avaient-ils réellement conscience de mon existence ? Je ne saurais l'affirmer. Mais il valait mieux être prudent car Monsieur de Touzalin avait quelquefois l'occasion d'aller à la chasse avec mon père.
De l'autre côté de la rue, la boulangère, Madame Souchaud me connaissait bien. Je n'allais jamais chercher de pain dans sa boutique car un de ses employés, conduisant une voiture attelée d'un cheval, s'arrêtait chaque matin devant notre porte pour y livrer un «pain de deux» accompagné d'un morceau supplémentaire appelé «la pesée» pour compenser les irrégularités possibles du poids de la pâte mise au four. Toutefois Madame Souchaud me voyait lorsque j'accompagnais Maman ou mes sœurs venues acheter des croissants ou des galettes poitevines. Madame Souchaud vendait aussi des pochettes surprises pour deux sous... Si j'avais été plus malin, j'aurais réalisé que la devanture de la boulangerie s'ouvrait sur la rue de la Tranchée au tout début de l'itinéraire qui m'était interdit. Je n'avais par conséquent aucune raison de m'attarder devant, dans la contemplation des brioches et des pains au chocolat. Comme je filais vers la droite en prenant la rue du Château d'Eau, Madame Souchaud n'aurait pu me voir que si elle avait été dotée d'yeux pédiculés comme les escargots... Ce n'était pas le cas.
Cependant sur la distance, qui n'excédait pas cinquante mètre, entre la maison familiale et l'hôtel de Touzalin je pouvais tomber sur des gens de connaissance. D'abord ma tante Rose, la sœur de ma mère mariée à un cousin de mon père, qui habitait du même côté de la rue à quelques numéros de chez nous. Mais je ne risquais guère de la trouver qu'au retour du Lycée ou dans l'après- midi. Plus redoutable était la rencontre avec sa bonne, Angèle, qui, forte de quinze ou vingt ans de service chez les mêmes employeurs, n'aurait pas hésité de me réprimander si elle avait jugé mon attitude peu convenable. Les voisins d'en face, Monsieur et Madame Sarget, auraient, parait-il, été horrifiés devant mon maintien incongru. Mais ils passaient l'un derrière l'autre sur leur trottoir sans se tourner vers moi. Il y avait aussi Madame Perlat dont le fils était amoureux de ma sœur Madeleine, amour partagé mais qui devait finir mal. Et puis notre voisin immédiat qui habitait au 37, Monsieur de Saint-Amand ; seulement ce parfait gentilhomme, toujours très digne et très courtois, avait le malheur d'être aveugle. Il avançait à petit pas, laissant traîner sa canne blanche sur le rebord du trottoir et je m'écartais de lui le plus doucement possible.
Je m'engageais donc dans la rue du Château d'Eau sous le regard de Saint-Honoré occupé à ressemeler des chaussures devant sa fenêtre. En plus de son métier de cordonnier en chambre, Honoré occupait les fonctions de sacristain à Saint-Hilaire, notre paroisse, d'où la canonisation que lui avaient octroyée mes sœurs non sans arrière pensée gourmande. Saint-Honoré me connaissait-il ? Peut-être. En tout cas sa femme partageait avec la «Quatre Oreilles» la réputation d'être la plus mauvaise langue du quartier. Donc, de la médisance à la calomnie, dans quel abîme pouvait sombrer ma famille en raison de mon inconduite ? Un peu plus loin, il y avait Antonin Gault ; c'était un entrepreneur en menuiserie qui avait pris la succession de l'oncle Marrot et ma grand-mère avait souvent affaire à lui pour les réparations dans ses maisons. Avant huit heures il était presque toujours au milieu de la rue, gesticulant et donnant des instructions à ses ouvriers. Je le saluais et il me répondait d'un hochement de tête alors que son regard ahuri avait l'air de dire : - «J'ai déjà vu ce petit garçon... Mais où ?».
Presqu'en face se tenait le logement de Monsieur Bureau, le chef jardinier de Blossac. Il lui arrivait d'être devant sa porte avec sa casquette d'employé municipal et sa grosse moustache rousse. Il me connaissait car il donnait de temps en temps des plants de fleurs à mes parents et, régulièrement, il dirigeait son équipe pour rentrer ou sortir les orangers de ma grand-mère maternelle. Donc salut suivi d'une réponse joviale.
Poursuivant mon chemin, je passais entre le château d'eau, édifice impressionnant rappelant une forteresse médiévale et, de l'autre côté de la rue, le local abritant les pompes. Très souvent la porte était ouverte et je m'arrêtais pour regarder le jeu des pistons et des bielles étincelantes qui s'agitaient dans un cliquetis accompagné de jets de vapeur. J'imaginais alors ce que l'on pouvait voir dans les usines de la grande industrie...
Mais je n'ignorais pas que j'étais constamment sous la surveillance tendre et discrète de la mère de Maman, la grand-mère Dassys - du nom de son second mari. Elle habitait une grande maison au 23 de la rue de Blossac d'où elle bénéficiait d'un large champ de vision, non seulement sur la porte d'entrée principale du parc mais aussi sur toute la longueur de la rue du Château d'Eau. Elle ne quittait presque jamais son domicile et sa plus grande joie était de me regarder passer trois fois par jour (car avant huit heures elle n'était pas encore levée). Elle passait la plus grande partie de son temps occupée à tirer l'aiguille dans une pièce étroite attenante à la salle à manger et qui contenait des grands placards chargés de linge et de vaisselle. Elle se tenait prés de la fenêtre pour éclairer son ouvrage et voir le spectacle de la rue, assise sur un coffre de bois dissimulant le compteur du gaz. Un jour, explorant les lieux, j'ai osé entrouvrir ce coffre pour y trouver une sorte de monstre rouge bedonnant hérissé de tuyaux de plomb ; sur sa panse il y avait un cadran avec des chiffres ; le chiffre de droite changeait d'un instant à l'autre et je voyais défiler dans l'ordre : 6, 7, 8, 9, puis 0 et alors le chiffre qui se tenait immédiatement à côté prenait à son tour une valeur nouvelle... C'était très intéressant mais je ne savais pas que pendant ce temps là la bonne faisait cuire quelque chose sur le réchaud de la cuisine.
La rue de Blossac n'est pas très longue mais sa chaussée et ses trottoirs sont larges. La circulation des véhicules y est aisée, même aujourd'hui. En revanche il y avait beaucoup de piétons dont la plupart avançait d'un pas tranquille et mesuré, goûtant à l'avance le plaisir qu'ils éprouveraient sous les ombrages du parc. Je croisais ainsi Monsieur et Madame Vidard. C'étaient des amis de ma tante Yvonne - la sœur de Papa - mariée à Jules Rat ; je les saluais et ils me répondaient très gentiment. Trente ans plus tard, à l'enterrement de Tante Yvonne, Monsieur Vidard m'a rappelé le souvenir de ces rencontres.
D'autres personnes remarquables, mais que je ne connaissais pas personnellement, allaient et venaient dans cette rue. Le Docteur Delaunaye, directeur de l’École de Médecine, sortait de sa maison chaque jour habillé comme les médecins de ville à la fin du XIXe siècle : bottines noires et guêtres blanches, pantalon gris rayé, jaquette noire, cravate blanche et ganté de suède gris ; sur la tête, surmontant un lorgnon et une courte barbe grise, un magnifique chapeau haut de forme ; une canne à la main ou un parapluie roulé si le temps lui paraissait menaçant. Il a déambulé dans cet accoutrement à travers les rues de Poitiers au moins jusqu'à la guerre. Le chanoine Laguichaoua, qui remplissait de hautes fonctions à l'évêché ou au Grand Séminaire, faisait régulièrement une promenade à Blossac entre onze heures et midi. Il avançait à petit pas, les mains dans ses manches, le regard fixe et les yeux mi-clos, semblable à un chat guettant une souris. Mes sœurs l'avaient surnommé «Le Grand Inquisiteur» mais je ne savais pas trop ce que cela voulait dire. Un groupe de cinq ou six retraités passait aussi par là au début de l'après-midi quand le temps était beau. C'est pourquoi on les appelait «Les Chevaliers du Soleil». Ils avaient de grosses moustaches ou des barbes et des nez imposants. Ils portaient généralement des canotiers mais l'un d'eux avait fait teindre le sien avec du vernis noir ; il était probablement veuf... Ces messieurs discutaient entre eux et devaient se raconter des histoires croustillantes car ils étaient toujours en train de rire. J'aurais même dit de «rigoler» si ma Maman ne m'avait pas dit que ce vocable n'était pas de mise dans la bouche d'un petit garçon bien élevé... On tolérait «rigolo» mais pas « rigoler»...
La dernière maison de la rue de Blossac, faisant face à l'entrée de la rue Scheurer-Kestner, était un ancien hôtel particulier converti en boîte à bachot : la «Boîte Olivier». Mon père y avait effectué une année de philo ce qui lui avait donné l'avantage de passer quatre fois par jour sous la fenêtre de Mademoiselle Jeanne Bourdin, la plus jeune fille de Madame Dassys, qui par un heureux hasard trouvait presque toujours une raison valable d'être à son balcon à ces moments là... (Je l'ai appris cinquante ans plus tard...).
Les élèves pensionnaires de cette institution logeaient au troisième étage et parfois se livraient à des fantaisies acrobatiques en passant d'une fenêtre à l'autre, les pieds reposant sur une corniche qui tenait toute la largeur de la façade et les mains accrochées aux persiennes. C'était un spectacle très attrayant.
J'allais oublier la rencontre presque journalière avec Victorine et Alphonsine, deux vieilles filles qui habitaient le rez-de-chaussée de l'immeuble faisant face à celui de ma grand-mère. Elles traversaient assez souvent la rue pour faire une visite déférente à celle-ci qui les recevait, écoutant en silence avec un sourire un peu protecteur leur bavardage sur les potins du quartier. La rue de Blossac prenait donc fin après la Boîte Olivier. Elle se prolongeait par une voie plus étroite : la rue du 125e Régiment d'Infanterie où s'ouvrait la porte de la Caserne Rivaud. Mon père avait fait son service militaire dans ce régiment mais, en 1912, il avait pris un permis de conduire. Heureuse initiative car, pendant la guerre, il avait été muté dans le Train-Santé comme conducteur d'ambulance et s'en était tiré sans trop de mal alors que le 125e avait pratiquement été anéanti.
A deux pas de la caserne, dans un renfoncement, il y avait une maison sans fenêtre et dont la porte était surmontée d'une lanterne. Il m'a fallu très longtemps pour savoir ce que cela signifiait. Or, deux ans plus tard, j'ai fait ma communion solennelle en même temps que la fille de la patronne de cet estimable établissement, à Saint-Hilaire. Mais ma famille ne s’était pas trop pressée pour réserver des places assises dans la grande nef, aussi se trouva-t-elle entourée de toutes les employées de la maison qui n'auraient jamais voulu rater une aussi belle cérémonie. On m'a raconté cela quand j'étais beaucoup plus grand ! Donc interdiction formelle de passer par ce quartier douteux où j'aurais pu faire des rencontres désagréables. C'est pourquoi je devais tourner à gauche pour emprunter la rue Scheurer-Kestner.
En remontant cette rue, il m'arrivait parfois de trouver Madame Rat, la mère de mon oncle. C'était une dame petite qui, à plus de quatre-vingts ans, portait toujours une perruque blonde. Lorsque nous allions chez elle, nous avions droit à de très bons chocolats.
Faisant face à l'entrée de la rue d'Alsace-Lorraine se dressait un grand hôtel qui abritait les bureaux de la Maison de l'Agriculture. La fille de Tante Rose, Jeanne, dont le mari travaillait dans cet organisme, bénéficiait d'un appartement de fonction au deuxième étage. De ce fait, elle avait une vue plongeante sur les deux rues. Je ne pense pas que Jeanne se soit tenue en permanence à ce poste de vigie du haut de son balcon, mais un jour, elle a eu l'occasion de me voir me bagarrer plus ou moins avec un camarade. Cela l'a plutôt amusé et elle a raconté cette histoire plaisante à ma sœur Germaine. Donc, méfiance !
Dès les premières maisons de la rue d'Alsace-Lorraine, je devais passer sous les fenêtres de ma tante Yvonne. Cette chère femme, qui était la bonté personnifiée, effectuait presque toujours ses occupations dans une pièce ouverte derrière la maison sur le jardin. Elle ne pouvait me voir qu'en se tenant dans son salon dont la fenêtre «donnait» sur la rue. Elle ne s'y trouvait que pour recevoir des visites et ses devoirs de maîtresse de maison l'empêchaient alors de jeter un coup d'œil sur les incartades de son neveu lorsqu'il passait sur le trottoir. Mais le matin, devant sa porte, je voyais souvent la Mère Louise qui avait été, parait-il, la nourrice de mon oncle. Elle s'activait à astiquer avec énergie la plaque de cuivre. J'allais l'embrasser mais son menton était piquant....
Plus inquiétante était la rencontre avec l'oncle Jules. Celui-ci, chirurgien dentiste, avait le don, utilisant son regard professionnel, de découvrir la dent de lait oscillante dans son alvéole... - «Tiens ! Qu'est ce que tu as là ?» et comme dans un tour de prestidigitation, la dent se retrouvait dans le creux de sa main.... Il me donnait alors une petite boite rouge en carton avec un couvercle blanc où on lisait en lettres d'or son nom et son adresse. Le soir, la boite était placée sous l'oreiller et, dans la nuit, la Sainte Vierge y déposait cinquante centimes. La Sainte Vierge n'a jamais failli à cette tâche !
En poursuivant mon chemin, j'arrivais à la hauteur de l'entrepôt de Monsieur Bourdilleau, le marchand de vin. Monsieur Bourdilleau avait trois enfants : une fille qui avait été en classe avec une de mes sœurs et qui aidait ses parents dans leur comptabilité, un fils qui avait été au Lycée avec mon cousin Pierre Rat mais s'était arrêté en 3e pour prendre les rênes du chariot avec quoi il allait distribuer les barriques de vin dans tout le quartier et un second fils qui avait au moins trois ans de plus que moi. Si j'étais souvent « dans la lune», lui, il planait beaucoup plus haut. Son frère n'était pas une lumière mais lui, il était nettement simple d'esprit. Grand et dégingandé, il avançait en balançant les bras, un sourire béat et figé sur les lèvres. Comme je ne me moquais pas trop de lui, il m'avait pris en amitié et m'accompagnait volontiers pour aller au Lycée où il a traîné de classe en classe jusqu'au jour où, ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire, on a conseillé à ses parents de l'installer à côté de son frère sur le chariot de livraison.
Dans les mêmes parages, je devais saluer Madame Rambaud. Pourquoi ? Parce que, assez souvent, en compagnie de mes sœurs et de Lucienne Rat notre cousine, nous nous trouvions sur le chemin de cette dame ; Lucienne qui la connaissait bien ne manquait jamais de lui dire bonjour et j'en ai fait autant. Madame Rambaud était par ailleurs la grand-mère de mon camarade Jacques Beauchant. Celui ci avait bien un an de plus que moi et était dans la classe au dessus, la 7e. Grand et fort pour son âge, il avait tendance à abuser de la situation pour chercher à imposer son autorité tyrannique sur ceux qui étaient plus petits que lui. Il s'approchait de moi par derrière sans bruit et, profitant de ma distraction, faisait basculer ma serviette ou encore, s'emparant de mon béret, le transformait en ballon de football. Je ne l'aimais pas beaucoup mais je n'étais pas sa seule victime ; nous étions au moins trois à nous tenir sur nos gardes quand il se présentait. C'est pourquoi, un jour, nous avons fait alliance avec un certain Cortet, plus âgé que nous, gros et grand, qui usait ses fonds de culotte sur les bancs du Lycée et, comme Jacques Beauchant s'avançait vers nous, Cortet est sorti d'une encoignure de porte se dirigeant lentement vers lui tout en exhibant la dureté de ses biceps. Jacques Beauchant a fait demi-tour et a effectué une retraite peu honorable. Il a bien fallu deux ou trois ans pour que mes relations avec lui deviennent normales et même cordiales. Comme il avait redoublé une classe, nous avons fait ensemble toute notre scolarité jusqu'aux études de médecine à l'École de Santé Navale.
Rue de Magenta je rencontrais rarement la Cousine Eulalie qui habitait pourtant les environs. Mais, en revanche, debout devant l'entrée de son magasin, je voyais presque toujours Madame Bourrinet, la marchande de chaussures qui connaissait très exactement les pointures de toute la famille. Donc, salutations.
A partir de cet endroit, j'avais la chance - si l'on peut dire - de croiser des personnalités marquantes du Lycée. Monsieur Chauvin, le Proviseur, passait souvent par là l'après-midi ; avec sa barbiche grise, pointue et frisée, la canne à la main, il allait tranquillement faire un petit tour à Blossac ou, plus prosaïquement se faire soigner les dents chez mon oncle. Je soulevais mon béret et descendais du trottoir, persuadé qu'il me reconnaissait parmi les quatre ou cinq cents élèves dont il avait la charge. Mais ne venait-t-il pas régulièrement dans les petites classes écouter la lecture des résultats des dernières compositions et distribuer des images aux plus méritants ?
Il y avait aussi parfois le Censeur, Monsieur Garaud avec ses cheveux roux. Je crois maintenant que c'était le père de Marie-France Garaud, bien connue dans les milieux politiques.
Le Surveillant Général, Monsieur Amboise, me connaissait très bien car ses filles étaient très amies avec mes sœurs. C'était un homme grand dont l'aspect bourru et la grosse voix cachaient un cœur d'or que mes camarades pensionnaires avaient vite fait de découvrir. Ils appréciaient en lui le personnage «réglo» mais juste. Ce triumvirat était gratifié de surnoms. Mon cousin Pierre Rat, de sept ans plus âgé que moi, n'avait pas manqué de m'initier à ce sujet. Le Proviseur était appelé «Le Patron». Le Surveillant Général, «Le Pote», sans doute en raison de son prénom, Jules, qui dans l'imagination populaire désignait un ustensile ménager à usage très précis. Quant au Censeur, c'était «Le Zinc». Pourquoi ? Je ne l'ai appris que beaucoup plus tard : le professeur qui nous enseignait les lettres classiques en Première avait été pensionnaire au Lycée pendant la guerre 1914-1918 et le Censeur de cette époque avait fait remplacer les vitres brisées dans une salle d'étude par des plaques en zinc. Les élèves avaient exprimé leurs doutes sur la transparence de ces matériaux et attribué au Censeur le sobriquet de «Zinc» qui a été fidèlement transmis à tous ses successeurs pendant au moins vingt ans. Une belle chose que les traditions...
Nous croisions aussi quelques pions plus ou moins jeunes. Fallait-il ou non les saluer ? Grave problème car dans les petites classes nous n'avions presque jamais à faire à eux. Cependant deux d'entre eux nous impressionnaient. L'un, grand et raide avait l'allure d'un adjudant ; il parlait peu et son verbe était autoritaire. Il était appelé «Pète-Sec». L'autre avait le visage enfoui sous une grande barbe noire. C'était une chose assez rare à l'époque chez des hommes de vingt-cinq ou trente ans. Cela lui donnait un air effrayant, aussi, pour conjurer le mauvais sort, l'appelait-on «Barbe à Poux».
Pour atteindre le Lycée, on pouvait traverser en diagonale le square de la République en se glissant entre le monument aux Morts de la guerre de 1870 et le bassin aux poissons rouges, aujourd'hui comblé.
Mais on préférait, si on avait le temps, le contourner en suivant le trottoir de Madame Bourrinet et on avait alors l'avantage d'une station contemplative devant la vitrine du Bazar de l'Hôtel de Ville, le principal magasin de jouets de Poitiers. C'était beau et cela faisait rêver. Comme j'avais commencé à rassembler une collection de petits animaux en celluloïd, il m'arrivait d'ouvrir la porte et de m'avancer timidement pour m'enquêter sur les prix de vente, espérant toujours, qu'avec mon anniversaire, ma fête, les étrennes et quelques bonnes notes habilement présentées à mes grand-mères, je pourrais réunir la somme nécessaire à quelques achats.
La petite porte du Lycée était située à quelques pas de la sortie du square. Ouverte en permanence, elle donnait accès en descendant cinq ou six marches à la Cour d'Honneur. Celle-ci était bordée sur deux côtés par des bâtiments âgés d'au moins trois cents ans car le Lycée avait été installé à la place du collège Sainte-Marthe, créé par les jésuites aux environs de l'an 1600. Sur la gauche, le mur de la chapelle présentait des fenêtres haut placées munies de vitraux incolores. Il y avait une porte qui était parfois ouverte, nous permettant de risquer un œil pour regarder l'autel tarabiscoté du plus pur style baroque et qui faisait notre admiration. C'est en effet une œuvre d'une réelle beauté même si on n'apprécie pas particulièrement ce genre trop pompeux.
Devant nos regards, en entrant dans la cour, se dressait une façade austère d'où se détachait une avancée de quelques mètres délimitant un édifice à la base duquel s'ouvrait un porche et qui formait une sorte de tour carrée et massive coiffée d'un toit d'ardoise à quatre pans incurvés et surmonté d'un petit clocheton.
Au dessus du porche on voyait un buste d’Henri IV, «fondateur», et plus haut un médaillon sculpté représentant le profil de Louis XIV, «bienfaiteur». Ce porche donnait accès à un hall d'où partait un couloir sombre en direction de la chapelle et qui allait se perdre dans les profondeurs mystérieuses du Lycée. Deux portes s'ouvraient sur ce hall dont celle des classes réservées à nous, les «grands», c'est-à-dire la 8e et la 7e. Les autres classes primaires, celles des «petits» avaient un accès direct sur la Cour d'Honneur. Celle-ci était ornée de deux ou trois massifs entretenus par le jardinier «Philo». La rumeur prétendait qu'il avait raconté à un visiteur qu'il était élève de «Philophie». Cet âge est sans pitié... Quatre rangées de tilleuls bien taillés abritaient l'espace où, pendant les récréations, nous essayions de jouer au football avec une balle de tennis. Enfin dans un coin, des buissons et des grands arbres masquaient les installations sanitaires soigneusement entretenues par Alexandrine qui, au cours de ses longues années de service a déculotté et reculotté une quantité de petits Poitevins dont certains ont acquis par la suite une certaine notoriété. Beaucoup de gens circulaient dans cette cour. Les professeurs bénéficiaient d'une salle spécialement aménagée pour eux.
Bien sûr nous n'osions pas y pénétrer d'autant plus qu'il y avait là un grand registre où ces messieurs inscrivaient les motifs des punitions et le nom des coupables... Le concierge, Monsieur Barrois, avec sa jambe de bois, un gros cahier sous le bras, s'apprêtait à aller de classe en classe pour récolter les noms des élèves absents. Parfois apparaissait l'aumônier qui venait discuter avec les uns et les autres.
Et puis surgissaient les groupes plus ou moins animés des élèves des classes préparatoires aux Grandes Écoles. Certains portaient le calot noir des «Taupins», d'autres le calot bleu ciel et rouge des «Cornichons». Ceux qui avaient acquis la première partie du bachot avaient eux aussi le privilège d'entrer au Lycée par la Cour d'Honneur. Tous les autres élèves devaient utiliser une grande porte ouverte un peu plus bas sur la rue et, là, sous les ordres de «Pète-Sec», ils se mettaient en rang par deux pour rejoindre leurs salles de classe respectives.
Deux fois par semaine, on voyait deux Petites Sœurs des Pauvres traverser la cour. Enfouies sous leurs capes noires, elles portaient chacune deux grands seaux cylindriques en fer blanc fermés par des couvercles. Elles venaient des cuisines où elles avaient récolté les restes des repas. Cela nous intriguait un peu et, l'année suivante, Mademoiselle Texte, l'institutrice que nous avions en 7e, avait déclaré aux pensionnaires de la classe : «Les vieux mangent vos restes et les Sœurs mangent les restes des vieux...». Cela nous avait beaucoup impressionné. Mais, à la réflexion, ce raccourci émouvant n'était peut-être pas tout à fait exact car il est probable que les vieux donnaient plutôt les restes aux cochons qu'ils élevaient. Nous ne soupçonnions pas encore l'existence de cette étape intermédiaire dans le cycle alimentaire des Petites Sœurs des Pauvres. À huit heures précises, un roulement de tambour qui paraissait sortir des entrailles du Lycée, nous indiquait qu'il était temps de nous rassembler pour entrer dans la classe.
L'année suivante, j'ai été autorisé à emprunter, si je voulais, l'autre itinéraire. Je grandissais...
Kerstran-en-Brech 24/11/96