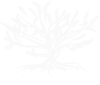Claude 🎓 - Charlu
Charlu, le fils du maréchal-ferrant, était un gros et grand garçon de notre âge dont nous envions tous la force. Mais ses cheveux prématurément blancs et sa peau laiteuse lui donnaient l'air d'un gnome sorti tout droit de Victor Hugo, une sorte de Han d'Islande ou Quasimodo et son éternel foulard sentait la corne brûlée. Par ailleurs, il était un peu retardé et bégayait.
Charlu venait avec nous à l'école. Chaque matin, il nous attendait, tapi dans la pénombre du couloir de sa demeure, une maison basse de pierres grises accolée à la forge où son père ferrait les chevaux et réparait les roues de charrettes. Comme nous passions à sa hauteur, le voilà qui jaillissait soudain et accourait à grandes enjambées tout en agitant ses longs bras comme un épouvantail ballotté par la bourrasque, et, tandis qu'il luttait désespérément avec nos noms et "b...b...bo...bon...j...jj...jour", nous le chargions comme un bourricot de nos cartables et bidons : plus il croulait sous la charge et plus il semblait heureux. Charlu riait alors, retroussant ses babines, un sourire niais et béat. Puis, courbé sous ses responsabilités, il nous emboîtait gaiement la pas.
Peu après, nous quittions la Grande Rue pour nous engager dans un chemin creux bordé de ronces qui nous menait, en fin de promenade, derrière le préau de l'école. Oh, ce n'était pas vraiment un raccourci, mais une dernière ivresse de liberté avant la journée de leçons et de devoirs. Les geais et les pies, les merles, les moineaux qui s'ébrouaient dans la poussière, compagnons de nos rires, s'envolaient à notre approche.
Car nous menions grand tapage et le chahut nous précédait. Nous ne nous lassions jamais de taquiner Charlu, de lui jouer des tours plus ou moins gentils mais sans être, pourtant, trop méchants. Et lui, centre de l'hilarité générale, jouissait en gloussant de son importance. Nous lui donnions des mots à répéter à l'envers (lui qui pouvait à peine épeler son propre nom !), des mots qui lui demandaient un effort surhumain et qui nous semblaient, pour l'occasion, les plus incongrus comme "papillon" et "rutabaga" ou même "balboa" dans lesquels les P et les B avec leurs irrésistibles combinaisons ne pouvaient que faire trébucher notre camarade et déclencher nos rires.
Nous lui racontions aussi d'horribles histoires : histoires des "chauffeurs" qui grillaient la plante des pieds de leurs victimes capturées le long des chemins en tous points ressemblant à celui-ci où nous marchions ... grillaient la plante des pieds pour soutirer le secret des caches d'or ... "Non ! Non !.." s'exclamait pathétiquement Charlu qui ne pouvait soutenir l'idée même de cuir roussi et frémissait de terreur ! Nous étions cruels, c'est vrai, mais nous nous amusions bien.
Mieux encore, nous lui décrivions, en détails terrifiants à souhait, les hideuses tortures infligées par les Boxeurs, ces horribles monstres jaunes, vipères, tous couverts de poils parfumés à la bouse de dromadaires, qui attendaient peut-être au passage du ruisseau, embusqués dans les "viouches" (.). Charlu tremblait alors de façon incontrôlée et nous devions littéralement le soutenir !..
Les dromadaires, surtout, avec leur bosse et leurs sabots fourchus le jetaient dans une bégayante confusion et de l'écume lui venait aux lèvres. Une fois, il en pissa dans ses pantalons !
Et puis, pour changer, il y avait les vampires qui suçaient le sang des dormeurs ... leurs petits yeux infernaux ... leurs museaux de porcelets délirants ... et, pour bonne mesure, des griffes putrides et des plumes trempées dans le purin de pieuvres en rut ... (imagination merveilleuse de gamins !). Pauvre Charlu ! Il n'avait aucune peine à voir ces horreurs planer autour de lui par temps couvert et n'en devait pas dormir la nuit. Toutes ces descriptions lui arrachaient des cris d'épouvante, des râles ; ses traits se convulsaient par vagues et ses gros yeux globuleux roulaient au blanc.
Un instant plus tard, ranimé par notre présence enjouée, il avait tout oublié (les chauffeurs, les boxeurs, les vampires, tout !) et marchait à l'amble à nos côtés partageant l'allégresse générale !
Ce souvenir-ci me revient à l'esprit : un jour, un camarade du Hameau-sous-Tille avait apporté une petite cage grillagée dans laquelle somnolait une taupe et nous avions persuadé Charlu qu'il s'agissait-là d'un lionceau auquel il devait apprendre à rugir ... Charlu passa une bonne partie de la matinée sous le préau, à quatre pattes, s'égosillant devant la cage jusqu'au moment où Monsieur Blachon intervint et l'envoya ratisser les feuilles dans la cour de récréation.
Car Charlu était plus ou moins admis en classe, mais le plus souvent restait dehors occupé à de menus travaux qu'il comprenait cent fois mieux, évidemment, que le calcul et l'orthographe. En automne, le Maître lui donnait donc un râteau et il ratissait toute la journée en fredonnant des airs de sa composition ou bafouillant des discours à un auditoire imaginaire. De temps en temps, il interrompait son travail, prenait une pose majestueuse et, le poing fermement placé sur la hanche ou plaqué sur la poitrine, interpellait vigoureusement son râteau ou un arbre et leur débitait une série d'arguments que nous aurions eu bien du mal à comprendre, tant bafouillage et bégayage s'alliaient comme les eaux de deux Niagaras. Nous, le visage enfoui dans nos cahiers, nous murmurions "Mussolini... Mussolini ...", fiers de nos connaissances et sans pitié. Seule, la peur de la baguette contenait notre rire.
En hiver, Charlu entassait les bûches sous le préau ou les apportait dans les salles de classe, la nôtre et celle des petits. Immanquablement, Charlu ouvrait la porte d'entrée avec fracas et le Maître se précipitait lui prêter aide pour éviter une avalanche de bûches sur le plancher. Son équilibre raffermi, Charlu chargeait le poêle, se contorsionnant grotesquement, et nos rires étouffés le distrayaient si bêtement qu'il en oubliait parfois de mettre les gros gants et se brûlait le bout des doigts ou même la paume ... Cela lui arriva un jour où il saisit la grille à pleine mains. Ce fut une belle sarabande ! un ballet ! scandé par ses cris perçants et nos rires déchaînés. Monsieur Blanchon nous avait fait les gros yeux et nous étions vite redevenus calmes. Extérieurement au moins ...
Quant le temps était au beau, nous jalousions un peu Charlu ; mais par temps froid, nous l'entendions battre la semelle sous nos fenêtres.. Alors, le Maître le faisait entrer et l'installait dans un coin de la salle de classe avec un panier de châtaignes à décortiquer. Charlu décortiquait. Il décortiquait posément pendant une demi-heure et en silence, totalement absorbé par la tâche : il craquait les châtaignes, les inspectait longuement, émerveillé, semblait-il, par le prodigieux résultat de son effort, alignant soigneusement les écorces d'un côté et jetant sans égard les pulpes dans le panier.
Charlu alignait les écorces ou bien en faisait des dessins à même le plancher : des lunes, des étoiles, une maison ; des maisons partout. Mais bientôt, son attention se relâchait, il se piquait les doigts et alors geignait en suçant les petites plaies ; ce qui, à nouveau, déclenchait nos rires plus ou moins étouffés.
Monsieur Blanchon nous grondait à sa façon : il se figeait, se redressait et nous clouait de son regard plein de reproches. Nous n'osions soutenir ce silencieux éclair qui nous transperçait et nous rendait honteux.
Quand les plaintes de Charlu et ses grimaces devenaient une trop grande distraction, Monsieur Blanchon le conduisait gentiment à la porte et chargeait l'un de nous de l'accompagner à la cantine où une solide villageoise préparait la tambouille.
Cette gentillesse, cette considération que le Maître témoignait envers notre infortuné camarade, nous la comprenions vaguement, nous autres élèves de Terminale. Mais, garnements que nous étions, nous devions bien comprendre, secrètement au fond de nos cœurs, la terrible misère qui guidait notre camarade aux coins de la vie. Oui, nous le savions comme le savent les gosses des campagnes qui savent la vie par les contacts quotidiens avec la terre et les bêtes. Mais quoi ! nous nous préparions, cette année-là ou la prochaine, à l'examen du Certificat d'Etudes, nous les grands ; nous oubliions déjà les champs de patates et les vaches dans leurs étables ; nous oubliions déjà la boue sur nos galoches et ne visions que la mirifique peau d'âne. Tant pis pour les autres !
Pendant les récréations, Charlu se joignait à nous et personne ne pouvait le surpasser au jeu du camp volé. Ses longues jambes lui donnaient forcément plusieurs mètres d'avance sur les autres ; aussi, d'un commun accord, avions-nous décidé entre nous de lui imposer un handicap qu'il ne comprenait jamais, ne se rendant pas compte du tout des changements de règles qui intervenaient au cours de nos tumultueuses parties, et ses erreurs ne pouvaient que contribuer à l'excitation des joueurs. De nouveau, Charlu se retrouvait au centre, en plein milieu des controverses, heureux de son importance. Son gloussement niais manifestait son bonheur. Quasimodo ! Il était bien le personnage parfait du célèbre roman tel que nous le comprenions.
Charlu ne se rendait pas plus compte de sa force et quand il déboulait de sa base, gare !.. Il se précipitait droit devant lui, bouleversait adversaires et alliés sans discrimination et ses bras en hélice s'avéraient dangereux quand bien même tournoyés en toute innocence. Plus d'une fois, ayant transpercé le camp adverse, il continuait sa trajectoire et éparpillait une ronde de Petits ou foulait brusquement une partie de billes. Nous le rattrapions enfin et lui infligions un sermon sur son inconduite ; Charlu, hébété, écoutait sans trop comprendre, ses gros yeux vacillaient, ses lèvres tremblaient et il se mettait alors à braire comme un veau qu'on écorche ... Nous devions le consoler.
Un jour, à pleines enjambées, il percuta un des érables qui bordaient l'allée principale de l'école et, sous le choc, tout son corps pivota avant de s'affaler, faisant maintenant face au mur d'enceinte, au pied de l'arbre. Nous avons bien ri et plus encore lorsque, parvenus à lui, nous avons surpris son regard ahuri, ahuri et perplexe car il ne pouvait évidemment comprendre comment l'allée s'était ainsi esquivée si brusquement devant lui. Madame Blanchon qui s'occupait des Petits était accouru à la rescousse et avait aidé Charlu à se remettre sur ses pieds. Mais, à part une blessure superficielle au front, notre camarade ne semblait pas souffrir outre mesure et il passa le reste de sa journée, errant de-ci de-là, dans la cour avec un sourire béat en travers de son visage.
Il n'était pas méchant, Charlu, seulement simple d'esprit. Mais il faisait partie intégrante de notre enfance et nous n'aurions pas voulu l'éloigner de nous.
Pourtant, Monsieur et Madame Blanchon durent renvoyer Charlu à ses parents : le pauvre misérable gosse avait grand besoin de soins psychiatriques. Le Maître et la Maîtresse avaient fait des démarches personnelles auprès des parents, naturellement morfondus, et entrepris les premières formalités auprès de l'Institut de Rééducation de Niort. Car, en effet, Charlu montrait des traits de plus en plus bizarres et son comportement général devenait alarmant : la villageoise qui préparait les déjeuners à la cantine l'avait surpris sous le préau alors qu'il tranchait la tête de pigeonneaux tombés de leur nid avec une hachette que notre simplet avait d'abord, et précipitamment, essayé de cacher sous la pile de bois puis jetée à grande volée par dessus la murette dans le verger. Une autre fois, peu avant cet incident, un commis de la gare qui livrait un paquet l'avait vu s'enfuir frénétiquement comme un mulot effrayé sous ces mêmes bûches. Charlu, comme on dit à Coulignan, "perdait la ciboulette". Notre pauvre camarade !
Cela nous attristait tout de même un peu.
Enfin, de plus en plus souvent, il s'exhibait ou bien oubliait de fermer sa braguette, laissant pendre minablement son instrument aux yeux de tous, et se promenait ainsi jusqu'au moment où, enfin, quelqu'un l'obligeait à se remettre en ordre.
Oui, tout le monde s'accordait à dire que Charlu "dérangeait de là-haut".
Nous, les gosses, nous savions cela depuis longtemps. Depuis cette fin d'après-midi, après l'école, quand nous nous étions arrêtés dans un coin ombragé du Champ de Foire pour assister à la démonstration que Charlu nous donna de sa virilité : il se masturba magistralement devant nous autres, ployés sous les rires et qui l'exhortions à qui mieux mieux. Et Nenette n'était pas la dernière à partager notre jubilation tapageuse. Mais bientôt, les efforts de Charlu et nos vociférations provocant leur effet, notre joyeuse bande de lurons se sentit gênée, notre embarras s'accrût et, effrayés de notre audace et des râles de notre camarade, nous avions pris la fuite laissant là Charlu hagard et pantelant.
Ce printemps 1939, Charlu ne vint que de façon intermittente à l'école. Oh, il nous attendait toujours le matin sur le pas de sa porte, assis et la tête entre ses genoux, nous regardant par dessous comme une bête au zoo, et puis, d'un seul coup, il se détendait pour se ruer et courir nous expliquer à force de hoquets et télescopage de mots que son père le chargeait d'une commission ou qu'un fermier l'engageait pour la journée à garder le bétail. Une fois l'important message transmis, il virevoltait et sautillait vers chez lui comme Nijinski sur le mur de la chambre de notre tante.
Les quelques fois où Charlu avait réussi à échapper à la surveillance familiale, il arrivait à perte-haleine nous rejoindre sur le chemin de l'école. Mais là, Monsieur Blanchon le gardait auprès de lui jusqu'au moment où passait le facteur auquel il refilait le grand nigaud à charge. Une fois de plus donc Charlu se retrouvait alourdi de sacs, postaux ce coup là et ... heureux.
Eté 1939.
Comme vous le savez, ce fut un bel été qui commença plutôt bien. Le soleil souriait aux moissons et la rentrée des gerbes donnait l'occasion de balades en charrette. Et puis, soudainement, vers la fin des moissons ce fut la guerre.
La guerre et le départ soudain des mobilisés suivi, peu après, par l'arrivée massive de réfugiés mosellans, de pauvres gens dénués de tout qui avaient le malheur de partager la frontière avec l'Allemagne.
Ces vieillards avec leurs filles et leurs petits enfants furent logés dans les granges, à l'école, dans la salle paroissiale et les maisons du village, au château, enfin partout où on pouvait les caser. De suite, sous l'impulsion du maire et du curé accordés en cette extrême circonstance, tous les villageois, et les villageoises surtout, se donnèrent sans compter ou presque (car charité commence par soi-même ...), organisèrent une popote ainsi qu'une collecte suivie de distribution de vêtements selon les besoins de chacun. Grand-mère dût bien perdre plusieurs kilos, elle qui était si frêle, à courir à droite et à gauche, à monter et descendre les escaliers du grenier ! "Madame Gabriel !, lui serinait la bonne, c'est-y que vous v'lez dépérir ?.." Ce qui ne ralentissait pas pour autant l'élan de générosité ni l'affairement qui secouait la maison. La Comtesse partagea ses maigres ressources et servit la soupe en vertu d'un certain orgueil aristocratique, peut-être, qui exigeait de sa caste l'aide aux faibles et aux déshérités par temps de grande calamité comme la Peste et les Grandes Invasions. La malheureuse femme, déboussolée, déclarait à chacun les aventures glorieuses de son fils, Robert, qui tantôt pilotait un chasseur Dewoitine, tantôt commandait une escadrille de bombardiers Potez, enfin qui remplissait le ciel de France de bleu, blanc et rouge.
Elle avait un autre fils, la Comtesse, mais on n'en parlait pas. Il était recouvert d'un linceul de silence poli. Enlevé par une enchanteresse sud-américaine de réputation évidemment douteuse (comme le sont toutes les réputations de ces gens-là : gauchos et autres rastaquouères; c'est bien connu). Vous voyez ce que je veux dire. Donc, silence ! Le village n'allait pas étendre son linge sale au vu et su de tout le monde ... Ce sont des choses à nous et je ne vous en dirai pas plus.
Madame Tessin avait mis son grenier sens dessus dessous pour dénicher des nippes et aussi pour y installer deux vieux qui n'avaient que leur chemise sur le dos.
Non seulement Grand-mère avait mis à contribution temps et ressources à la cause commune, mais elle avait aussi offert la serre à toute une famille qui consistait de trois grands-parents, deux filles dont les maris servaient naturellement "quelque part sur le front" et leurs gosses, trois ou quatre me semble-t-il vaguement revoir en souvenir.
Les sapin, quant à eux, abritaient un couple âgé, même très âgé, des gens qui se déplaçaient avec grand peine et s'exprimaient encore plus péniblement en un charabia (du "frontalier") incompréhensible. Pour toutes possessions, ils chérissaient un tableau d'ancêtres enveloppé dans une couverture !
Madame Lalonde, une veuve qui devait plus tard emménager avec ses enfants sur la côte près de La Rochelle, se trouvait assortie à deux autres veuves qui, elles aussi, ne parlaient pas un seul mot de français !
La mère Raymonde, une de ces forces de la nature, crainte autant au presbytère qu'à la mairie, fut pour une fois grassement bénie du ciel : lui échoua une veuve aussi loquace qu'elle-même et qui, Dieu soit loué, parlait français.
Et ainsi de suite.
Dans les jours suivants, la moitié d'un couvent de bonnes sœurs aux cornettes grises et noires établissait ses bonnes œuvres au Château; ce qui ne pouvait déplaire à la Comtesse malgré cette diable de différence linguistique.
Mais enfin, bientôt et sans trop de heurts, voilà Coulignan qui avait doublé sa population et s'ouvrait ainsi au monde. Le Maire, nanti de pouvoirs spéciaux et surtout de fonds mis à sa disposition par le Préfet du Département, se lança avec beaucoup d'autorité dans un maelström d'activités réquisitionnant logements, achetant provisions et fournissant ustensiles et literies aux malheureux réfugiés. Jamais le Père Perrin n'avait eu autant de pouvoirs ni autant à faire; il se montra à la hauteur de la tâche.
Bien sûr, tout cela ne pouvait remporter l'adhésion générale. Oh, rien en particulier contre les Mosellans qui, après tout, n'y pouvaient mais et on comprenait bien qu'il faudrait s'accommoder de leur langue, mais le gouvernement ! "Le gouvernement de malheur qui siégeait à Paris, incompétent, pourri, taraudé de vermines (juives ...) ..." Le café Guérin résonnait d'accusations et Nodier s'y donnait à poings fermés contre les profiteurs, tandis que Moureau tonitruait des "on les aura ! Passerons pas !" ... Tout le monde s'accordant enfin : on allait administrer une bonne raclée à Hitler.
Toujours est-il qu'une chambre de la maison du forgeron fut réquisitionnée pour une jeune femme qui vint l'occuper avec son fils, un petit rouquin de sept ou huit ans aux traits rudes. Et ce mioche, querelleur, dictatorial et brusque, en vint à exercer immédiatement une domination incroyable sur Charlu. Ami ? Non, point du tout !
Charlu s'était attaché à Ivan dès le premier jour comme un chien reconnaissant d'être battu et le monstre en herbe abusait tyranniquement du pauvre crétin aux anges ! Charlu obéissait sans question aux ordres que lui jetait son bourreau. Plus encore, le grand dadais anticipait avec joie les moindres désirs farfelus ou capricieux du gosse et pour un peu lui aurait apporté le fouet s'il y en avait eu un dans la maison. Ivan allait-il faire une commission pour sa mère que Charlu lui ouvrait le chemin; Ivan rentrait-il manger son goûter que Charlu patientait à la porte. Charlu se faisait même l'interprète du gamin qui s'obstinait à parler son dialecte. Comment Charlu pouvait-il comprendre le débit hargneux de son maître ? cela, nous ne pouvions le comprendre et encore moins le croire ! Et quand le mioche trépignait de colère, eh bien, Charlu se tenait coi, à l'abri si possible, et attendait que passe l'orage.
Le plus fort, c'est que pour ne pas repousser Charlu, nous devions bien accepter la présence de l'affreux moutard, n'osant pas le rosser ou le pousser dans le ruisseau !
Affreux moutard, oui ! Il criait à pleins poumons : "Gutti-bubbi !" et Charlu se précipitait comme un jeune chiot à sa première ouverture de chasse !
Pourquoi ce surnom ridicule ? Nous n'en avions aucune idée, mais Charlu en était transporté de joie; extase ! Son rictus de chimpanzé s'élargissait en pure béatitude, quelque chose à mi-chemin entre Fernandel et la Joconde ...
Quel spectacle que ce simplet trébuchant dans le sillage du rouquin ou se précipitant en gesticulant comme un pestiféré d'antan pour lui ouvrir la route !
Plus étonnant encore ... Charlu ne bégayait plus !!! Il ne bégayait plus, aussi incroyable que cela puisse paraître, bien qu'il s'exprimât maintenant en un jargon que ni sa mère ni la mère du monstre ne comprenaient. (Nous non plus). Et durant les moments les plus calmes, Charlu semblait même presque normal !
Pendant ce temps, la vie dans le reste du pays, Ligne Maginot y compris d'ailleurs, continuait sans à-coups. A Coulignan, nous avions fait les vendanges auxquelles les réfugiés avaient prêté leur concours, ce qui ne pouvait que détendre l'atmosphère et même nouer des liens, ou, du moins, arrondir les angles comme on dit. L'Ecole Communale s'était réouverture et la popote n'ayant plus de raison d'être puisque tous les réfugiés se trouvaient plus ou moins confortablement casés, s'était repliée d'elle même après les félicitations des "autorités" et les remerciements de nos hôtes. Vie normale, somme toute.
Mais, pour la première fois, Charlu ne nous attendait plus dans la pénombre du couloir de sa maison lorsque nous nous rendions en classe.
Charlu ne devait plus nous attendre et le chemin creux soudainement parut bien vide aussi. D'un accord tacite, nous prenions dorénavant la Grande Rue sans un regard pour le Valais, à la queue leu-leu longeant les murs.
Par contre, Charlu accompagnait Ivan jusqu'à la grille de l'école des Petits une demi-heure plus tard. Chargé du cartable d'Ivan et ralentissait le pas, ce qui lui donnait un air de gnome géant ou plutôt d'escogriffe désarticulé, Charlu ouvrait la marche, ramassant d'autres cartables au passage, et arrivait enfin à la grille où les camarades d'Ivan reprenaient leur bien sans pour autant le remercier et le laissaient là en plan. Lui, il s'assurait qu'ils étaient bien entrés dans l'annexe, reniflait, ou essuyait ses grosses mains sur son velours et, pirouettant, redescendait maintenant à longues enjambées vers le lavoir avant de remonter le "Haut du Bourg" (Poitiers) vers la forge de son père.
Le père de Charlu n'avait pas été mobilisé sans doute en raison de son âge et peut-être aussi à cause des services qu'il rendait à la communauté comme forgeron-maréchal ferrant-serrurier-tonnelier-etc. A l'occasion, c'était à lui que revenait la tâche de clouer les cercueils. De temps à autre, il employait son fils à de menus travaux sans pouvoir toutefois lui céder le soufflet de forge et encore moins le grand tablier de cuir pour ferrer les chevaux car Charlu souffrait d'asthme et l'odeur de corne brûlée le mettait dans un état d'excitation extrême. Alors le forgeron lui confiait-il des commissions dans les fermes voisines, commissions qu'il accomplissait ponctuellement et avec entrain, mais aussi le plus rapidement possible afin d'être de retour à la grille de l'école au moment de la sortie.
A l'heure donc, Ivan sortait en compagnie de ses camarades mosellans et ils chargeaient Charlu de leurs sacs, cartables, manteaux de pluie si le temps s'était mis au beau durant la journée. S'il pleuvait, les gosses s'abritaient en riant sous un manteau tendu au dessus de leurs têtes et n'accordaient aucune attention à leur baudet qui cheminait de son pas de canard, et trempé. Mais heureux !
J'allais oublier ! Non seulement son bégaiement avait disparu, mais il ne bavait plus à table et sa pauvre maman reconnaissante en brûlait cierge sur cierge à l'église pour remercier le Doux Seigneur !
L'hiver 39-40 passa sans grande histoire au village. Presque le même état sur le Front. Vous vous rappelez peut-être le laconisme des bulletins officiels : "Rien à signaler". Les "belligérants", comme on disait, se gelaient les orteils dans leurs tranchées. Il n'avaient rien à faire. Ils attendaient. Attendaient quoi ? "qui qu'en savons" disaient nos villageois. Chaque semaine, notre oncle artilleur nous écrivait et ses lettres portaient toujours un message très secret qui nous donnait sa position près de Sarreguemines, cette petite bourgade frontalière si proche. Tout l'hiver, il s'acheta des chaussettes ou des caleçons au même prix ... avant de se retrouver, quelques mois plus tard, dans un camp de prisonniers quelques part à côté de Munich ...
Mais entre temps, tout allait bien; le Général Gamelin et Maurice Chevalier nous l'assuraient.
En contraste, le printemps apporta quelques changements, des dérangements même. Monsieur Hitler, qui de toute évidence ne voulait pas entendre parler d'entente à l'amiable, avait envoyé ses soldats en excursion au Danemark puis en Norvège où "nous" (Anglais et Français fraternisant comme au plus beau jours) avions dépêché escadres et troupes pour contenir les Boches et les rejeter à la mer. Toujours, selon les bulletins officiels, "nous" les étrillions de belle manière ! Moi, j'apprenais la géographie tandis que nos vétérans, le Père Fauchereau et son compère Moureau entre autres, élaboraient de grandes stratégies tout en se réjouissant de nos fortunes militaires.
Pourquoi "nous" avions dû évacuer les fjords restait un mystère inexplicable car il était clair que Monsieur Hitler se cassait les dents. La distribution de masques à gaz à la population urbaine ne fit que troubler davantage les âmes les plus patriotiques et jeta le village dans un état d'appréhension que renforçait la méfiance traditionnelle entre campagne et ville. Des masques à gaz ! se gaussaient en s'esclaffant les durs de Coulignan. Grand-mère n'en avait pas moins exigé que nous portions les nôtres en bandoulière à chaque heure de la journée et veillait à ce qu'ils fussent prêts au pied de nos lits le soir. Vous avouerez que le port du masque, même dans son sac, ce n'était pas un bon présage.
Naturellement, les gosses ne voulaient pas être en reste. Nous portions nos sacs de masque à gaz en bandoulière pour aller à l'école mais dans l'hilarité générale et défiante. Avec de grosses plaisanteries comme vous pouvez bien l'imaginer. Qu'une odeur plus ou moins plaisante ou un bruit plus ou moins incongru se fasse sentir ou survienne en classe, et les plus malins mettaient la main sur leur sac...
Après les masques, la censure ! De grands blancs dans le journal local. On s'en étonna mais sans alarme car, après tout, le secret de grandes préparations militaires devait être gardé. Qu'est-ce qu'on allait leur flanquer comme raclée aux Boches !
Tout cela, masques et censures, n'affectait guère la vie des Coulignanais et, cela va sans dire, ne pouvait troubler Ivan et son inséparable Saint Bernard. Nous, passant devant la demeure du forgeron, appelions en dérision : "Gutti-bubbi ! Butti-mini ! Mini-mini !". Charlu ne nous répondait plus.
Mai 1940. L'écroulement du Front et l'avalanche allemande ! En quelques semaines, l'ennemi avait tout balayé devant lui et traversait Coulignan en direction du Sud. La France s'était tout simplement désintégrée et son armée ... son armée ... éparpillée au milieu des milliers de réfugiés, fuyard et autres pauvres malheureux qui erraient hagards, désemparés, perdus. Même nous, les gosses, étions abasourdie.
Pas Charlu.
De sa porte, il avait assisté avec un intérêt singulier à la débâcle et au pitoyable exode qui bouchaient les routes de France, ces milliers et milliers de malheureux que vomissaient les régions du Nord. Ces Hollandais, ces Belges, ces compatriotes de Lille et d'Amiens, et de Sedan, et de ... Rouen, de Paris, effarés, abrutis, hébétés qui abandonnaient chevaux et bébés dans les fossés, jetaient leurs armes et leurs horloges d'héritage, oubliaient les grand-mères invalides le long des haies, se ruaient éperdus dans toutes les directions ou s'abritaient piteusement derrière un poteau télégraphique au moindre vrombissement d'avion, ces masses gluantes qui s'épanchaient à travers le village et suppuraient vers le Sud, le stupide Sud. De nuit et de jour, sans cesse, Charlu les regardait sans rien dire, sans aucun émoi et Ivan lui-même ne pouvait le tirer loin de l'étonnant spectacle.
Un jour, des avions allemands avaient plongé sur la cohue et lâché leur mitraille d'une manière assez désinvolte et si rapide que la panique n'éclata qu'après leur passage. Ce fut alors de l'hystérie : des chevaux s'emballèrent, les charrettes se renversèrent et on retrouva par la suite des tas et des tas d'effets personnels et d'ustensiles de cuisines dans les ruelles, dans le Valais, sur le parvis de l'église ou accrochés dans les buissons en bordure de la route.
Le lendemain, voilà des avions qui reviennent et bombardent la gare. Notre gare ! La grande Rue s'était vidée et, dans tous les champs alentour, des milliers de gens s'aplatissaient; les maisons du village furent secouées, fracas énorme des explosions, morceau de rails et de ballast qui tournoyaient au milieu des éclairs et des gros nuages de fumée, les cris et les hurlement, le sol qui tremblait et les cloches de l'église qui se mirent à tinter ! Dans le ciel, les avions menaient sarabande, plongeant et lâchant leurs bombes, puis arrosaient la voie de projectiles ...
Charlu ?... Charlu se tenait, tout seul, au milieu de la Grand Rue... émerveillé, fasciné, en proie à la plus grande jubilation, et il chantait à pleins poumons une rengaine populaire "amour ... toujours ...".
Dans les jours suivants, le bruyant déferlement des tanks et camions à croix gammée devait à nouveau remplir Charlu d'extase.
Ces engins, pare-chocs à pare-chocs, ces voitures blindées, ces chenillettes rapides, ces ambulances, ces popotes roulantes, et toujours plus et plus de moyens de transport ... Charlu n'avait jamais rien vu de plus beau ni de plus excitant ! Il sautait, trépignait de joie et se mettait à danser une sorte de farandole à laquelle son père mit fin d'un coup de pied aux fesses.
Pendant l'été, Ivan et sa mère ainsi que tous les autres réfugiés mosellans reprirent le chemin de leur village. Soudainement, Charlu se trouva seul.
Seul.
Il ne comprit pas la catastrophe qui s'abattait sur lui, Charlu. Il ne comprenait pas. Il n'avait sans doute aucune idée, d'ailleurs, de l'amplitude et de la portée des événements dont il avait été le témoin. Mais le départ d'Ivan ...
D'abord, Charlu fut désemparé. Perplexe. Il y avait eu la mobilisation générale l'année précédente et les cérémonies au Monument aux Morts avec Monsieur le Curé et Monsieur le Maire en tête de la procession ; puis l'arrivée d'Ivan et deux saisons de bonheur, "Gutti-bubbi !" le matin et "Gutti-bubbi" le soir; puis la confusion générale et les clameurs au milieu des explosions si belles; enfin, le passage des soldats aux uniformes gris vert dans leurs lourdes machines, et ... un grand silence. Ivan et sa mère étaient partis en cours de matinée alors que Charlu exécutait une commission pour son père à la Renauderie, une ferme des environs.
Pendant plusieurs jours, Charlu vagua de droite et de gauche sans savoir que faire. Mais sans s'enquérir non plus. Un mauvais rêve. Il allait comme un automate, geignait tel un chien abandonné. Et nous, ses anciens compagnons, nous étions dispersés aux quatre coins de la commune, occupés aux travaux des champs; aussi Charlu n'avait-il personne à qui se plaindre.
Bientôt, Charlu ne geigna plus, ayant peut-être oublié la raison de son infortune, cette liberté soudaine. Et il recommença à bégayer.
Charlu avait des bras forts et il fut engagé par des fermiers pour la récolte. On lui donnait sans doute la nourriture.
Robert Arthaud et moi avions passés le Certificat d'Etudes dans des circonstances assez turbulentes et qui m'aidèrent sans doute à obtenir le fameux diplôme. Munis de ce viatique, nous nous présentions à l'examen d'entrée au lycée, en sixième. Les temps s'étaient alors un peu assagis et le calme revenu ne me fut guère propice ... mais je fus tout de même admis après un peu de piston de la part d'un cousin qui fournissait le charbon au vénérable établissement (construit par Henri IV !).
Pierre Jeanson se dirigea vers l'Institut Agronomique de Parthenay, tandis que jacques Gaigne, René Labroisseau, michel Perrin et Dédé retournèrent à la ferme, à la boucherie ou à l'atelier. Nenette s'inscrivit à l'école de Secrétariat où jeanine Métanet étudiait (brillamment) depuis une année déjà, tandis que son cousin, Maurice Etat, trouva un emploi comme apprenti aux chemins de fer. Bientôt, nous perdions tous contact les uns des autres et quelques-uns, Robert et moi, entrions dans un monde tout à fait différent, un monde inouï et riches d'horizons insoupçonnés ... Nous ne retournions jamais.
Et Charlu ?
Nous l'avions perdu de vue, lui aussi. Pendant quelque temps, juste avant la rentrée, nous l'avions remarqué qui courait en zigzag à travers l'Allée des Ecrevisses, agitant ses bras comme un moulin à vent en débandade; nous l'avions quelquefois vu, tôt le matin, se rendre à une ferme; arrivée à la fontaine du lavoir, il en faisait savamment le tour deux ou trois fois et s'immobilisait un instant pour admirer son reflet dans l'eau, puis s'enfuyait à grandes enjambées en éclatant de rire.
Un jour, une fin d'après-midi pour être plus précis, alors que je portais ma bicyclette à réparer chez le Père Moureau, voilà Charlu qui débouche sur le champ de Foire; il me voit, s'arrête et, après quelques secondes de réflexion, se précipite à travers la haie derrière le Domaine Municipal pour disparaître vers le Pas du Valais sans doute. Ce fut la dernière fois que je le vis.
Charlu se trouva donc ainsi relégué loin derrière les événements qui absorbaient maintenant toute notre attention : la Bataille d'Angleterre, la Campagne Africaine, les nouveaux uniformes et tous ces poteaux indicateurs bariolés en noir portant enseignes redoutables et envoûtantes : Kommandantur, Lazaret, Soldatenheim, Achtung ! Verboten ! etc.
Au lycée. Dans ces années, une partie es bâtiments avait été réquisitionnée et transformée en Lazaret, Hôpital de Campagne. La Kommandantur se trouvait à deux pas, dans l'hôtel de ville, et tous les jours, on pouvait assister à la relève de la garde. Impeccable démonstration de l'ordre nouveau. Et nous étions aux premières loges.
Et puis le lycée où j'étais inscrit comme pensionnaire avait tant à offrir ! C'était une communauté de jeunes tellement plus stimulante et ouverte que celle de notre gentille école communale ! En fait, c'était un autre monde dont nous percevions à peine les dimensions extérieures mais que nous sentions par une sorte d'osmose avec les "Grands" qui allaient se présenter à l'Université ou aux Grandes Ecoles. Ce monde nous tendait les bras et nous ouvrait d'immenses possibilités qui vibraient à fleurs d'imagination. Intoxiquant ! Et les premiers jours furent un éblouissement pour Robert et moi (mon jeune frère devait nous rejoindre l'année suivante et restait donc encore au village). Pouvez-vous même imaginer notre ardeur ? La joie d'infinies découvertes et surtout de celles-là que nous soupçonnions un peu par de-là nos livres d'arithmétique et d'orthographe sous l'œil sévère de Monsieur Blanchon.
Il me faut rendre hommage et mon dû à qui de droit : nous avions des professeurs pour chaque matière. Un linguiste aux tempes blanches nous enseignait l'allemand, un archéologue nous guidait en latin et grec tout en parsemant ses leçons de réminiscences merveilleuses, un maître d'Histoire et de Géographie diplômé de l'Ecole des Chartes nous promenait à travers l'Empire Français, un petit homme amusant au possible nous jouait des tours mathématiques (sans pour autant éveiller en moi la plus minime des aptitudes). Et nous avions la permission de fouiner dans la bibliothèque qui, sans être immense, n'en offrait pas moins bien de belles aventures. Et puis, gymnastique ! Gymnastique deux fois par semaine et football le jeudi après-midi. Les Dimanches, sortie chez notre cousin qui nous laissait la bride sur le cou ! Merveilleux !
Alors, vous comprenez que Coulignan, Monsieur et Madame Blanchon, le préau dans la cour de récréation, les bois et les près, la beauté même des grands espaces filtrant à travers les platanes et la rosée du matin ... tout cela s'estompait rapidement derrière nos livres et nos rêves.
Cependant, Charlu restait lové dans nos esprits. De temps en temps il faisait surface dans le creux d'une lame de notre nouvelle vie. Naturellement, il crevait la houle, un tant soit peu déformé par la distance et par les embellissements que nous nous croyions obligés d'ajouter pour ne pas décevoir nos camarades ou tout simplement pour augmenter notre importance personnelle. Tout le monde fait cela. Mais sa présence, étrangement certes, semblait donner une dimension existentielle à notre allure quotidienne. En fait, Charlu, de plus en plus obscurci, devint un maillon qui nous reliait encore au village et il se métamorphosa en un mythe qui grandit et se colora avec chaque trimestre qui passait; un mythe sans cesse exagéré qu'alimentaient les rumeurs glanées au village lors de nos courtes visites en fin de semaine.
Mais Charlu avait disparu du village dans le courant de cet automne 1940, ses parents l'ayant finalement inscrit à l'Institution que Monsieur et Madame Blanchon avaient recommandé. Grand-mère qui savait tout ce qui se passait dans le village, grâce à la laitière et à la bonne qui venait deux fois par semaine faire le ménage (et aussi par la Mère Raymonde qui colportait très volontiers les dernières nouvelles aux quatre coins de la commune ...), nous avait assuré que l'Institut, une école spéciale pour les retardés mentaux, offrait non seulement une instruction élémentaire enrubannée de notions civiques et de matières sociales, mais aussi des rudiments d'hygiène personnelle et, pour les moins souffrants, la possibilité d'apprendre un petit travail modeste comme rempailleur à la maison ou couturier à l'usine. Il s'agissait d'ateliers et de classes payés par le gouvernement tout comme le logement en dortoir et la nourriture; les élèves y végétaient tranquillement ou, du moins, hors de danger. Gabriel et moi en avions des frissons.
Nous voilà donc en 1942. La guerre sur le front russe augmentait d'intensité et de sauvagerie, l'hiver décimant les rangs nazis tandis que les bombardiers anglais et américains déversaient leurs charges de bombes sur les villes allemandes. Quelquefois sur les villes françaises aussi, événements tragiques que la presse collaborationniste exploitait à pleine page naturellement avec photographies et détails sanglants. Puis les Américains débarquèrent en Afrique et la Wehrmacht occupa le reste de la France si bien que nous étions, d'un seul coup, tous devenus solidaires dans le même sac, les Japonais mais cela était très loin et notre carte au mur avec ses petites aiguilles colorées n'y suffisait pas. Oui, nous apprenions la géographie !
Cet hiver-là, sans charbon et avec des rations alimentaires très réduites, nous cingla tous sans pitié bien que la France eut moins à souffrir que d'autres pays. Après tout, les fermes nous garantissaient un petit minimum et nous autres qui vivions à la campagne ou qui y avions nos racines ne manquions pas trop de beurre, légumes ou même viande. Et puis nous avions les conserves de fruits à la rescousse. Par contre, je me souviens d'avoir pleuré amèrement lorsque mes souliers craquèrent et Grand-mère n'avait pas les moyens de nous en acheter. Souliers ou bottes étaient introuvables, n'importe comment. Alors, avec des ficelles, il me fallut improviser une réparation à renouveler presque quotidiennement. Et savez-vous ? après quelques semaines, j'exhibais mes souliers avec fierté, partageant ainsi, du moins j'en étais persuadé, les souffrances de la Résistance ! Le printemps arriva très vite pour me garder dans cet état d'esprit ... Je me souviens qu'on me vola mon écharpe au cinéma où nous passions parfois un Dimanche après-midi pluvieux, au chaud. Film de propagande gratuit. J'en eus honte. Honte pour le malheureux voleur et j'aurais bien préféré la lui donner. Honte peut-être parce que tant de gens se trouvaient en peine autour de moi petit privilégié. Moi qui acceptais les gâteaux vitaminés que nous distribuait les souris grises du Centre d'Accueil ou les Dondons bleues du Maréchal. Ce n'était pas mauvais et l'estomac se foutait pas mal de la Légion Anti-bolchevique. Ma belle écharpe de grosse laine rêche ...
Le printemps 1943 arriva sur les talons de l'échec allemand devant Stalingrad et l'espoir, chaque jour, s'inscrivait dans le ciel, très haut, en longues traînées de condensation que déroulaient des centaines de bombardiers alliés grondant vers leurs objectifs en Germanie. Nous savions déjà leurs noms de beaux mirages : Liberators, Forteresses Volantes, Lancasters; nous savions combien de tonnes de bombes ils transportaient, combien d'hommes d'équipage, leur rayon d'action, etc. etc. par la B.B.C. que nous écoutions sur des postes à galène et par la rumeur publique.
Au lycée, les discussions passionnées sur la guerre et le sport m'intéressaient. Oh, les études m'intéressaient aussi, surtout la géographie sans oublier l'allemand que je fortifiais de conversations avec les blessés qui occupaient une partie de l'école. Pourtant, rien de très brillant et le passage dans la classe supérieure était toujours revêtu d'un sens tragique, d'anticipation angoissante ... Le bon proviseur trouvait des excuses dans l'absence de nos parents isolés en Afrique Centrale et attribuait à mes modestes succès des valeurs que j'avais déjà bien du mal à discerner ! Brave homme qui portait la tête très droite à cause d'une balle signée Verdun dans la gorge.
Mais aussi, une véritable appréhension sèche comme du papier de verre que l'Histoire s'échappait à travers mes doigts, glissait sur ma peau et ne voulait pas s'y attacher ne fusse qu'un instant. J'étais trop jeune. A quatorze ans, on piaffe et on rue, on est prêt pour s'embarquer ! Mon rêve était très simple : je voulais devenir capitaine de sous-marin !! (Ce rêve coula à pic après que mon oncle eut mentionné les mathématiques et la physique nécessaires pour être admis à l'Ecole Navale.)
Enfin, le trimestre se termina et, une fois de plus, je me faufilais miraculeusement entre les barreaux des examens pour être admis en classe supérieure. Tout cela n'a sans doute pas grand chose à voir avec ce qui se passait au village.
Le village qui reçut un vrai choc électrique justement au cours de ce printemps : un jour, en mi-matinée, soleil et tout, tandis que les bonnes femmes étendaient leur linge et que les habitués s'étaient attablés à la terrasse du café Guérin, "voilà-t-y pas que quoi qui s'arrête sur la place de l'église ?", l'autocar-gazogçene-brivin qui assurait la navette hebdomadaire entre Niort et Poitiers. Et ... droit comme un i, dans l'uniforme bleu-foncé de la Jeunesse du Maréchal ... descend ... Charlu !!!
CHARLU !
Marcelin, le boulanger, sa femme, leur mitron et les clients, tous se pressent sur le pas de la porte pour mirer; Guérin soulève son rideau et, croyant avoir la berlue, appelle sa femme; le garçon-livreur, qui s'apprêtait à entrer avec une caisse de vin, s'immobilise bouche bée; les clients se figent et celui-là qui sifflait son coup de rouge, ou de blanc, en bave; le coiffeur et son client barbouillé de mousse se hissent avec précaution au dessus de l'étalage d'eau colorée; le postier, toujours à l'affût, sort sa tête de son minuscule réduit tandis que la locataire à l'étalage suspend en vol le tapis qu'elle secouait; et Monsieur le Curé, lui même, qui arrosait ses fleurs devant le presbytère en est saisi de ... stupeur, cherche ses lunettes fébrilement dans sa soutane, les met de travers ... stupeur ! Tout le village retient son souffle; Gaga ! Absolument ! Gaga que je vous dis.
Charlu ! Il était si fier, si droit et si grand, raide ! uniforme impeccable qui lui seyait parfaitement; pantalon soigneusement repassés, les plis bien marqués; et les chaussures astiquées comme un parquet de notaire; la veste réglementaire boutonnée du haut en bas et les boutons brillaient d'or; ceinturon luisant; le béret carrément posé, un peu incliné mais sans bravache, avec la francisque bien en évidence.
CHARLU ! Il salua courtoisement le chauffeur, fit demi-tour très militaire et prit le pas cadencé vers le pont. Comme il marchait martialement ! Une petite mallette en osier à la main, une cape sur l'épaule. Il donna un beau salut viril à Moureau qui descendait à ce moment-là de son atelier sur le Champ de Foire (pardon ! La Place du Maréchal), salua aussi Monsieur le Curé et enleva son béret en passant devant l'église !
Les villageois, ces Coulignanais qui avaient hébergé Duguesclin autrefois et même (l'instant d'un déjeuner rapide) l'Empereur qui se rendait à Rochefort, n'en croyaient pas leurs yeux et vous aussi vous auriez cru rêver. Je vais même vous dire, une fois le premier choc passé, eh bien ... il n'y avait sans doute pas un seul Coulignanais qui ne fusse ... comment vous dirai-je ? ... remué ... oui, remué aux entrailles. Fier.
Mais d'abord, ils étaient, tous sans exception, éberlués.
C'est grand-mère qui nous avait écrit tout cela dans sa lettre du Mardi (elle nous écrivait tous les dimanches quant nous n'étions pas en congé au village et nous recevions le courrier le mardi). Nous, éloignés de Coulignan et isolés par les grands fait mondiaux, nous ne savions que croire. Gabriel ouvrit la lettre le premier et son cri d'étonnement me fit bondir. Il en bafouillait ! Impossible ! Je lus la lettre moi aussi et, pendant quelques instants, nous nous étions silencieusement demandés si grand-mère, pauvre grand-mère ... tous ces événements récents, un oncle prisonnier, sa fille chez les cannibales ... Mais non, son écriture n'avait subi aucun changement, le g gracieux et le d à la veille mode ... aucune faute d'orthographe et "soyez studieux pour chers parents" à la fin ... non, elle ne dérivait pas. Et Robert venait lui aussi de recevoir une lettre de sa mère, sa mère qui n'écrivait jamais, jamais, jamais ! Ou bien tout le village était la proie d'une hallucination collective !
Vous pouvez bien comprendre comme nous étions pressés de rentrer au village le prochain dimanche pour en savoir un peu plus et nous assurer des faits. Un cas d'erreur d'identité par les temps qui courraient n'était pas à écarter. Cependant, grand-mère ... elle avait vu 14-18, le Rif, la crise ... elle n'était pas femme à perdre la tête. Et, de la gare où elle était venue à notre rencontre jusqu'à la maison, subit un tir de barrage de questions auxquelles elle répondait le mieux possible sans se couper ou se contredire et terminant du reste chaque réponse par "c'était Charlu !" (vous vous souvenez celui-là qui terminait de même ses discours : "il faut détruire Babylone !" (ou Carthage ou Cipangu, enfin une idée fixe ...). Dès le dîner (sept heures précises, été comme hiver) avalé, serviettes pliées et chaises repoussées sous la table, nous filions chez Dédé, le seul camarade vétéran de l'Ecole Communale qui nous donnerait la vrai vérité avec tous les détails.
La vraie vérité ! Et quels détails ! Non seulement Charlu s'était engagé dans la Jeunesse du Maréchal mais il avait été présenté, lui Charlu, au Maréchal en personne à Vichy ! Et que le Maréchal lui avait serré la pince et donné une montre en or !! Et qu'il lui avait dit comme il était fier et qu'il était la France Nouvelle !!!
Je vous dis : incroyable ! Dédé aussi "amenisait" : "C'était Charlu !".
Imaginez les parents ! Le bonheur est alors un mot bien plat pour décrire leur félicité, le paradis où ils flottaient comme les élus du vitrail au dessus du chœur de l'église. La bonne mère pleurait de joie toute la journée et le père, le père qui avait fait Verdun (le 125° d'Infanterie était composé en grande partie de Poitevins), vous pensez bien quels étaient ses sentiments. Ils avaient un grand portrait, signé, du Maréchal dans la salle commune, avec un ruban tricolore tout autour et une branche de buis fichée dans un coin. A côté du portrait de Pie XII. Charlu leur faisait un tel honneur ! Leur fils ! Leur fils unique ! Et, pendant quelques jours, les voisins craignaient l'attaque cardiaque ou une apoplexie pour le moins. On meurt de ces choses-là, savez-vous. Et leurs larmes inondaient les mains du garçon.
Oui, on peut mourir de joie.
Mais revenons à Dédé. Et à Charlu. Qui était logé, nourri, habillé et qui recevait une petite allocation chaque mois en compensation du travail de déboisement et drainage qu'il effectuait en compagnie d'autres jeunes dans le Marais Poitevin. Du reste, nous affirmait Dédé, rien qu'à regarder ses mains et son teint hâlé, on pouvait dire que ce n'était pas un travail de bureaucrate.
Il y avait même plus encore : on disait que Charlu allait être promu Chef de Dizaine ! Chef de Dizaine ! Vous m'avez bien entendu ? Alors là, nous ne pouvions plus ... nous ne savions que dire. (Vraiment l'Histoire filait entre nos doigts !). Et ... et ... Charlu ne bégayait plus du tout.
Charlu était redevenu normal. Dédé (ses phrases bourdonnaient maintenant de façon très flou dans nos têtes) nous relatait même une discussion politique au cours de laquelle Charlu était intervenu pour exposer posément des idées aux mots éloquents comme "renaissance" "purification", "l'âme française", "la patrie ancestrale", etc. etc.
Et puis Dédé s'arrêta. Il s'était rendu compte que nous ne suivions plus.
Quelques jours après cette magnifique rentrée au village, Charlu disparut à nouveau. Plus de nouvelles pendant très longtemps. C'est que, voyez-vous, les interdictions de voyager, les bombardements sur routes et voies ferrées, les embuscades dressées par les F.F.I. ou les F.T.P. et les sabotages, tout cela ne facilitait pas les choses. Les exécutions d'otages et les représailles non plus. Ces mois de 1943-44 s'enfonçaient comme autant de coins dans nos petites vies protégées et les faisaient éclater en fragments.
Pourtant la Libération nous trouva tous, ou presque tous, sains et saufs.
Mais notre père mourut subitement et maman rentra un an plus tard à Coulignan avec deux jeunes frères que nous ne connaissions pas. Fin 1945, nous quittions la France pour l'Afrique Centrale ou une petite plantation nous attendait. Une petite plantation et bien des malheurs. Mais cela est une autre histoire.
Quelques dix-sept ans plus tard, tout à fait par hasard, nous en vînmes à parler de Charlu alors que nous rendions visite à grand-mère. Du moins, notre ancien camarade d'école primaire émergea dans la conversation.
- "Ah, mes chéris, s'exclama grand-mère, Charlu est toujours bien vivant. Il garde les troupeaux de Blin."
Il y eut un silence.
Et puis notre cousin Michel entra, suivi de sa jolie marmaille, et on parla d'autre chose.