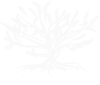Jacques Bourlaud 🩺 - Togo
Le Fasao me fascinait…
Médecin-Chef de la Subdivision Sanitaire de Sokodé-Bassari, je contemplais la carte du Togo d’un air rêveur, le regard attiré par une vaste région qui, sous la dénomination de Canton de Fasao, s’étendait à l’Ouest de la route Blitta-Sokodé . A mi-chemin entre ces deux villes, entre deux kapokiers que j’avais repérés depuis longtemps, s’ouvrait une route accessible aux voitures qui menait tout droit (mais pas plus loin) au village de Fasao adossé à un massif montagneux allongé du Nord au Sud et dont l’autre versant se présentait, m’avait-on dit, par une falaise presque verticale surplombant la plaine de l’Oti qui se confondait, au delà de l’horizon en Gold Coast avec la grande plaine de la Volta .
La carte indiquait une demi-douzaine d’agglomérations, assez éloignées les unes des autres, réparties sur une « brousse à karités » qui, par sa densité, prenait un peu partout un aspect de forêt .
On m’avait affirmé que le gibier y était abondant et varié aussi, désireux de tirer autre chose que des perdreaux, je me promettais bien d’aller faire un tour là-bas, attiré également par l’attrait de visiter un territoire isolé d’accès difficile et par où très peu d’Européens étaient passés .
Il fallait une raison sérieuse pour entreprendre cette expédition qui devait m’éloigner quelques jours de mon hôpital . La vaccination antivariolique m’offrait justement l’occasion de concilier le devoir professionnel avec le goût de l’aventure .
En effet, le vaccin ayant fait défaut pendant la guerre, des cas de variole s’étaient manifestés çà et là dans le Cercle de Sokodé. Un réapprovisionnement normal avait heureusement coïncidé avec mon affectation à ce premier poste . J’avais laissé l’équipe de prospection de la « Trypano » poursuivre le programme établi par mon prédécesseur dans la région de Bassari et j’avais constitué avec quelques infirmiers de l’hôpital de Sokodé un petit groupe mobile d’intervention rapide passant de village en village pour vacciner la population.
J’avais mis un point d’honneur à aller partout, ce qui n’était pas très méritoire car la Subdivision de Sokodé n’était pas très étendue et possédait déjà un réseau routier suffisamment développé permettant d’atteindre facilement en voiture presque toutes les agglomérations .
De temps en temps j’étais bien obligé de compléter ma tournée par quelques kilomètres à pied ou à cheval mais, si je me déplaçais souvent mes absences de l’hôpital ne dépassaient jamais plus de deux ou trois jours .
Pour le Fasao cela pouvait durer une semaine .
Mais sa population n’avait pas été vaccinée depuis combien de temps ?.. Et dans quelles conditions ?.. De plus elle habitait une région frontalière du Togo Britannique . On ne savait pas trop ce qui se passait par là-bas…
Mon enthousiasme failli toutefois être refroidi le jour où le Médecin-Colonel Directeur de la Santé Publique était venu à Sokodé en inspection . Il était très heureux de revoir le poste où il avait fait ses débuts, de reconnaître de vieux infirmiers et de retrouver dans la même case le mobilier déjà hérité des Allemands, qui, patiné par dix-huit années supplémentaires de climat tropical, se montrait toujours aussi confortable et aussi luxueux…
A propos de mes vaccinations et avant même que j’aie pu parler de la tournée envisagée, il me dit :
- N’allez pas dans le Fasao… Il n’y a personne et vous perdrez votre temps…
C’était dur à entendre… D’autant plus que je savais pertinemment que lui-même, en son temps s’y était aventuré…
Mais je commençais à connaître suffisamment mon colonel pour savoir qu’il était préférable de lui soumettre les objections lorsque nous voulions obtenir son approbation pour un projet nous tenant à cœur . Il était alors saisi par le démon de la contradiction, écartait tous les obstacles d’un geste large et proclamait :
- Alors ?.. Qu’est-ce que vous attendez pour l’entreprendre ?
C’est pourquoi j’enchaînais sur un ton neutre :
- D’ailleurs l’Administrateur n’aimerait pas beaucoup que j’y aille…
C’était en partie vrai . Pour des raisons d’ordre familial, le Commandant de Cercle n’appréciait pas que je m’éloigne trop longtemps de Sokodé . Seulement, ma phase était perfide car j’avais évoqué le spectre de l’Administration Coloniale…
Aussi la réponse fut-elle immédiate :
- Qu’est-ce que ça peut lui foutre ?..
Ce que je traduisis d’une façon très hâtive et non sans idée préconçue par :
- Allez-y donc si cela vous fait plaisir…
La conscience tranquille, je pouvais donc me préparer au départ et établir mon programme .
D’abord vacciner le village de Fasao, dont la population recensée était évaluée au moins à la moitié de celle de la totalité du canton . Puis franchir la montagne par une étape de vingt kilomètres à pied afin d’atteindre le village situé en bas de la falaise. Le jour suivant marche dans la plaine jusqu’à Djerekpana, agglomération assez importante toute proche de la Gold Coast . Ensuite nous nous dirigerons sur M’Boko, également au pied de la falaise . Enfin retour par Fasao .
J’avais renoncé à vacciner les deux autres localités de la plaine, l’une à l’extrême-Nord, l’autre à l’extrême-Sud car, pour une quarantaine d’habitants recensés, ma tournée aurait été allongée au moins de trois jours .
Ainsi c’était bien . J’avais l’espoir de vacciner huit à neuf- cents personnes et mon absence ne durerait que cinq jours .
Les arrières étaient assurés :le Médecin Africain Julien d’Almeida continuerait son travail à la tête de l’équipe de prospection, le Médecin Africain Robert Trènou dirigerait comme d’habitude l’hôpital de Bassari et je pouvais accorder toute ma confiance pour l’hôpital de Sokodé à l’Aide-Médecin Derman Ayewa qui avait su acquérir l’estime de tous par sa droiture et sa conscience professionnelle .
Par ailleurs, pour éviter tout sujet de contrariété, j’avais attendu le départ en congé du Commandant de Cercle qui avait laissé le poste à son adjoint, à peine plus âgé que moi, et qui s’était précipité lui aussi d’aller faire une tournée dans le Fasao dès que son patron s’était éloigné .
Le jour « J », pendant que je prenais le petit déjeuner en famille, mon ordonnance, le milicien Hodonou , un dahoméen athlétique et Nana, jeune Moba que le cuisinier, son « grand frère » avait recruté comme marmiton, avaient déposé sur le perron de ma case mon matériel de tournée : petite cantine pour les vêtements, caisse-popote, moustiquaire, lit Picot sans oublier le calibre 12 .
Michel et Claire, nos deux aînés, surveillaient avec un intérêt croissant le déroulement de ces opérations tandis que leur petite sœur, derrière les barreaux de son parc, ne manifestait que la plus superbe indifférence . Ce furent eux qui retournèrent avec précipitation dans le salle de séjour, annonçant sur un ton triomphal la venue de « l’auto grise à papa »…
Elle n’était pas encore en vue mais ils avaient parfaitement reconnu le bruit inquiétant de la boite de vitesse lorsqu’elle avait quitté l’allée de l’hôpital pour s’engager sur la route, l’effet de xylophone produit par son passage sur les planches disjointes qui enjambaient le marigot et les efforts haletants qu’elle déployait pour monter la côte .
L’auto grise était une camionnette d’une marque indéterminée (en avait-elle seulement possédé une !..) . Elle attendait avec une résignation évidente sa mise à la retraite après une carrière longue et méritoire…
Le chauffeur, Salifou, un Cotocoli sympathique, qui présentait une petite mèche de cheveux blancs, conduisait avec un mélange d’adresse et de témérité qui frisait l’inconscience . Il louvoyait entre les creux et les bosses et survolait la « tôle ondulée » sans dommage .
Il était très fier de moi car, m’étant mis au volant avec des notions de conduite très limitées j’avais assez rapidement acquis un niveau équivalent au sien avec toutefois moins de brio mais davantage de prudence .
Donc, dans un crissement de cailloux projetés par des pneus fatigués, la voiture s’est arrêtée devant la case . Elle n’était pas complètement immobilisée que déjà trois des membres de mon équipe avaient sauté à terre autant pour aider au chargement que pour aller discuter avec nos enfants .
Il y avait le manœuvre, un autre Salifou, homme robuste et plein de ressources . Il était suivi de deux infirmiers journaliers : Gabriel un Cabré de petite taille mais très débrouillard et Gbati, un Bassari nonchalant . Plus calme, Louis Atayi, le chef de l’équipe, qui avait pris place momentanément à côté du chauffeur, descendit à son tour et vint avec une déférence souriante me rendre compte que tout était paré . C’était un Mina d’une trentaine d’années auquel sa mère, métisse, avait transmis un teint plus clair et des traits plus affinés . Excellent infirmier, bien élevé, intelligent, il était pour moi un auxiliaire précieux .
Mon équipe fut bientôt mise en place et, dans une symphonie de moteur boiteux et de tôles disjointes, l’auto grise prit son essor sous l’œil admiratif de toute la famille .
La route, presque rectiligne, filait au milieu des tecks . Les Allemands s’étaient efforcés autrefois d’acclimater cette espèce et les services forestiers français avaient pris la relève, si bien que de Sokodé à Blitta (et même au delà) ils formaient comme une sorte de forêt-galerie longeant la route sur une profondeur de quelques centaines de mètres à droite et à gauche .
Nous traversions une série de villages cabrés dits d’immigration . En effet l’Administration Coloniale avait eu l’idée de transplanter sur ces terres inexploitées un excédent de la population cabraise à l’étroit sur ses montagnes d’origine . C’était- là une idée séduisante mais qui suscitait cependant quelques difficultés .
Je connaissais bien ces villages car je m’y rendais chaque semaine avec ma petite équipe pour soigner les enfants atteints de pian . La vaccination anti-variolique m’avait permis de découvrir un grand nombre de pianiques, aussi passions-nous régulièrement leur administrer des piqûres de bismuth . La pénicilline était connue depuis peu mais elle n’avait pas encore été mise à la disposition des médecins de brousse . Le bismuth donnait alors de bons résultats mais malheureusement aussi, quelquefois, des stomatites très graves.
Enfin, à Ayengré nous avons pris à main droite la piste qui s’amorçait entre deux files de kapokiers . C’était l’inconnu qui commençait .
Tout allait bien à bord . L’œil attentif de Salifou, le chauffeur, cherchait à deviner les pièges de la route .
Louis Atayi, sur l’unique siège arrière de la camionnette, paraissait se laisser aller à une méditation somnolente . Ayant accaparé tout ce qu’il y avait comme chaises ou fauteuils pliants, Hodonou, Salifou le manœuvre et Gbati dormaient sans scrupule, ne soupçonnant même pas le rêve épique de leur patron…Quant à Nana et Gabriel relégués l’un par sa jeunesse, l’autre par sa petite taille, ils étaient juchés tant bien que mal sur l’amoncellement des caisses et des nattes roulées et s’y étaient endormis comme les autres .
Nous parcourions une région vallonnée qui, par des ondulations successives d’amplitude modérée mais croissante, nous menait insensiblement à la chaîne montagneuse du Fasao . Le paysage était celui de la savane arborée : une herbe drue qui commençait à jaunir parsemée de nombreux arbres tourmentés à feuilles longues et lisses, par ci par là une termitière montrait son édifice en jetant une tache d’ocre sur un fond de verdure .
J’aurais voulu voir du gibier mais l’heure était déjà trop tardive pour les perdreaux et les pintades qui avaient regagné le couvert . Pourtant ils étaient là il y avait des empreintes et des laissées toutes fraîches . Le bruit du moteur les effrayait peut-être .
Deux ou trois fois nous avons trouvé la route coupée . Des ponceaux de bois avaient été détruits par un feu de brousse . Comme nous étions au début de la saison sèche, il y avait peu d’eau dans les marigots mais il fallait chercher un autre passage .
L’auto grise se transformait alors en véhicule tous-terrains et passait l’obstacle cahin-caha pour reprendre un peu plus loin le chemin de roulement . Nous étions bien obligés de descendre pour soulager les ressorts, guider le chauffeur et, éventuellement, pousser la voiture ou déplacer des pierres .
C’est au cours d’un de ces exercices que notre odorat fut frappé par une forte odeur de charogne et nous avons découvert à quelques pas de nous un espace d’une dizaine de mètres-carrés où l’herbe avait complètement disparu et le sol apparaissait piétiné . Accrochés à des épineux pendaient quelques petits lambeaux de peau recouverte de poils . Très probablement des lions avaient abattu une proie en cet endroit et leur repas, prolongé ultérieurement par le festin de tous les charognards du coin, avait dû être l’occasion d’une telle sarabande que toute la végétation avait été balayée et le sol lui-même s’était comme imprégné de sang et de matières organiques .
Nous n’avons pas insisté . Nous sommes remontés en voiture pour arriver peu de temps après au village de Fasao : une centaine de cases rondes réparties au milieu des cultures sur le flanc de la montagne .
Salifou stoppa devant le hangar de la « Trypano » . Il ne pouvait pas aller plus loin car la route s’arrêtait là .
Le Chef de Canton nous attendait .
En prévision de notre passage il avait fait recouvrir de paille neuve le hangar, ce qu’il ne manqua pas de faire remarquer dans son discours de bienvenue .
Je répondais en le remerciant de son accueil et de la sollicitude qu’il témoignait à l’égard de sa population . Je rappelais enfin le but de notre visite, évoquant les épidémies de variole et de fièvre-jaune qui avaient laissé un souvenir très vivace dans l’esprit des adultes .
Salifou le manœuvre traduisait en cotocoli avec une éloquence enflammée laissant un peu rêveur Louis Atayi qui, bien qu’originaire du Sud-Togo, connaissait assez bien cette langue .
Après cet échange de beaux effets oratoires le Chef me fit le cadeau traditionnel de deux poulets et d’une calebasse remplie d’œufs que Salifou s’empressa de mirer sans vergogne, repoussant ceux qu’il ne jugeait pas dignes de figurer sur ma table .
Je fis à mon tour le cadeau non moins traditionnel de quelques paquets de cigarettes qu’une des femmes du Chef revendrait au détail sur le marché avec un bénéfice substantiel .
Le matériel technique fut alors déposé sous le hangar tandis que deux musiciens, frappant de leurs bâtons recourbés les petits tambours qu’ils maintenaient sous leur aisselle me conduisaient jusqu’au campement .
Là Hodonou et Nana (ma Maison Militaire et ma Maison Civile…) avaient déjà tout installé pour mon confort relatif .
Mais il n’était pas question de s’attarder . Les villageois étaient rassemblés . Nous n’avions que le temps de prendre un repas rapide avant de nous mettre au travail . Malgré la chaleur la sieste post-prandiale serait reportée à une date ultérieure
On utilisait à cette époque (1946) un vaccin facile à transporter que l’on broyait et malaxait pour en faire une suspension dans de la glycérine . On y ajoutait aussi le vaccin anti-amaryle de l’Institut Pasteur de Dakar, ce qui permettait d’effectuer les deux vaccinations en une seule fois . Ces pratiques ont, évidemment, beaucoup évolué depuis .
Donc pendant que Louis Atayi, sous le hangar, préparait avec minutie sa mixture dans un petit mortier, Salifou le chauffeur, aidé par les policiers du Chef, groupait les habitants par familles et Hodonou, formé à l’école du Soldat sans Arme, les alignait colonne par un avec une incontestable autorité . Ils défilaient alors devant Gbati . Celui-ci, qui avait le Certificat d’Etudes, avait installé une table à l’ombre d’un grand arbre et se livrait à un pointage sur les fiches de recensement que nous avaient confiées l’Administration . Il les complétait avec les noms des nouveaux-nés et, d’un trait de plume olympien, rayait ceux qui lui avait été signalés comme décédés . Parallèlement à ce travail il noircissait une feuille de papier de petits bâtons et de signes conventionnels qu’il me faudrait décrypter plus tard pour mes rapports et mes statistiques .
Les gens se présentaient ensuite à l’entrée du hangar devant l’autre Salifou qui était chargé de savonner la région deltoïdienne . Il agissait avec méthode et une application hiératique : dans la main gauche un coton imbibé d’eau savonneuse, dans la droite un coton présumé sec . Comme la réserve était limitée et que Salifou était soucieux des deniers publics, il n’usait du coton qu’avec une extrême parcimonie.. ;
Mais pour accomplir son rite, il devait inciter les patients à se mettre torse nu . Les hommes retiraient leurs boubous sans aucune difficulté . Mais les femmes étaient réticentes et ne se découvraient pas plus qu’il ne fallait . Nous pouvions cependant voir celles qui avaient des problèmes de santé car la plupart d’entre elles le signalaient spontanément ; pour celles qui voulaient cacher leur mal, nous étions presque toujours renseignés par leurs bonnes amies…
Avançant de quelques pas, les habitants tendaient leur épaule à Gabriel qui y déposait deux gouttes de vaccin .
Venait enfin le tour de Louis Atayi qui pratiquait la scarification .
C’était pour lui l’occasion d’un examen rapide avec quelques gestes précis : recherche de ganglions sus-claviculaires, palpation de la rate chez les enfants . Et il dirigeait vers moi toutes les personnes qui avaient retenu son attention .
A l’abri d’un paravent, je pouvais à ce moment-là les examiner d’une façon plus approfondie . Ce qui me permettait ainsi de repérer les lépreux, les cas d’onchocercose, les ulcères phagédéniques les goitres . Je m’intéressais surtout aux enfants pianiques que j’envisageai de faire soigner, les semaines suivantes, par un infirmier itinérant . Enfin je m’efforçais de persuader certains, et en particulier les porteurs de hernies, à venir se faire soigner à Sokodé .
L’action du Chef de Canton avait été efficace et le taux de participation de la population très satisfaisant si bien que le travail, prolongé par quelques pansements et quelques soins donnés aux uns ou aux autres, ne s’était arrêté qu’à la tombée de la nuit .
Il était trop tard pour que j’aille faire un tour dans les environs avec mon fusil sur l’épaule comme je l’avais projeté . Ce serait pour un autre jour .
Le lendemain, au lever du soleil, comme je faisais quelques pas en dehors du campement pour détendre mes muscles engourdis sous l’effet de cet instrument de torture appelé « lit Picot », mon regard fut attiré par des oiseaux qui s’agitaient à vingt mètres de moi, courant entre des amas de pierres et des touffes d’herbes, paraissant me narguer par leur jeu de cache-cache .
C’étaient bien des pintades !, et des vraies, des sauvages sans crête et sans tache blanche !.. Mais le temps de retourner dans la case chercher mon fusil et elles étaient reparties dans la forêt toute proche .
Tant pis ! D’ailleurs c’était l’heure de se préparer au départ . Un à un mes co-équipiers émergeaient de leur sommeil et déjà Salifou le manœuvre s’activait pour extirper de leurs cases les six ou sept porteurs que le Chef avait mis à notre disposition .
Les porteurs ne s’effrayent jamais de la charge ni de la distance à parcourir, mais ils n’aiment pas se lever tôt car, en saison sèche, les matinées sont froides . Par ailleurs il leur est parfaitement indifférent de marcher en plein soleil avec trente kilos sur la tête . Le Blanc, lui, a une autre conception de la marche et préfère effectuer le trajet « à la fraîche » pour s’arrêter à midi . D’où une source de malentendus .
Enfin, tant bien que mal, la troupe se rassemble .
Il ne me reste plus qu’à me chausser .
J’avais quitté Sokodé avec, aux pieds, une paire de samaras en cuir rouge que ma femme avait achetée à un Haoussa après une discussion serrée. Celui-ci, ravi de voir que Madame Docteur « connaissait si bien la manière », avait fait cadeau à chacun de nos deux aînés d’une paire à leur pointure . Je ne pouvais pas envisager une marche de vingt kilomètres en montagne dans cet équipage . J’avais l’habitude lorsqu’il s’agissait de « prendre mon pied la route » d’utiliser des brodequins en cuir très souple dénichés dans un magasin de l’Intendance . Je mettais des chaussettes de laine et tout allait bien .
Mais ce matin-là, j’ai eu beau bouleverser le contenu de ma cantine de fond en comble, je n’y retrouvais pas mes chaussettes… Au départ de Sokodé j’avais dû me tromper dans la pénombre et prendre à leur place une paire appartenant à ma femme .
Il faut savoir que, pendant la guerre, les jeunes filles « bien » se tricotaient des chaussettes avec amour . Ces chaussettes étaient en fil blanc . Leur tige remontait très haut et s’arrêtait au dessus de la tubérosité tibiale antérieure (notre connaissance sérieuse de l’Anatomie nous permettait d’affirmer cette localisation précise sans même avoir recours aux preuves d’une recherche clinique et expérimentale…) Par le miracle des points compliqués dont elles étaient issues, elles offraient un réseau de creux et de bosses, de trous et de torsades, de côtes et de descentes . Bref ! c’était très beau ; et c’était inusable .
C’était aussi inextensible et il n’y avait aucune possibilité pour mon pied de se glisser là-dedans . Quand bien même, au prix de contorsions douloureuses et d’efforts inouïs, j’aurais réussi à les enfiler, tous les reliefs se seraient incrustés dans ma peau et je n’aurais pas supporté de marcher plus d’une demi-heure dans ces conditions .
J’étais consterné et ne savais pas trop quelle décision prendre lorsque Nana sauva la situation en extirpant du fond de la caisse-popote où elle avait échoué (Dieu seul sait comment !) une vieille paire d’espadrilles à semelles de corde que j’avais mise au rebut quelques mois plus tôt .
Ce n’était pas très élégant, mais qu’importe ! Nous pouvions nous mettre en marche .
Tout d’abord la piste, contournant des obstacles, nous imposait une progression tortueuse dans une galerie forestière suivant les cours de multiples ruisselets qui, à ce moment de l’année, étaient complètement secs . Des arbres majestueux élançaient leurs troncs d’un seul jet jusqu’à la hauteur d’une trentaine de mètres où se détachaient, seulement les premières branches.
Plus près du sol il y avait d’autres essences dont les branches massives et noueuses s’étalaient sur un plan plutôt horizontal, formant des réseaux où s’accrochaient les lianes et les plantes parasites.
C’était le vrai domaine de Tarzan… et j’en étais ravi .
J’avançais rapidement sans aucune difficulté sur un sentier auquel l’humus piétiné depuis des années avait donné une sensation tactile de résistance élastique.
Derrière moi Salifou portait mon calibre 12 et Hodonou son Lebel réglementaire . Puis venaient mes trois infirmiers, Nana tenant un poulet d’une main et un petit sac de l’autre et enfin les porteurs qui bavardaient entre eux . Le chauffeur était, bien entendu, resté à Fasao auprès de son véhicule.
Après avoir traversé à gué une nappe d’eau stagnante dans un fond de vallée, nous sommes tombés sur de très belles empreintes de panthère. L’animal, qui devait être de forte taille, était passé par là quelques heures avant nous et avait emprunté sans façon le chemin des hommes où nous avons pu suivre sa piste pendant plus d’un kilomètre avant que celle-ci ne se perde dans la brousse.
Plus loin, Salifou, qui s’était immobilisé comme un chien d’arrêt, m’avait tendu mon fusil . Devant moi, à bonne distance, je pouvais apercevoir le dos d’une pintade qui picorait activement sur le bord de la piste . Je tire et le manœuvre se précipite pour me ramener triomphalement un très bel oiseau. Ce n’était pas une pintade ordinaire ; elle était plus grosse, son plumage était plus sombre avec des ocelles à reflets bleutés et enfin elle ne portait pas de crête mais un casque de plumes noires. Il s’agissait-là d’une espèce montagnarde assez peu fréquente.
Ce succès qui assurait la perspective d’un rôti succulent, l’agrément d’une marche avant la grande chaleur, tout conspirait à nous plonger dans une douce euphorie qui ne ralentissait pas notre allure.
Pourtant, à chaque pas, je commençais à sentir un picotement à la plante des pieds . C’était léger et je m’efforçais de ne pas y attacher d’importance. Cependant cela s’accentuait tout en demeurant toujours parfaitement tolérable.
En fait la piste avait changé d’aspect. Autour de nous ce n’était plus la forêt-galerie mais la brousse à karités avec des arbres plus vigoureux et plus nombreux que dans les régions de plaine. Le chemin serpentait d’une crête à l’autre et l’érosion le parsemait de graviers et même de gros cailloux.
La marche était plus difficile.
Mais il y avait des choses à voir.
Les porteurs nous expliquèrent qu’en tel endroit il y avait eu une bataille et qu’on y avait enterré les morts. Ils nous ont montré un petit enclos délimité par des pierres et qui pouvait abriter une sépulture.
Un peu plus loin il y avait une source. La tradition voulait que le passant s’y arrête pour boire. Ce qui lui assurait un voyage paisible et un retour heureux vers les siens. L’aspect de la fontaine était très engageant. Nous étions au sommet du massif montagneux et à une dizaine de kilomètres de toute habitation, il commençait à faire chaud, j’avais marché plus de deux heures sans m’arrêter, j’avais soif. Et puis il faut bien respecter les traditions… J’ai donc bu comme tout le monde. Et c’était bon.
A la reprise de la marche je ressentais de plus en plus les aspérités de la route. Après une demi-heure sur un rythme moins accéléré j’ai pris la décision d’une halte.
Il y avait trois heures que nous avions quitté Fasao ; nous avions faim et les porteurs avaient besoin de souffler un peu.
Nous nous asseyons sur une termitière. Nana m’ouvre une boite de pâté ; Atayi sort de sa musette une boule d’akassa soigneusement enveloppée dans une feuille de bananier et en distribue autour de lui avec un peu de sauce pimentée ; les porteurs mâchent des noix de kola.
Gbati étend le bras. A quatre-cents mètres de nous sur le versant opposé du vallon, passe tranquillement un cob de Buffon. Je charge rapidement le Lebel d’Hodonou et je tire à tout hasard. L’antilope fait un bond et disparaît. Nous nous rendons immédiatement sur les lieux, nous retrouvons des empreintes mais aucun indice pouvant faire penser que je l’avais atteinte.
Il n’y a plus qu’à nous remettre en chemin si nous voulons arriver à l’étape avant midi .
C’est alors que je constatais avec amertume qu’il n’y avait plus de semelles à mes espadrilles. Seule, une très mince épaisseur de tissu protégeait la peau de mes pieds du contact du sol .
Pour cinq ou six kilomètres je n’avais qu’à prendre mes samaras de cuir rouge . Ce que je fis . Mais sur ce chemin caillouteux, il ne fallut pas très longtemps pour que la bride passant entre le gros orteil et le suivant se rompe.
Louis Atayi s’est porté spontanément à mon secours en me proposant ses propres samaras. Il irait nus-pieds ; cela ne le gênait pas .
J’accepte et nous repartons.
Les samaras d’Atayi sont solides. Elles n’ont pas été fabriquées comme les miennes au Sahel avec du cuir, mais sur le marché de Sokodé avec des vieux pneus d’auto.
Je ne sens plus les pierres du chemin. L’ennui c’est que Louis Atayi a le pied plus grand que le mien …
A chaque pas celui-ci glisse un peu sur la semell . Au début cela peut aller, mais cela devient vite insupportable. Je suis obligé de ralentir sérieusement. Mes hommes me dépassent, et même les porteurs. Seul Atayi demeure à mes côtés.
C’est en avançant à petits pas que je parviens au sommet de la falaise qui marque la fin de la montagne.
Sous mes yeux s’étale la plaine de l’Oti dont les lointains s’estompent dans la brume d’harmattan. Tout en bas je découvre les petites cases du village où doit se dérouler notre deuxième séance de vaccination .
Mais entre le point où je me trouve et ce village, il y a une dénivellation de près de deux-cents mètres, presque à pic, parcourue par un sentier en lacets .
Gbati Gabriel et Nana se sont élancés en courant et descendent avec de grands éclats de rire .
Je les regarde avec envie car, pour moi, ce sera beaucoup plus pénible . A l’effort musculaire s’ajoute la douleur que je ressens à la plante des pieds . Hodonou descend juste devant moi comme pour m’indiquer le chemin . Atayi se tient gentiment près de moi, s’apprêtant à me soutenir .
Enfin, en serrant les dents je suis parvenu sur le terrain plat . Je retiens mon souffle et m’avance avec raideur, cherchant à donner une impression abusive de dignité au Chef qui vient vers moi avec le poulet et les œufs .
Ce jour-là je ne me suis guère éloigné de mon fauteuil pliant, me contentant de surveiller de loin l’activité de mes infirmiers et de recevoir les malades que m’adressait Atayi . Si bien que lorsque le travail s’arrêta, je pouvais à nouveau me remettre sur mes pieds et supportais de faire quelques pas, d’autant plus qu’à l’aide de vieux clous Hodonou avait réussi à réparer mes samaras .
Comme le village n’était pas très peuplé, il me restait encore une bonne heure avant de voir tomber la nuit . J’estimais qu’il n’aurait pas été très sage d’aller me promener en brousse aussi ai-je préféré rendre visite à un vieux marabout dont on m’avait parlé . Il avait bien quatre-vingt-dix ans et me reçut avec amabilité sur le seuil de sa case. Je lui avais apporté une boite de lait condensé et j’essayais d’évoquer ses souvenirs mais sa mémoire me paraissait assez confuse .
Je n’avais plus qu’à revenir au campement m’y livrer aux délices de la douche à la calebasse en versant sur ma tête des flots d’eau chaude tout imprégnée d’une odeur de bois brûlé et de décoctions végétales ; puis à déguster ma pintade qui se révéla plutôt coriace.
Le lendemain, aux premières heures, notre équipe était déjà en route . J’avançais sans trop de peine, mes samaras aux pieds, l’esprit préoccupé toutefois par la réparation d’Hodonou dont la solidité me laissait sceptique . Voyant que le terrain était plat et que la piste était recouverte d’une couche de sable moelleux et digne d’une plage de l’Atlantique, je pris la résolution de marcher pieds-nus . Tous mes hommes agissaient ainsi ; pourquoi ne pas les imiter ?
C’était une idée vraiment géniale . Jamais je ne m’étais senti aussi léger . Mes pas alertes m’entraînaient sur un chemin bordé de hautes herbes . Je tenais la tête de la colonne, laissant derrière moi mes co-équipiers au point que Salifou, qui portait toujours mon fusil, avait été obligé de courir pour me rattraper .
Pourquoi ne pas avoir envisagé plus tôt cette solution ? C’était simple et efficace . A quoi bon s’embarrasser de chaussures servitudes de notre prétendue civilisation ?
Mais le retour à la nature ne s’effectue pas sans une préparation soigneuse et un entraînement progressif ! J’en acquis la preuve assez rapidement… Une certaine gêne, qui se transformait peu à peu en sensation de brûlure, attaquait sournoisement la plante de mes pieds . Elle rongeait les talons, grignotait l’appui antérieur des têtes métatarsiennes, érodait le bord externe ainsi que la pulpe des orteils
J’étais bien contraint de ralentir mon allure . A l’exception de Louis Atayi, tous mes hommes me dépassèrent un à un . puis ce fut le tour des porteurs . Chaque pas me faisait de plus en plus cruellement souffrir .
J’essayais de remettre mes samaras mais cela ne me procura qu’un répit de quelques minutes . Aussi n’avais-je recours que de faire des haltes de plus en plus fréquentes et c’est en m’appuyant sur les épaules de Gabriel et d’Atayi que j’ai fait mon entrée dans le village de Djerekpana .
La situation était fort déplaisante pour mon amour-propre qui en pâtissait autant que mes pieds . Qu’était-il donc devenu ce jeune Médecin-Lieutenant, quelque peu écervelé, qui le mois précédent était entré dans le village de Bafilo sur un cheval au galop, l’avait arrêté net et avait sauté à terre sous l’œil poliment ironique du vieux Chef de Canton qui en avait vu bien d’autres ?..
J’avais beau me redresser et sourire, je croyais deviner une moquerie dissimulée sous les masques graves des gens qui étaient venus m’accueillir .
Mais l’hospitalité africaine n’est pas un vain mot et le Chef de Village avait du savoir-vivre .
Il fit remplir une calebasse de « chapalo », la bière de mil, fit goûter le breuvage à son policier pour bien montrer que je pourrais boire en toute sécurité puis il me tendit la calebasse .
C’était frais, piquant et très agréable au goût . Après en avoir bu, j’ai passé la calebasse à Atayi qui but à son tour avant de la remettre à Gabriel . Ainsi passa-t-elle de mains en mains dans un ordre hiérarchique subtil jusqu’au dernier des porteurs . Il s’agissait-là d’un rite de bienvenue habituel en pays cotocoli, ce qui était fort appréciable après les fatigues d’une longue marche .
Je passais le reste de la journée sous « l’apatam », sorte de petit hangar en matériaux légers, que le Chef avait fait édifier . Les habitants étaient venus nombreux au rassemblement et nous pouvions également noter des gens venus des deux villages de la plaine que j’avais volontairement laissés en dehors de ma tournée Il y avait aussi une vingtaine de personnes vivant au Togo Britannique qui s’étaient présentés pour profiter de l’occasion .
La recherche systématique des ganglions sus-claviculaires nous fit découvrir deux trypanosomés que je décidais d’emmener avec moi à Sokodé .
Pour reprendre la route, le lendemain, je cherchais en vain un cheval . Il n’y en avait pas . Situation shakespearienne…
On me proposa de voyager en hamac . C’est à dire avec un pagne fixé aux deux extrémités d’une perche . Le passager s’installe à califourchon sur le pagne et deux solides porteurs, empoignant la perche par chaque bout, la placent sur leurs épaules ou leur tête et…en avant !
On ne peut pas dire que ce soit-là un moyen de transport très confortable . Les bords du pagne vous scient les cuisses, la tête heurte régulièrement la perche et les pieds qui pendent lamentablement, accrochent au passage broussailles et cailloux .
Même si les porteurs ne rythment point leur pas, il se produit un phénomène de résonance et de temps en temps l’ensemble se trouve secoué brusquement par des tressaillements qui risquent de vous désarçonner…
Et puis je dois bien avouer que je commençais à prendre du poids.. ce qui faisait la fierté de mon cuisinier mais ne facilitait pas la tâche des porteurs . Ceux-ci faiblissaient . Hodonou s’interposa et, se mettant lui-même à une des extrémités de la perche il put les remplacer à tour de rôle pour leur permettre de reprendre leur force .
Enfin mes pieds, mis au repos depuis vingt-quatre heures, me permirent d’effectuer les derniers kilomètres à la marche .
Le village de M’Boko qui marquait la fin de notre tournée de vaccination, n’était pas très peuplé aussi le travail se poursuivait-il sans hâte, me laissant tout le loisir de contempler la montagne qui se dressait devant moi avec la falaise rocheuse qu’il me faudrait escalader le jour suivant pour revenir à Fasao .
Cela me rendait songeur . Comment entreprendre ce retour ans trop de peine ?
Sous l’apatam mes infirmiers rangeaient le matériel en plaisantant . Gbati repliait soigneusement son tablier . Demain, le travail fini, nous retrouverons Sokodé .
C’est alors que l’image du tablier réveilla dans mon esprit des souvenirs de captivité . Ces tabliers ne serviraient plus ; j’allais donc les transformer en « chaussettes russes » et je pourrai enfin reprendre mes brodequins . Un essai immédiat s’étant avéré satisfaisant, c’est donc ainsi, le lendemain, que j’ai pu gravir sans ennui la falaise et effectuer la marche de vingt kilomètres qui nous ramena à Fasao où Salifou le chauffeur nous attendait dans la plus parfaite sérénité .
Quelques heures plus tard, l’auto grise me déposait devant ma case.