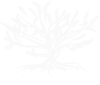Amérique 🗽 - Quand l'Amérique était Française
Les
premiers colons qui s'installèrent en Amérique du Nord le firent au nom
d'Henri IV. Le Canada - mais pas la France ! - commémore le quatrième
centenaire de cette épopée
Ce n'est, après tout, qu'une réunion de famille. Mais, comme les Nord-Américains donnent dans la démesure, ces retrouvailles entre cousins, à l'échelle d'un continent, font figure d'événement. Le mois dernier, à l'appel du Congrès mondial acadien, ils étaient près de 50 000, issus d'une centaine de lignées, à se retrouver, autour de la baie Sainte-Marie, dans l'est de la Nouvelle-Écosse, une des Provinces atlantiques du Canada. Venus des petits ports de la baie des Chaleurs, de la moiteur des bayous de Louisiane ou des banlieues de Montréal et de Boston, beaucoup étaient là pour célébrer, au son des violons et des accordéons, un anniversaire largement ignoré à Paris, celui de la fondation, il y a tout juste quatre siècles, du premier établissement permanent français en Amérique du Nord.
C'est aux États-Unis qu'il faut aujourd'hui se rendre pour avoir une idée de ce que fut le berceau de la francophonie américaine. A la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick, dans la baie de Fundy, les archéologues ont identifié l'îlot Sainte-Croix, où aborda, le 26 juin 1604, le protestant Pierre Du Gua de Monts, porteur d'une commission royale reçue d'Henri IV qui le nommait lieutenant-général pour «le Nouveau Monde» et surtout lui accordait le monopole sur la traite des fourrures. C'est sur ce caillou désolé, aujourd'hui territoire américain, privé d'eau, à 800 mètres des rives, qu'a commencé l'aventure d'où sont largement issus les 7 millions de francophones canadiens et les 8,3 millions d'Américains de souche française. Trois ans avant l'établissement des premiers colons anglais à Jamestown (Virginie), seize années avant l'arrivée, en 1620, des pèlerins du Mayflower à Plymouth, ce sont des Français qui, à défaut de la découvrir, ont créé l'Amérique. Le début fut désastreux. Les colons ne s'étaient pas préparés à affronter l'hiver, particulièrement rigoureux. Au point que les vents glacés font geler l'alcool. Les réserves de nourriture s'épuisent. Le scorbut cause une hécatombe. Sur les 80 occupants de Sainte-Croix, 36 ne survivent pas à l'hiver. Leur identité n'est pas connue, mais des échantillons d'ADN recueillis sur les ossements découverts pourraient indiquer l'origine géographique de ces premiers Franco-Américains. La relève, arrivée en juin 1605, sous la forme d'un navire transportant une quarantaine d'hommes, permet de reprendre l'exploration vers le sud, jusqu'à l'actuel cap Cod (États-Unis) avant que Du Gua et les siens (parmi lesquels le cartographe Samuel de Champlain) rebroussent chemin vers Sainte-Croix, abandonnée, à la fin de l'été, pour un autre site, en face, dans l'actuelle Nouvelle-Écosse, baptisé Port-Royal, qui sera le véritable point de départ de la colonisation.
Sainte-Croix fut élue pour son caractère défensif, contre une éventuelle attaque des Indiens de la région. Ce qui n'empêche pas, quatre siècles plus tard, dans le Canada multiculturel d'aujourd'hui, d'élargir la manifestation. «Initialement, on parlait de «célébration», indique Nathalie Gagnon, directrice de projet à l'agence Parcs Canada, dont les yeux ronds et les cheveux noirs et lisses évoquent une lointaine ascendance autochtone. Mais, désormais, nous préférons envisager cet anniversaire comme une «commémoration» à laquelle d'ailleurs les Indiens sont associés. C'est le moins qu'on puisse faire. Car il ne faut pas oublier que le mode de vie des Indiens a été bousculé...» Une cérémonie de purification a donc eu lieu, en l'honneur des mânes des ancêtres des 20 000 Indiens Micmac. Pour dissimuler les malentendus, on a brûlé de la sauge et du tabac. Il est vrai que la dernière étymologie à la mode recourt à la langue indigène : Acadie, au lieu d'être une déformation de la mythique Arcadie, serait une déformation d'eggadi, «l'endroit d'ici» en micmac... Commémorer les grands événements de l'Histoire dans un pays neuf comme le Canada n'est pas chose aisée. Célèbre-t-on d'ailleurs la même chose avec ce 400e anniversaire? S'agit-il de fêter «les premiers jalons de la présence française en Amérique», comme l'a indiqué, le 26 juin, lors d'une cérémonie à Bayside, le Premier ministre canadien, Paul Martin ? Mais, si c'est le cas, pourquoi une telle discrétion de la part des autorités françaises, représentées sur place par le seul ministre délégué à la Francophonie, Xavier Darcos ? Et comment comprendre, en outre, le faible écho rencontré au Québec, seule juridiction canadienne à majorité francophone ? Et les Indiens, devraient-ils porter le deuil ?
1604-2004: l'anniversaire donne lieu, en réalité, à une véritable bataille des mémoires où les enjeux politiques viennent bousculer le calendrier historique. Pour la minorité acadienne d'aujourd'hui, ces francophones installés sur la façade atlantique du Canada et longtemps écrasés par la majorité anglophone, c'est l'occasion d'affirmer son renouveau. Car le destin de ces descendants de paysans des Charentes et de la Saintonge, envoyés, à l'initiative de Richelieu, coloniser le Nouveau Monde se résuma, pendant des générations, à un chant douloureux de défaites et d'abandons. En cent-cinquante ans à peine, aux XVIIe et XVIIIe siècles, ces «défricheurs d'eau» avaient pourtant réussi à mettre en valeur les terres alluviales en profitant des très fortes marées de la baie de Fundy (alors Baie française). Mais le choc des guerres franco-anglaises en Europe les frappe à leur tour. Alors qu'ils sont passés sous le contrôle de la Couronne britannique après le traité d'Utrecht, en 1713 (avec la baie d'Hudson et Terre-Neuve), et malgré leur neutralité proclamée, les 13 000 Acadiens de la Nouvelle-Écosse sont finalement déportés le 28 juillet 1755 et dispersés dans toute l'Amérique, et même au-delà, jusqu'en France. Leurs maisons sont brûlées pour décourager tout retour. C'est le Grand Dérangement. Certains reviendront dans les années suivantes, tous garderont le souvenir douloureux de cet arrachement au «vieux pays», au pays perdu. «Nous sommes probablement le seul peuple au monde capable de célébrer une déportation, rappelle l'écrivain Antonine Maillet. Il a fallu apporter la démonstration que nous étions bien vivants.» Aujourd'hui, on estime à environ 40 000 les Acadiens de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Edouard (soit 4% de la population). «Notre projet de société, explique Jean Léger, directeur général de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, c'est de ne pas disparaître au sein du melting-pot canadien et américain. On est le petit village gaulois, mais sans potion magique.»
À la différence du Nouveau-Brunswick voisin, où les Acadiens, forts de leur poids démographique (plus d'un tiers de la population, soit 250 000 habitants) ont obtenu, pour le français, un statut de langue officielle auprès du gouvernement provincial, les francophones de Nouvelle-Écosse et de la province de l'Ile-du-Prince-Edouard peinent à faire valoir leurs droits auprès des instances locales. Sans parler de la menace d'assimilation : entre les recensements de 1996 et de 2001, par le jeu des mariages mixtes ou des départs, la communauté acadienne a perdu 1 000 de ses membres.
Majoritaires, les Canadiens Anglais des Provinces maritimes n'ont pas la même perspective. À en croire la presse anglophone, 2004 ne serait rien d'autre que la commémoration de «la visite de Samuel de Champlain» (The Nova Scotian Sunday Herald du 2 mai 2004), le voyage d'un aimable explorateur émerveillé par les nouvelles espèces d'oiseaux, ravi par le fumet d'un nez d'orignal bouilli ou d'une queue de castor braisée... «Il y a encore six ans, l'université de Halifax ne dispensait pas l'enseignement de l'histoire avant 1749 [date de la création de la ville], rappelle Jean Léger. J'y vois plutôt l'expression d'une méconnaissance qu'une volonté délibérée d'occulter notre passé.» Va donc pour l'indifférence! «Tout ce qu'ils retiennent de notre culture, c'est notre amour de la musique, de la bonne chère, de la fête», soupire Vaughan Madden, directrice générale du Congrès mondial des Acadiens 2004. L'humeur des Acadiens des Maritimes n'est pourtant pas au ressentiment. Il est significatif que l'action intentée contre la reine Elisabeth pour demander une repentance à propos de la déportation de 1755 ait été le fait d'un avocat américain, natif de Lafayette, en Louisiane, Warren Perrin.
Après une longue négociation, le gouvernement d'Ottawa a fini par relayer officiellement cette requête à Londres. Et le 9 décembre 2003, Elisabeth, «reine du Canada», a adressé une «proclamation» à ses «féaux sujets». «Reconnaiss[ant] les épreuves et souffrances subies par les Acadiens lors du Grand Dérangement» et «souhait[ant] que les Acadiens puissent tourner la page sur cette période sombre de leur histoire», la reine, «sur et avec l'avis de Notre conseil privé pour le Canada», a désigné le 28 juillet comme «Journée de commémoration du Grand Dérangement». Prudente, Elisabeth a pris soin, néanmoins, d'écarter explicitement toute «reconnaissance de responsabilité juridique ou financière». Parce que le texte paraît être rédigé par la reine, mais qu'il est signé par le gouverneur général Adrienne Clarkson, la Société nationale de l'Acadie a déjà demandé que, l'an prochain, pour le 250e anniversaire de la déportation, Elisabeth lise cette proclamation en public. A suivre...
Ce premier geste de la Couronne représente, toutefois, une petite victoire pour le pouvoir fédéral, qui a, au moins, un triple intérêt à soigner ces francophones de l'Atlantique, comme l'atteste son soutien financier aux fêtes acadiennes, lequel tranche avec la pingrerie des autorités provinciales. D'abord, pour souligner le caractère bilingue du pays. Parce que Pierre Elliott Trudeau a fait du Canada un État multiculturel et que les nouveaux Canadiens (plus de 200 000 immigrants arrivent chaque année) ignorent cette histoire, il est nécessaire de rappeler le compromis passé au XIXe siècle qui veut que la création du Canada moderne repose sur «deux peuples fondateurs», les Français et les Anglais. Ensuite, parce que l'occasion est belle de signifier au grand voisin états-unien, dont les Canadiens craignent à juste titre l'emprise, cette singularité. Nombre de Canadiens anglais de l'Ontario restent attachés à ce particularisme parce qu'ils y voient justement le meilleur rempart contre le risque d'annexion rampante qu'implique le formidable pouvoir d'attraction de l'hyperpuissance. «La résistance de la culture acadienne est source de fierté nationale et de reconnaissance internationale», a ainsi déclaré le Premier ministre Paul Martin. Comme, en somme, une reproduction, à un échelon local, de cette même aspiration canadienne à continuer à exister à côté des États-Unis. Le troisième objectif des autorités fédérales, à Ottawa, enfin, est de convaincre les nationalistes québécois qu'ils ne détiennent pas le monopole de l'aventure française au Canada, mais que celle-ci s'identifie à l'ensemble du pays.
Car, dans la Belle Province, quand on parle du «400e», c'est pour évoquer... 2008. L'anniversaire de la fondation de la ville de Québec par Champlain. Le vrai point de départ, aux yeux des Québécois. «Les commémorations ont toujours été l'objet de récupérations politiques, explique l'historien Jacques Lacoursière. En 1908, le 300e est placé sous le signe des retrouvailles. Une souscription est lancée pour acheter le champ de bataille des plaines d'Abraham (à la suite de laquelle les Anglais, vainqueurs, prennent Québec) et, dans le défilé avec costumes d'époque, les deux personnages qui représentent le général britannique Wolfe et le Français Montcalm avancent, bras dessus, bras dessous ! En 1967, pour le centenaire de la Confédération, les indépendantistes dénoncent ''cent ans d'injustices''.»
Les Canadiens peuvent-ils avoir en commun une même histoire nationale? «J'ai participé à sept débats sur ce sujet !» sourit Jacques Lacoursière. En 1967, une tentative de rédiger un manuel scolaire commun, sous la houlette d'historiens francophones et anglophones, aboutit à un ouvrage. Canada, unity in diversity est le titre anglais. Canada, unité et diversité est le titre français, ce qui n'est pas du tout la même chose... Déterminer qui a découvert le Canada reste un débat ouvert : pour les francophones, c'est Jacques Cartier, bien sûr, le premier à explorer la côte orientale du continent. Mais pour la province de Terre-Neuve, qui a célébré, en 1997, le 500e anniversaire de son débarquement, c'est Giovanni Cabotto (Jean Cabot), un marin au service du roi d'Angleterre... Il reste possible que, avant eux, des marins de Bristol aient abordé la région. Et puis, bien avant, il y a les Vikings... L'histoire du Canada ne commence pas à la même date pour tout le monde. Selon son origine, selon la province où on réside, les repères changent.
L'histoire de l'Ontario commence en 1791. Les Québécois ignorent celle des Prairies et de l'Alberta, plus récente encore. Et le Canada anglais sous-estime l'extraordinaire aventure des explorateurs canadiens français. Les implications politiques de ce brouillage sont évidentes. «Le Canada est-il une fédération de trois nations (canadienne anglaise, canadienne française [ou québécoise], amérindienne) ou une société multiculturelle avec deux langues officielles? interroge Jack Jedwab, directeur exécutif à l'Association des études canadiennes. C'est un pays aux histoires multiples qui s'accommode de cette cohabitation et se retrouve d'abord sur des valeurs.» Interrogés dans les sondages, les Canadiens répondent ainsi que «l'histoire du Canada est d'abord une histoire d'accroissement du multiculturalisme», puis celle de «l'établissement d'un filet de sécurité sociale». La moitié de la population compte, il est vrai, un parent ou un grand-parent né à l'étranger. Les Québécois, eux, sont divisés quand on leur demande de choisir «l'événement le plus important dans l'histoire du Canada»: pour les souverainistes, c'est la défaite des plaines d'Abraham ; pour les fédéralistes, c'est l'établissement de la Charte des droits et libertés en 1982 et le droit de vote accordé aux femmes au niveau fédéral en 1918.
La mémoire collective française, elle, a choisi de se réfugier dans l'amnésie. «La France ne s'intéresse guère à la Nouvelle-France», constate Jean-Pierre Hardy, conservateur au musée des Civilisations d'Ottawa qui abrite, jusqu'en avril 2005, une vaste exposition sur l'Amérique du Nord sous le régime français et la naissance d'une société originale. Qui se souvient encore, chez nous, des épopées de Jean Talon, Louis Buade de Frontenac, Pierre Le Moyne d'Iberville, Antoine Laumet Lamothe Cadillac? Qui sait que Saint-Louis, Baton-Rouge, Detroit ont été fondés par des Français ? «Cette histoire est quasi absente des programmes scolaires et très peu étudiée à l'université», notent dans un ouvrage passionnant, Histoire de l'Amérique française, Gilles Havard et Cécile Vidal (Flammarion) (1). Et pourtant... «La France possédait autrefois, dans l'Amérique septentrionale, un vaste empire qui s'étendait depuis le Labrador jusqu'aux Florides, et depuis les rivages de l'Atlantique jusqu'aux lacs les plus reculés du haut Canada», écrit Chateaubriand dans la préface d'Atala. Mais la monarchie a préféré, en 1763, les «îles à sucre» des Antilles à «ce pays couvert de glaces huit mois de l'année, habité par des barbares, des ours et des castors», selon la formule de Voltaire. Et le Premier consul, tout attaché à son rêve d'unité européenne, brade, dans l'indifférence, quarante ans plus tard, l'immense Louisiane à la jeune république américaine. Longtemps oubliée, la forteresse de Louisbourg (île du Cap-Breton), le Gibraltar de l'Amérique du Nord, fondée en 1713 par les Français et conquise par les Anglais en 1758, n'est restaurée, en 1928, qu'à l'initiative d'une riche Américaine de Boston. En 2004, la France bâtit à Brouage (Charente-Maritime), patrie de Champlain, un musée et un centre de documentation. La République a versé son écot pour la numérisation des archives de la Nouvelle-France. Et on tourne une coproduction franco-canadienne avec Gérard Depardieu et Vincent Perez. C'est tout. Les Français semblent ignorer qu'il est des défaites malgré tout glorieuses.
Ce n'est, après tout, qu'une réunion de famille. Mais, comme les Nord-Américains donnent dans la démesure, ces retrouvailles entre cousins, à l'échelle d'un continent, font figure d'événement. Le mois dernier, à l'appel du Congrès mondial acadien, ils étaient près de 50 000, issus d'une centaine de lignées, à se retrouver, autour de la baie Sainte-Marie, dans l'est de la Nouvelle-Écosse, une des Provinces atlantiques du Canada. Venus des petits ports de la baie des Chaleurs, de la moiteur des bayous de Louisiane ou des banlieues de Montréal et de Boston, beaucoup étaient là pour célébrer, au son des violons et des accordéons, un anniversaire largement ignoré à Paris, celui de la fondation, il y a tout juste quatre siècles, du premier établissement permanent français en Amérique du Nord.
C'est aux États-Unis qu'il faut aujourd'hui se rendre pour avoir une idée de ce que fut le berceau de la francophonie américaine. A la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick, dans la baie de Fundy, les archéologues ont identifié l'îlot Sainte-Croix, où aborda, le 26 juin 1604, le protestant Pierre Du Gua de Monts, porteur d'une commission royale reçue d'Henri IV qui le nommait lieutenant-général pour «le Nouveau Monde» et surtout lui accordait le monopole sur la traite des fourrures. C'est sur ce caillou désolé, aujourd'hui territoire américain, privé d'eau, à 800 mètres des rives, qu'a commencé l'aventure d'où sont largement issus les 7 millions de francophones canadiens et les 8,3 millions d'Américains de souche française. Trois ans avant l'établissement des premiers colons anglais à Jamestown (Virginie), seize années avant l'arrivée, en 1620, des pèlerins du Mayflower à Plymouth, ce sont des Français qui, à défaut de la découvrir, ont créé l'Amérique. Le début fut désastreux. Les colons ne s'étaient pas préparés à affronter l'hiver, particulièrement rigoureux. Au point que les vents glacés font geler l'alcool. Les réserves de nourriture s'épuisent. Le scorbut cause une hécatombe. Sur les 80 occupants de Sainte-Croix, 36 ne survivent pas à l'hiver. Leur identité n'est pas connue, mais des échantillons d'ADN recueillis sur les ossements découverts pourraient indiquer l'origine géographique de ces premiers Franco-Américains. La relève, arrivée en juin 1605, sous la forme d'un navire transportant une quarantaine d'hommes, permet de reprendre l'exploration vers le sud, jusqu'à l'actuel cap Cod (États-Unis) avant que Du Gua et les siens (parmi lesquels le cartographe Samuel de Champlain) rebroussent chemin vers Sainte-Croix, abandonnée, à la fin de l'été, pour un autre site, en face, dans l'actuelle Nouvelle-Écosse, baptisé Port-Royal, qui sera le véritable point de départ de la colonisation.
Sainte-Croix fut élue pour son caractère défensif, contre une éventuelle attaque des Indiens de la région. Ce qui n'empêche pas, quatre siècles plus tard, dans le Canada multiculturel d'aujourd'hui, d'élargir la manifestation. «Initialement, on parlait de «célébration», indique Nathalie Gagnon, directrice de projet à l'agence Parcs Canada, dont les yeux ronds et les cheveux noirs et lisses évoquent une lointaine ascendance autochtone. Mais, désormais, nous préférons envisager cet anniversaire comme une «commémoration» à laquelle d'ailleurs les Indiens sont associés. C'est le moins qu'on puisse faire. Car il ne faut pas oublier que le mode de vie des Indiens a été bousculé...» Une cérémonie de purification a donc eu lieu, en l'honneur des mânes des ancêtres des 20 000 Indiens Micmac. Pour dissimuler les malentendus, on a brûlé de la sauge et du tabac. Il est vrai que la dernière étymologie à la mode recourt à la langue indigène : Acadie, au lieu d'être une déformation de la mythique Arcadie, serait une déformation d'eggadi, «l'endroit d'ici» en micmac... Commémorer les grands événements de l'Histoire dans un pays neuf comme le Canada n'est pas chose aisée. Célèbre-t-on d'ailleurs la même chose avec ce 400e anniversaire? S'agit-il de fêter «les premiers jalons de la présence française en Amérique», comme l'a indiqué, le 26 juin, lors d'une cérémonie à Bayside, le Premier ministre canadien, Paul Martin ? Mais, si c'est le cas, pourquoi une telle discrétion de la part des autorités françaises, représentées sur place par le seul ministre délégué à la Francophonie, Xavier Darcos ? Et comment comprendre, en outre, le faible écho rencontré au Québec, seule juridiction canadienne à majorité francophone ? Et les Indiens, devraient-ils porter le deuil ?
1604-2004: l'anniversaire donne lieu, en réalité, à une véritable bataille des mémoires où les enjeux politiques viennent bousculer le calendrier historique. Pour la minorité acadienne d'aujourd'hui, ces francophones installés sur la façade atlantique du Canada et longtemps écrasés par la majorité anglophone, c'est l'occasion d'affirmer son renouveau. Car le destin de ces descendants de paysans des Charentes et de la Saintonge, envoyés, à l'initiative de Richelieu, coloniser le Nouveau Monde se résuma, pendant des générations, à un chant douloureux de défaites et d'abandons. En cent-cinquante ans à peine, aux XVIIe et XVIIIe siècles, ces «défricheurs d'eau» avaient pourtant réussi à mettre en valeur les terres alluviales en profitant des très fortes marées de la baie de Fundy (alors Baie française). Mais le choc des guerres franco-anglaises en Europe les frappe à leur tour. Alors qu'ils sont passés sous le contrôle de la Couronne britannique après le traité d'Utrecht, en 1713 (avec la baie d'Hudson et Terre-Neuve), et malgré leur neutralité proclamée, les 13 000 Acadiens de la Nouvelle-Écosse sont finalement déportés le 28 juillet 1755 et dispersés dans toute l'Amérique, et même au-delà, jusqu'en France. Leurs maisons sont brûlées pour décourager tout retour. C'est le Grand Dérangement. Certains reviendront dans les années suivantes, tous garderont le souvenir douloureux de cet arrachement au «vieux pays», au pays perdu. «Nous sommes probablement le seul peuple au monde capable de célébrer une déportation, rappelle l'écrivain Antonine Maillet. Il a fallu apporter la démonstration que nous étions bien vivants.» Aujourd'hui, on estime à environ 40 000 les Acadiens de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Edouard (soit 4% de la population). «Notre projet de société, explique Jean Léger, directeur général de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, c'est de ne pas disparaître au sein du melting-pot canadien et américain. On est le petit village gaulois, mais sans potion magique.»
À la différence du Nouveau-Brunswick voisin, où les Acadiens, forts de leur poids démographique (plus d'un tiers de la population, soit 250 000 habitants) ont obtenu, pour le français, un statut de langue officielle auprès du gouvernement provincial, les francophones de Nouvelle-Écosse et de la province de l'Ile-du-Prince-Edouard peinent à faire valoir leurs droits auprès des instances locales. Sans parler de la menace d'assimilation : entre les recensements de 1996 et de 2001, par le jeu des mariages mixtes ou des départs, la communauté acadienne a perdu 1 000 de ses membres.
Majoritaires, les Canadiens Anglais des Provinces maritimes n'ont pas la même perspective. À en croire la presse anglophone, 2004 ne serait rien d'autre que la commémoration de «la visite de Samuel de Champlain» (The Nova Scotian Sunday Herald du 2 mai 2004), le voyage d'un aimable explorateur émerveillé par les nouvelles espèces d'oiseaux, ravi par le fumet d'un nez d'orignal bouilli ou d'une queue de castor braisée... «Il y a encore six ans, l'université de Halifax ne dispensait pas l'enseignement de l'histoire avant 1749 [date de la création de la ville], rappelle Jean Léger. J'y vois plutôt l'expression d'une méconnaissance qu'une volonté délibérée d'occulter notre passé.» Va donc pour l'indifférence! «Tout ce qu'ils retiennent de notre culture, c'est notre amour de la musique, de la bonne chère, de la fête», soupire Vaughan Madden, directrice générale du Congrès mondial des Acadiens 2004. L'humeur des Acadiens des Maritimes n'est pourtant pas au ressentiment. Il est significatif que l'action intentée contre la reine Elisabeth pour demander une repentance à propos de la déportation de 1755 ait été le fait d'un avocat américain, natif de Lafayette, en Louisiane, Warren Perrin.
Après une longue négociation, le gouvernement d'Ottawa a fini par relayer officiellement cette requête à Londres. Et le 9 décembre 2003, Elisabeth, «reine du Canada», a adressé une «proclamation» à ses «féaux sujets». «Reconnaiss[ant] les épreuves et souffrances subies par les Acadiens lors du Grand Dérangement» et «souhait[ant] que les Acadiens puissent tourner la page sur cette période sombre de leur histoire», la reine, «sur et avec l'avis de Notre conseil privé pour le Canada», a désigné le 28 juillet comme «Journée de commémoration du Grand Dérangement». Prudente, Elisabeth a pris soin, néanmoins, d'écarter explicitement toute «reconnaissance de responsabilité juridique ou financière». Parce que le texte paraît être rédigé par la reine, mais qu'il est signé par le gouverneur général Adrienne Clarkson, la Société nationale de l'Acadie a déjà demandé que, l'an prochain, pour le 250e anniversaire de la déportation, Elisabeth lise cette proclamation en public. A suivre...
Ce premier geste de la Couronne représente, toutefois, une petite victoire pour le pouvoir fédéral, qui a, au moins, un triple intérêt à soigner ces francophones de l'Atlantique, comme l'atteste son soutien financier aux fêtes acadiennes, lequel tranche avec la pingrerie des autorités provinciales. D'abord, pour souligner le caractère bilingue du pays. Parce que Pierre Elliott Trudeau a fait du Canada un État multiculturel et que les nouveaux Canadiens (plus de 200 000 immigrants arrivent chaque année) ignorent cette histoire, il est nécessaire de rappeler le compromis passé au XIXe siècle qui veut que la création du Canada moderne repose sur «deux peuples fondateurs», les Français et les Anglais. Ensuite, parce que l'occasion est belle de signifier au grand voisin états-unien, dont les Canadiens craignent à juste titre l'emprise, cette singularité. Nombre de Canadiens anglais de l'Ontario restent attachés à ce particularisme parce qu'ils y voient justement le meilleur rempart contre le risque d'annexion rampante qu'implique le formidable pouvoir d'attraction de l'hyperpuissance. «La résistance de la culture acadienne est source de fierté nationale et de reconnaissance internationale», a ainsi déclaré le Premier ministre Paul Martin. Comme, en somme, une reproduction, à un échelon local, de cette même aspiration canadienne à continuer à exister à côté des États-Unis. Le troisième objectif des autorités fédérales, à Ottawa, enfin, est de convaincre les nationalistes québécois qu'ils ne détiennent pas le monopole de l'aventure française au Canada, mais que celle-ci s'identifie à l'ensemble du pays.
Car, dans la Belle Province, quand on parle du «400e», c'est pour évoquer... 2008. L'anniversaire de la fondation de la ville de Québec par Champlain. Le vrai point de départ, aux yeux des Québécois. «Les commémorations ont toujours été l'objet de récupérations politiques, explique l'historien Jacques Lacoursière. En 1908, le 300e est placé sous le signe des retrouvailles. Une souscription est lancée pour acheter le champ de bataille des plaines d'Abraham (à la suite de laquelle les Anglais, vainqueurs, prennent Québec) et, dans le défilé avec costumes d'époque, les deux personnages qui représentent le général britannique Wolfe et le Français Montcalm avancent, bras dessus, bras dessous ! En 1967, pour le centenaire de la Confédération, les indépendantistes dénoncent ''cent ans d'injustices''.»
Les Canadiens peuvent-ils avoir en commun une même histoire nationale? «J'ai participé à sept débats sur ce sujet !» sourit Jacques Lacoursière. En 1967, une tentative de rédiger un manuel scolaire commun, sous la houlette d'historiens francophones et anglophones, aboutit à un ouvrage. Canada, unity in diversity est le titre anglais. Canada, unité et diversité est le titre français, ce qui n'est pas du tout la même chose... Déterminer qui a découvert le Canada reste un débat ouvert : pour les francophones, c'est Jacques Cartier, bien sûr, le premier à explorer la côte orientale du continent. Mais pour la province de Terre-Neuve, qui a célébré, en 1997, le 500e anniversaire de son débarquement, c'est Giovanni Cabotto (Jean Cabot), un marin au service du roi d'Angleterre... Il reste possible que, avant eux, des marins de Bristol aient abordé la région. Et puis, bien avant, il y a les Vikings... L'histoire du Canada ne commence pas à la même date pour tout le monde. Selon son origine, selon la province où on réside, les repères changent.
L'histoire de l'Ontario commence en 1791. Les Québécois ignorent celle des Prairies et de l'Alberta, plus récente encore. Et le Canada anglais sous-estime l'extraordinaire aventure des explorateurs canadiens français. Les implications politiques de ce brouillage sont évidentes. «Le Canada est-il une fédération de trois nations (canadienne anglaise, canadienne française [ou québécoise], amérindienne) ou une société multiculturelle avec deux langues officielles? interroge Jack Jedwab, directeur exécutif à l'Association des études canadiennes. C'est un pays aux histoires multiples qui s'accommode de cette cohabitation et se retrouve d'abord sur des valeurs.» Interrogés dans les sondages, les Canadiens répondent ainsi que «l'histoire du Canada est d'abord une histoire d'accroissement du multiculturalisme», puis celle de «l'établissement d'un filet de sécurité sociale». La moitié de la population compte, il est vrai, un parent ou un grand-parent né à l'étranger. Les Québécois, eux, sont divisés quand on leur demande de choisir «l'événement le plus important dans l'histoire du Canada»: pour les souverainistes, c'est la défaite des plaines d'Abraham ; pour les fédéralistes, c'est l'établissement de la Charte des droits et libertés en 1982 et le droit de vote accordé aux femmes au niveau fédéral en 1918.
La mémoire collective française, elle, a choisi de se réfugier dans l'amnésie. «La France ne s'intéresse guère à la Nouvelle-France», constate Jean-Pierre Hardy, conservateur au musée des Civilisations d'Ottawa qui abrite, jusqu'en avril 2005, une vaste exposition sur l'Amérique du Nord sous le régime français et la naissance d'une société originale. Qui se souvient encore, chez nous, des épopées de Jean Talon, Louis Buade de Frontenac, Pierre Le Moyne d'Iberville, Antoine Laumet Lamothe Cadillac? Qui sait que Saint-Louis, Baton-Rouge, Detroit ont été fondés par des Français ? «Cette histoire est quasi absente des programmes scolaires et très peu étudiée à l'université», notent dans un ouvrage passionnant, Histoire de l'Amérique française, Gilles Havard et Cécile Vidal (Flammarion) (1). Et pourtant... «La France possédait autrefois, dans l'Amérique septentrionale, un vaste empire qui s'étendait depuis le Labrador jusqu'aux Florides, et depuis les rivages de l'Atlantique jusqu'aux lacs les plus reculés du haut Canada», écrit Chateaubriand dans la préface d'Atala. Mais la monarchie a préféré, en 1763, les «îles à sucre» des Antilles à «ce pays couvert de glaces huit mois de l'année, habité par des barbares, des ours et des castors», selon la formule de Voltaire. Et le Premier consul, tout attaché à son rêve d'unité européenne, brade, dans l'indifférence, quarante ans plus tard, l'immense Louisiane à la jeune république américaine. Longtemps oubliée, la forteresse de Louisbourg (île du Cap-Breton), le Gibraltar de l'Amérique du Nord, fondée en 1713 par les Français et conquise par les Anglais en 1758, n'est restaurée, en 1928, qu'à l'initiative d'une riche Américaine de Boston. En 2004, la France bâtit à Brouage (Charente-Maritime), patrie de Champlain, un musée et un centre de documentation. La République a versé son écot pour la numérisation des archives de la Nouvelle-France. Et on tourne une coproduction franco-canadienne avec Gérard Depardieu et Vincent Perez. C'est tout. Les Français semblent ignorer qu'il est des défaites malgré tout glorieuses.
A lire aussi: Champlain, la naissance de l'Amérique française, par Raymonde Litalien et Denis Vaugeois, chez Septentrion et Nouveau Monde éditions.
Post-scriptum : Après trente-cinq ans de présence à Montréal, la prestigieuse équipe de base-ball des Expos a annoncé son déménagement à Washington
© 2004 L'Express.fr de notre envoyé spécial Jean-Michel Demetz