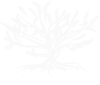Jacques Bourlaud 🩺 - Saint-Pierre et Miquelon
Le Journal Officiel, comme il le faisait alors le premier jour de chaque mois, avait publié le 1° Décembre 1949 le tableau du tour de départ outre-mer . Mon nom s’y trouvait inscrit .
A cette époque j’étais en service au 3° R.I.C. dans la région parisienne .
Je me suis donc précipité rue Oudinot, au Ministère de la France d’Outre-Mer, là où était installée la Direction du Service de Santé des Troupes Coloniales .
J’avais l’intention de voir un certain Médecin-Commandant et d’essayer d’obtenir de lui quelques lumières sur les divers postes susceptibles de m’être attribués . Peut-être s’en trouverait-il de vacants en A.E.F. et cela m’intéressait . En effet j’aurais souhaité me rapprocher de ma sœur aînée qui avait perdu son mari trois ans plus tôt et vivait à Bangui avec ses quatre fils .
Malheureusement le Médecin-Commandant était absent… Son secrétaire, près de qui je quêtais le renseignement à tout hasard, me confia que je n’avais pas à me tracasser car il y avait toujours, chaque mois, des postes disponibles pour l’A.E.F. .
Forts de cette affirmation, ma femme et moi, nous nous sommes précipités sur nos bagages, entassant dans les cantines et les caisses shorts, robes légères, moustiquaires, filtres « Esser », lampes à pression, guidés par l’expérience du premier séjour au Togo .
Le 27, date à laquelle devait être connue la désignation, je suis revenu rue Oudinot . Le Médecin-Commandant était là et me reçut d’un air jovial .
- Tiens !.. C’est Bourlaud !..
Quel heureux hasard !..
Eh bien vous partez à Saint Pierre et Miquelon…
- Il n’y avait donc pas de places pour l’A.E.F. ?
- Non ! Il n’y en avait que pour l’Extrême-Orient .
Alors avec vos quatre enfants…
Les caisses étaient déjà clouées ; elles sont parties avec tout notre équipement tropical et il nous a fallu, dans la dernière cantine, entasser les tricots, pantalons de ski et anoraks que nous avons dû acheter au dernier moment .
Nous avons traversé l’Atlantique à bord du « de Grasse » dans d’excellentes conditions ; la « French Line » étant alors réputée pour son confort et sa table .
A New York nous avons connu un certain succès . D’abord en déambulant dans la Cinquième Avenue à la recherche du Consulat de France accompagné d’un gendarme affecté, lui aussi, à Saint Pierre et Miquelon . Etant tous deux en uniforme les portiers d’hôtels se mettaient au garde à vous à notre passage et quelques Français s’arrêtaient un instant pour bavarder avec nous . Mais de plus, ma femme et moi, nous étions très remarqués dans la rue avec nos quatre enfants étagés de sept à deux ans et habillés à la mode française . En effet on voyait très peu d’enfants dans le centre de New York, les quartiers résidentiels étant périphériques . Les nôtres représentaient donc une attraction et, s’ils s’échappaient de notre vigilance au restaurant, nous les retrouvions au bar tenant une véritable conférence de presse devant des admirateurs qui leur offraient des jus de fruit .
Au bout de quarante-huit heures il nous a fallu prendre le train et nous sommes arrivés un beau matin à Montréal sous la neige .
La ville nous a plu . Nous avions trouvé un logement pratique . Il y avait de beaux magasins et on parlait français .
Comme nous avions appris que le bateau devant nous amener à Saint Pierre n’appareillerait pas avant une huitaine de jours, nous pensions naïvement pouvoir demeurer quelque temps à Montréal .
Hélas ! Le consulat avait déjà retenu nos places de chemin de fer et, le lendemain, nous roulions vers Halifax .
Trente-six heures dans un train confortable mais qui ne se presse pas, avançant sur un damier dont les cases blanches sont des étendues neigeuses et les cases noires des forêts de sapins et puis ce fut la découverte de Halifax, ville triste et laide, sans aucun cachet, que la grisaille et la neige sale de Février rendait encore plus sinistre .
Nous avons passé trois ou quatre jours à traîner nos semelles sans but précis devant les façades rébarbatives de maisons en briques . Au restaurant, nous pouvions apprécier la cuisine anglaise et lorsque, le gendarme ou moi, commandions du vin (d’ailleurs fort cher), nous étions considérés comme des suppôts de Satan… Pourtant dans les toilettes de l’hôtel, des tire-bouchons et des décapsuleurs étaient mis à la disposition de la clientèle…
Pourquoi donc cette hâte à nous expédier sur Halifax afin d’y attendre le bateau ?
Les fonctionnaires et militaires en transit dans un pays étranger ont droit à une indemnité journalière proportionnelle à leur grade et à leurs charges de famille . Elle est versée en devises du pays par les soins des consulats . Les consuls de New York et de Montréal préféraient donc nous garder le moins longtemps possible dans leurs villes et nous « refiler » à leur infortuné collègue de Halifax qui était bien obligé de nous accepter… Pour être juste, il faut dire que les ressortissants français en mission officielle étaient nombreux à New York et à Montréal alors que le consul d’Halifax ne voyait guère passer plus d’une dizaine de personnes se rendant à Saint Pierre .
Cette indemnité était même agrémentée d’un petit supplément . En effet les militaires en service ont droit à un quart de vin rouge au repas de midi et un autre au repas du soir. (Je crois que cette ration réglementaire a été réduite depuis quelques années). A l’étranger il n’est pas toujours possible de satisfaire à ce devoir national aussi, pendant la durée du voyage, avions-nous l’avantage, pour compenser cet état de manque, de percevoir chaque jour une prime représentant la valeur d’un demi-litre de vin rouge… L’épouse n’en recevait que la moitié et les enfants n’avaient droit à rien . Cette prime, qui avait été établie d’après le prix courant du vin avant la guerre de 1914, n’avait pas subi d’indexation en rapport avec les dévaluations successives…
Ce fait m’amène à ouvrir une parenthèse sur un sujet du même genre . Les officiers du Service de Santé des Armées qui sont appelés à servir dans la Santé Publique outre-mer (et maintenant à titre de la Coopération) sont placés en situation « hors cadres » ou « hors budget » . Assimilés dans une certaine mesure aux fonctionnaires civils, ils y gagnent quelques petits avantages mais ils en perdent d’autres . En particulier, à l’époque où cet état de choses était habituel, ils ne pouvaient plus prétendre à se voir attribuer d’ordonnance . Donc, s’ils ne voulaient pas cirer leurs chaussures eux-mêmes, ils se voyaient ans l’obligation d’engager un boy qu’ils payaient de leurs propres deniers . En conséquence il leur était généreusement accordé une indemnité pour leur permettre de faire face à cette dépense . Quand la décision a été prise, aux alentours de 1900, les tarifs du personnel de maison aux colonies étaient encore très modestes et une somme de 90 franc par mois suffisait largement . Mais cette somme n’a pas varié en dépit des fluctuations du franc… En 1960 elle a té convertie en 1,8O francs (= 90 francs C.F.A.) et s’est toujours maintenue à ce niveau si bien qu’en 1979, sur le bulletin de solde d’un Médecin-Général hors cadres, figurait encore, au milieu de chiffres nettement plus élevés, la rubrique : Indemnité de mise hors-cadres ….. 1,8O F…
Grâce à de tels appoints financiers je pouvais donc affronter sans crainte la rude vie des Terre-Neuvas…
Le premier contact fut effectivement assez rude puisque le « Miquelon », sur lequel nous avions pris place à Halifax, roulait bord sur bord et nous a déposés fort mal en point sur le quai de Saint Pierre .
Il a fallu l’accueil très amical de mon patron Alfred Salaün et toute la gentillesse de sa femme pour ramener le sourire sur nos visages .
La ville de Saint Pierre s’est, paraît-il, beaucoup transformée depuis cette époque . En 1950 elle se présentait sous l’aspect d’un gros bourg niché au fond d’une baie. Du port partaient cinq ou six rues, disposées un peu comme les rayons d’un éventail, qui suivaient le littoral ou s’enfonçaient à l’intérieur pour se perdre sur le flanc d’une petite hauteur s’élevant à moins de cent mètres au dessus du niveau de la mer . Des rues transversales complétaient l’ensemble, ménageant trois ou quatre espaces libres qui pouvaient être considérés comme des places .
Toutes les constructions étaient en bois sauf l’église et quelques édifices publics dont l’hôpital et les maisons des médecins .
L’hôpital était massif . Il avait été élevé au début du siècle à quelques mètres de l’ancien bâtiment en bois où Calmette avait travaillé lorsqu’il était médecin de Marine .Avec ses longs couloirs et ses salles communes, il ne répondait plus aux exigences modernes aussi son remplacement avait-il été envisagé et un chantier avait été ouvert tout à côté .
Le travail ne manquait pas . Nous étions quatre à l’assurer : deux médecins des Troupes Coloniales et deux médecins civils contractuels âgés, l’un étant en fonction à Miquelon , l’autre s’occupant à Saint Pierre de la Médecine Scolaire et de l’Hygiène Publique . C’est là, sous le regard d’Alfred Salaün que je me suis réellement orienté ers la Chirurgie et l’Obstétrique .
Nous étions assez bien équipés et pouvions effectuer un travail varié . Ce qui était nécessaire car les évacuations sanitaires étaient difficilement réalisables . La France était trop loin et les traitements au Canada sous la dépendance d’un déblocage de devises en faveur du malade .
Mon intention n’est pas de décrire la pathologie propre aux Saint-Pierrais mais j’ai toutefois été frappé par l’aspect flambant de quelques épidémies constatées à cette époque . Ce qui s’explique très bien par l’insularité établissant un barrage entre les habitants et le monde extérieur .
De ce fait les défenses naturelles de l’organisme ne se constituent pas et lorsqu’un virus est introduit, il rencontre des terrains neuf et s’en donne à cœur-joie (si l’on peut s’exprimer ainsi…) .
En 1949, une coqueluche s’est étendue des enfants aux adultes, faisant tousser lamentablement les solides pêcheurs de morues . En 1951, ce fut une grippe, heureusement sans gravité, qui a mis les trois-quarts de la population au lit pendant quinze jours . Peu après notre arrivée sur l’archipel s’est déclarée une épidémie d’oreillons qui a atteint toutes les tranches d’âge . Et là j’avoue être la proie du doute et des remords car je me demande si ce ne sont pas mes propres enfants qui en ont été l’origine… Ce qui me console c’est d’avoir appris plus tard qu’il y a eu autant de naissances, sinon plus, qu’autrefois…
Cependant la vie était assez austère et nous n’avions guère d’autres distractions que des réunions entre amis .
Nous ne pouvions pas pratiquer de sports d’hiver car le vent chassait la neige des sommets pour l’entasser dans des vallonnements et surtout parce que personne ne s’y intéressait vraiment pour nous guider par son expérience .
Il était possible de jouer au tennis si le temps le permettait. Mais c’était principalement la chasse à Langlade ou Miquelon et la pêche dans les étangs qui nous offraient des occasions de sortie .
Quelquefois des pêcheurs professionnels nous emmenaient en mer sur leurs doris pêcher la morue . C’étaient des journées bien remplies . Rendez-vous à deux heures du matin, chargement rapide du bateau, départ précipité en pleine nuit pour arriver aux bons endroits avant les concurrents, attente du petit jour au mouillage et enfin pêche avec une ligne dans chaque main . Cela mordait très bien et il n’y avait aucune finesse, ni pour ferrer ni pour amener des gros poissons . Mais il fallait sans arrêt les remonter un à un par cinquante mètres de fond . Il y avait-là de quoi durcir ses biceps en faisant ce métier tous les jours . Le retour s’effectuait vers deux heures de l’après-midi . Le pêcheur s’activait alors à « piquer, trancher et saler » trois ou quatre-cents kilos de morue . L’amateur, médecin, en était dispensé…
La pêche était artisanale . Fiers et individualistes les Saint-Pierrais préféraient être les maîtres sur leur doris, plutôt que de se plier à la discipline d’un équipage sur un bateau plus grand, surtout si un de leurs compatriotes devait commander . Toutefois, depuis cette époque, plusieurs chalutiers ont été armés, m’a-t-on dit.
Moyennant quoi ils prenaient de très belles morues qu’ils vendaient aux compagnies de Grande Pêche et cela leur permettait de vivre, bon an mal an, dans des conditions relativement satisfaisantes .
Mais tout le monde regrettait la grande époque de « la fraude » . Lorsque les Etats Unis et le Canada étaient au « régime sec », à Saint Pierre, territoire français, on pouvait importer autant d’alcool que l’on désirait . Les trafiquants n’avaient donc qu’à s’y approvisionner . Certains Saint-Pierrais ont pris de gros risques qui leur ont été profitables, tandis que la plupart des gens se sont contentés de décharger les bateaux ou, tout simplement, d’entreposer les caisses de whisky dans leurs hangars . La fin de la Prohibition a été ressentie comme une catastrophe à Saint Pierre et, la vie étant devenue dure, il a bien fallu reprendre les doris .
La Grande Pêche était représentée par des chalutiers de Fécamp ou de Bayonne qui faisaient escale de temps en temps lorsqu’ils avaient des malades à bord ou de grosses avaries de machine . Mais les capitaines, pour ne pas perdre trop de temps, préféraient relâcher dans les ports de Terre Neuve ou de la Nouvelle Ecosse qui offraient moins de tentations à leurs équipages.
En effet la vente d’alcool y était réglementée, voire même interdite, alors qu’à Saint Pierre c’était la belle vie . Il suffisait de s’éloigner du bord d’une vingtaine de mètres et on trouvait tout ce que l’on voulait .
« L’Aventure », un escorteur de la Marine Nationale, venait chaque année nous visiter . Chargé de l’assistance aux chalutiers français et de la police des Bancs de Terre Neuve, il se présentait quatre ou cinq fois entre Mars et Septembre . A chaque fois c’était une petite fête pour l’île . Invités à bord, nous y trouvions toujours des camarades que nous avions plus ou moins connus à l’Ecole de Santé Navale .
En 1951, le Gouverneur de Saint Pierre et Miquelon a reçu du commandant de « L’Aventure » un message où ce dernier disait qu’il avait été obligé, pour des raisons de santé, de débarquer son médecin à Saint Jean de Terre Neuve et qu’il faisait venir un remplaçant ; mais en attendant l’arrivée de celui-ci, pour ne pas perturber le programme établi de prise de contact avec les bateaux de pêche, il demandait si un médecin militaire en Service à Saint Pierre ne pouvait pas être mis à sa disposition .
Dans la bataille ou la tempête », le Marsouin est toujours prêt et j’ai donc fait un embarquement de quinze jours qui m’a promené de chalutier en chalutier.
J’ai pu faire à bord de « L’Aventure » des petites interventions chirurgicales . J’ai assisté avec beaucoup d’intérêt à des « traits » de chalutage et je suis monté à bord du dernier voiler français équipé pour la Grande Pêche . Le « Lieutenant René Guillon », qui a été désarmé l’année suivante, présentait un équipage d’hommes âgés qui pêchaient « à la corde », tout comme les Saint-Pierrais mais en plein Océan . Ils prenaient des morues énormes, plus belles que celles des chalutiers qui ne faisaient pas de choix et ramassaient le tout-venant .
Ce passage sur les Bancs m’avait valu la considération amicale des marins . Aussi l’année suivante, comme ma famille avait déjà quitté Saint Pierre et Miquelon depuis quelques semaines, ai-je demandé l’autorisation de rentrer en France à bord de « L’Aventure » . Ce qui me fut accordé très facilement.
Fin Septembre, la campagne de pêche étant presque terminée, « L’Aventure » n’avait plus qu’à effectuer une mission de représentation .
Nous sommes allés ainsi à Québec participer aux fêtes du centenaire de l’Université Laval . Puis nous avons traversé l’Atlantique en diagonale, passant en vue des Açores, pour faire escale à Lisbonne où nous sommes restés trois jours .
De là nous avons fait route sur Passajès où nous avons reçu un accueil chaleureux de la part des marins espagnols . Car c’était la première fois, depuis 1936, qu’un bateau de guerre français faisait une visite officielle dans leur pays .
En cette occasion, nous avons fait connaissance d’un jeune et sympathique Enseigne de Vaisseau répondant au nom de Cristobal Colon…C’était un authentique Grand d’Espagne qui avait hérité de son ancêtre, outre le nom, le titre d’Amiral de Castille. Il avait le droit, paraît-il, en certaines cérémonies, de revêtir un uniforme d’amiral et, vis à vis de son commandant, les rôles étaient inversés pendant quelques heures… (1)
Enfin « L’Aventure » m’a déposé à Brest oubliant résolument les brumes de Saint Pierre pour n’en conserver dans ma mémoire que le souvenir des jours ensoleillés.
(1) : J’ai appris qu’il avait été assassiné en Février 1996 .