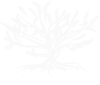Jacques Bourlaud 🩺 - Dahomey
C’est sur ces images colorées que j’arrête l’évocation de mon séjour à Madagascar puisque, quelque temps après, je suis revenu en Afrique Noire. Parakou, où je résidais alors, est la ville la plus importante dans le Nord du Dahomey qui ne s’appelait pas encore République Populaire du Bénin . Située à peu-près à la même latitude que Sokodé au Togo, dont la distance à vol d’oiseau est de deux-cents kilomètres à peine, j’essayais de me retremper dans l’atmosphère de mon premier séjour outre-mer.
Le paysage était le même : savane arborée parcourue par quelques galeries forestières avec, cependant, un terrain beaucoup plus accidenté au Togo. Les populations locales, islamisées des deux côtés de la frontière, avaient de nombreux points communs.
Mais l’ambiance était différente. Seize ans s’étaient écoulés et la décolonisation avait fait son œuvre.
Je n’étais plus Médecin-Chef de l’Hôpital mais seulement chef du service de chirurgie. Il y avait à Parakou un Directeur de l’Hôpital dahoméen, comme il y avait à Cotonou un Ministre de la Santé entouré de tout un appareil administratif presque entièrement entre les mains des Africains . C’était l’évolution logique des choses ; il fallait donc en prendre son parti et s’y habituer.
Le directeur était d’ailleurs plein de considération pour moi et m’accordait sans discuter tout ce dont j’avais besoin pour mon service ou pour mon logement. Mais je n’ai jamais su exactement comment il gérait son hôpital, n’ayant plus aucun droit de regard sur le budget.
De plus il était dur, et souvent injuste, envers le petit personnel qui venait, bien entendu, m’exposer ses doléances pour que j’intervienne en sa faveur. Mais ces choses-là s’arrangent toujours en Afrique si l’on a « la manière ».
Ce qui ne s’arrangeait pas c’était la situation politique du Dahomey. Les habitants de ce pays, surtout ceux du Sud, ont la réputation d’être intelligents et doués pour les études. Le Dahomey, surnommé Quartier Latin de l’Afrique, a donc vu en un demi-siècle se former une foule de fonctionnaires, secrétaires, comptables, commis d’administration, etc. qui ont constitué un personnel d’encadrement efficace dans tous les territoires français d’Afrique pendant la période coloniale. Avec l’indépendance de ces territoires presque tous les jeunes états ont expulsé purement et simplement les Dahoméens, les remplaçant par des cadres nationaux. Il en est résulté un afflux de rapatriés qui n’ont trouvé que très difficilement à se reclasser et ont formé une masse de chômeurs et de mécontents prêts à répondre à tous les mots d’ordre des agitateurs politiques.
Si on ajoute à cela un antagonisme manifeste entre les populations du Nord islamisés et les populations du Sud christianisées on conçoit que la tâche du gouvernement était plutôt malaisée. L’instabilité était chronique, les émeutes et les rébellions se déclenchaient pour le moindre prétexte.
Lorsque je suis arrivé à Parakou en Mai 1963, le pays était gouverné par une équipe ministérielle recrutée principalement dans le Nord . Puis il y a eu la « Révolution d’Octobre » qui a amené les gens du Sud au pouvoir. Quelques mois plus tard, nous avons vu un beau jour, circuler dans les rues de Parakou des personnages d’allure inquiétante armés de gourdins d’arc et de flèches. C’étaient les hommes de main d’une personnalité locale qui avait décidé de s’insurger et d’entraîner derrière lui tout le Nord dans un mouvement de sécession. Les individus en question choisissaient donc des gens du Sud comme cibles de leurs flèches ou bien se précipitaient sur eux pour les matraquer. Les Européens n’étaient pas inquiétés.
Toutefois, ne voulant pas courir le risque d’être confondu avec un autre, j’ai préféré me mettre en uniforme pour aller en ville récupérer le personnel infirmier sudiste et leurs familles pour mettre tout le monde à l'abri à l’intérieur de l’hôpital. Au volant de ma voiture j’ai pu ainsi circuler dans les quartiers insurgés. Il y avait par ci, par là quelques barricades en formation qui me forçaient à m’arrêter mais je trouvais toujours quelqu’un pour dégager le passage lorsqu’il m’avait reconnu.
Je pouvais également voir le travail des policiers, peu nombreux, qui se tenaient à une certaine distance des archers, hors de portée de leurs flèches et qui refoulaient lentement ceux-ci derrière les barricades.
Il y avait encore à cette époque, à Parakou, un détachement assez important de militaires français. L’officier qui les commandait m’a confié par la suite qu’il avait été sollicité par les deux partis pour intervenir ou du moins, donner des munitions. N’ayant reçu aucun ordre il a, bien entendu, refusé de se mêler de cette affaire, se contentant d’accueillir uniquement les blessés dans son camp.
Ainsi s’est passée la première journée mais le lendemain l’armée dahoméenne, venue de Cotonou, était sur place ouvrant le feu sur les rebelles. J’aurais voulu alors recommencer ce que j’avais fait la veille et récupérer mon personnel du Nord. Seulement les blessés sont arrivés en grand nombre à l’hôpital si bien que je n’ai pas pu quitter le bloc opératoire.
Dans la soirée tout était terminé. Plusieurs quartiers de la ville avaient été incendiés. J’ai vu passer devant moi une soixantaine de blessés et la morgue de l’hôpital a reçu plus de vingt cadavres. Nous n’avons jamais connu exactement le nombre de ceux qui ont réussi à s’échapper et qui étaient allés mourir en brousse.
Cependant, après ces heures tragiques, Parakou a repris peu à peu son visage habituel. J’ai eu la chance de pouvoir y travailler avec un personnel compétent dans un hôpital neuf. J’ai pu aussi profiter de la proximité du Togo pour revenir trois fois à Sokodé retrouver le cadre où j’avais vécu seize ans plus tôt.