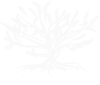Daniel Chauvigné ⌘ - Premier métier : menuisier ébéniste
L'atelier d'ébénisterie bien que vaste et fonctionnel, possède peu de machines-outils, alors que l'atelier de menuiserie en a beaucoup. En effet, traditionnellement, les ébénistes travaillent manuellement, car c’est un travail noble.
Tous les bois exotiques nécessaires à la fabrication sont empilés sur des entretoises afin de pouvoir sécher sans déformation, dans des hangars bien aérés, pendant plusieurs années avant d'être utilisés.
Le chef d'atelier, Monsieur SÖRG, est un géant blond, très jovial mais très pointilleux sur la qualité du travail. Après m'avoir appris à reconnaître l'essence des différents bois et le sens de leur fil, il m'a incité à acheter à crédit les différents outils qui me seront nécessaires pour l'exécution des travaux. Ce sont de très beaux outils dont l'acier suédois est de renommée mondiale.
Il m'apprit d'abord à les affûter, car leur coupe parfaite est garante d'une grande partie de la qualité du travail. Ensuite, j'ai dû apprendre à exécuter le plan coté et détaillé d'une caisse à couvercle et à séparation où chaque outil avait sa place. Enfin le grand jour est arrivé, j'ai commencé la fabrication de ma caisse à outils. Le tracé du bois, la découpe et l'assemblage m'ont pris huit jours. J'étais fier de mon œuvre, mais Monsieur Sörg m'a démontré qu'elle n'était pas parfaite :
- "Tu as un défaut d'équerrage ici, une mauvaise jointure là, un manque de colle sur le couvercle, la teinture de teinte inégale..."
J'étais d'autant plus consterné qu'il m'assura qu'un tel travail doit être exécuté en un seul jour !
- "Recommence jusqu'à ce que cela soit parfait", me dit-il en m'appliquant une tape amicale dans le dos et il partit avec un rire tonitruant.
Un vieil ouvrier noir qui travaillait sur un établi proche du mien vint me trouver et m'encourager et me prodiguer des conseils avisés.
En quatre jours ma caisse était terminée. J'avais gagné du temps et elle était mieux construite, mais le chef d'atelier trouva encore des défauts. Patiemment, je me remis à l'ouvrage, mais il fallut que je fabrique quatre caisses pour que mon chef soit satisfait et j'avais mis deux jours pour terminer la dernière...
Mon deuxième travail a été de confectionner une table de chevet. Je n'étais pas encore autorisé à utiliser les machines outils, non pas à cause du danger qu'elles procuraient, mais pour que je me perfectionne dans l'emploi des outils manuels. Là aussi, j'ai été obligé d'en faire trois avant que la dernière soit acceptée au contrôle.
En plus de l'étude des plans et du traçage, j'ai appris ensuite à organiser mes tâches afin de gagner du temps et d'acquérir plus de rentabilité.
Le chef prit alors soin de doser la difficulté de mes travaux successifs. C'est ainsi que j'ai fabriqué un lit, puis une table, avant de confectionner une chaise et un fauteuil. Petit à petit, j'ai amélioré la qualité de mon travail et diminué les temps d'exécution. J'ai pris de l'assurance et j'ai appris à me servir des machines-outils, sous le contrôle de Monsieur SORG encore plus pointilleux sur la sécurité que sur la qualité du travail. En effet, si l'utilisation des outils manuels très affûtés est dangereux, l'emploi des machines dont les lames tournent à des vitesses vertigineuses est bien plus périlleux. Il n'est pas rare qu'un menuisier perde un ou plusieurs doigts au cours de sa carrière. J'ai moi-même assisté à deux accidents : Un ouvrier s'est coupé une phalange avec une toupie; un autre avait monté à l'envers la lame d'une scie circulaire; lors de la mise en marche, l'écrou s'est divisé libérant la lame qui en vibrant s'est brisée et les morceaux ont traversés le toit. L'ouvrier s'en est tiré avec une profonde entaille à la mâchoire, cela aurait pu être plus grave et par chance personne d'autre n'a été blessé. Ces malheureux exemples et surtout les conseils et attentions de Monsieur SORG m'ont incité par la suite à prendre conscience du danger et à appliquer et faire suivre les consignes de sécurité dans tous les métiers où j'ai exercé.
Au bout de six mois, j'ai été autorisé à apprendre la marqueterie. L'incrustation d'ébène, d'ivoire, d'acajou et d'autres bois précieux est un travail très précis qui ne supporte aucune imperfection. La patience et la minutie comptent plus que le temps passé à l'exécution. La mesure et la découpe du bois doivent être exécutés avec une très grande précision, car le moindre défaut est décelable à la vue et au toucher. La finition au racloir d'acier et au papier de verre de plus en plus fin est un travail long et fastidieux, mais le plus dur est de réussir la teinture et le vernis au tampon qui doivent mettre en valeur le ton des différentes essences de bois utilisés.
J'ai compris alors pourquoi l'ébénisterie est un travail d'artiste, comparativement à la menuiserie.
Je loue Monsieur Sörg pour ses conseils et son souci du travail bien fait. C'est grâce à lui que j'ai pu acquérir une bonne dextérité manuelle, accentuer le calme naturel de mon caractère et affermir ma patience. Cela m'a beaucoup servi par la suite.
En un an, j'avais bien progressé, beaucoup retenu et après quelques années de pratique, je serais certainement devenu un bon ébéniste, car j'étais doué manuellement et je possédais un niveau intellectuel qui me permettait de comprendre et traiter les plans, les commandes et même la gestion. Hélas, j'ai du prématurément abandonner ce métier, ma mère ayant décidé de rejoindre l'Oubangui-Chari.
Voilà pourquoi ce premier métier, exercé peu de temps, ne m'a laissé que peu de souvenirs.
Quelques mois riches en anecdotes passèrent avant que je ne débute dans ce deuxième métier.
Monsieur TAMOUR, le capitaine du "FONDER", le plus gros bateau qui assure la liaison fluviale entre Brazzaville et Bangui, est, lui aussi, un ami de longue date de mes parents, ce qui nous a permis d'effectuer gratuitement la dernière remontée du fleuve avant la saison sèche ; saison où les eaux baissent au point de ne plus permettre la navigation.
Tels les mariniers, Tamout et son épouse vivent à bord de leur bateau. L'équipage est composé d'un pilote adjoint, d'un mécanicien et de huit manœuvres chargés d'approvisionner en bois la chaudière, d'entretenir le pont et les cabines. Un cuisinier et un marmiton tiennent la cambuse et préparent les repas. Six cabines peuvent accueillir une quinzaine de passagers.
Le bateau est très large et a un faible tirant d'eau, pour éviter l'ensablement sur les bas-fonds qui jonchent le fleuve. A l'arrière, mue par deux longues bielles latérales, une énorme roue à aubes propulse le navire dans un grand bruit de clapotis. Tout l'avant du pont inférieur est chargé de bois, pour l'alimentation de la chaudière du moteur qui est fixé au centre du bateau. Le restant du pont et l'étage intermédiaire servent à emmagasiner le fret. Le poste de pilotage, les cabines et la salle à manger-salon occupent tout le pont supérieur.
Il faut trois semaines pour remonter le fort courant jusqu'à Bangui. Pour éviter les embûches causées par les bancs de sable, les troncs d'arbres flottant en surface et parfois l'occupation du Congo ou de l’Oubangui par des troupeaux d'hippopotames, on jette l'ancre, la nuit près des rives. Cela permet également de dormir sans être gêné par le bruit du moteur et le clapotis de la roue à aubes.
Tous les trois jours, le bateau accoste près d'un petit village de pêcheurs qui, payés par la société maritime, sont chargés de couper et de stérer du bois de chauffage pour les bateaux à vapeur. Le chargement effectué par les villageois et l'équipage dure deux heures, ce qui donne le temps au capitaine et aux passagers volontaires d'aller chasser des perdrix et des pintades, voire une antilope, pour améliorer l'ordinaire. La pêche à la traîne, pendant la progression du bateau, est également un passe temps agréable et nous permet de manger fréquemment du poisson frais.
Le fleuve Congo et son affluent l'Oubangui sont très larges et bordés par une forêt très dense peuplée d'une grande variété d'animaux et surtout d'une foule de singes bruyants. On voit souvent des crocodiles paresser sur les bancs de sable, la gueule grande ouverte, pour permettre à de petits oiseaux d'aller recueillir les déchets de viande ou de poisson coincés entre leurs dents écartées. En effet, les sauriens n'ont pas de langue pour s'en débarrasser eux-mêmes et acceptent ces "cures dents" emplumés sans les dévorer, malgré leur férocité proverbiale.
Des orages fréquents déversent des trombes d'eau et la visibilité devient si mauvaise que le Capitaine est obligé de ralentir le bateau ; mais ces tornades ne durent jamais très longtemps et quelques minutes après leur passage, le ciel redevient serein et le soleil séche rapidement le pont.
Le niveau de l'affluent est très haut ce qui permet de franchir le seuil de Zinga, alors qu'en saison sèche, ce n'est plus possible pour les gros vapeurs comme le Fonder.
Zinga est un petit poste de brousse situé à une centaine de kilomètres de Bangui. D'une rive à l'autre, un seuil rocheux crève la surface de l'eau en créant des rapides tumultueux ; seule une passe permet le passage des bateaux lorsque les eaux sont assez hautes. Il faut mettre toute la puissance du moteur pour franchir le goulet où le courant a une forte accélération et soulève des vagues impressionnantes.
Enfin, nous sommes arrivés à Bangui, belle ville ombragée, étirée sur la plaine bordant l'Oubangui. A cet endroit, un imposant seuil rocheux barre entièrement la rivière jusqu'à la rive opposée du Congo Belge. Le Kassaï, une haute montagne boisée, chapeaute l'Est de la ville.
En 1933, la population blanche de Bangui était de cinq cents personnes, maintenant il y en a cinq mille. Les commerces et les banques rivalisent en nombre et en ampleur avec ceux des grandes villes de la côte africaine et il y a même trois grands hôtels-restaurants : "Le Palace", le "Roc club" et le "Pindéré" (splendide en sango). C'est dans ce dernier que nous avons logé quelques jours, avant de louer une petite maison, près de l'Oubangui.
Le Pindéré est situé face à l'Oubangui et de l'autre côté de la route, sur la berge, une grande terrasse couverte a été aménagée en bar et salle de bal. Après s'être restaurés en compagnie des Tamour, nous avons été prier sur la tombe de mon père. C’est une tombe blanche, très simple, portant une seule inscription : Serge CHAUVIGNE 1899 – 1946.
Mon frère Claude à hérité de papa le don des langues. Il parle déjà couramment l’allemand et possède de bonnes connaissances en anglais. Il s’est perfectionné très vite dans cette langue en fréquentant une famille de pasteurs américains qui a une mission protestante à huit kilomètres de la ville. Les VICKERS vivent ici depuis de nombreuses années et se sont liés d’amitié avec mes parents depuis longtemps. Les connaissances linguistiques de Claude lui ont permis de trouver un emploi dans une société d’import-export à Bangui.
J’ai trouvé aussi du travail comme chef d’équipe dans une entreprise de bâtiment. Mon rôle consiste à surveiller le chargement et le déchargement du sable que les manœuvres noirs puisent sur les bancs au milieu de la rivière. Le sable est chargé dans d’énormes pirogues, dont je contrôle le va-et-vient dans une petite pirogue manœuvrée par un jeune africain de mon âge. Lors de ces déplacements, tous les piroguiers chantent une mélopée itérative scandée par le mouvement des pagaies « O mound’jou, mou na b’bi guinza. Ah ! Ah !…(O blanc donne moi de l’argent Ah ! ah !…
Avec mes premières économies, j’ai acheté du bois pour construire la carcasse d’un kayak que j’ai recouverte d’un drap enduit de goudron. La pagaie double a étonné mes manœuvres qui n’ont que des pagaies simples. Cet esquif, insubmersible grâce aux caissons étanches placés à l’avant et à l’arrière, est très léger et se manœuvre très facilement. Je me suis servi de lui pour mon travail et, le soir, j’emmène souvent mon petit frère Bernard voguer sur le fleuve. Le courant au milieu de l’Oubangui est très fort, ce qui m’oblige à remonter le long de la berge lorsque je suis déporté en aval. Un soir, le Fonder était arrimé contre la berge et la largeur du bateau créait contre son flanc un courant que je n’ai pas pu remonter malgré une heure d’efforts. Nous avons été obligés de débarquer et de porter notre embarcation pour la remettre à l’eau à l’avant du vapeur. La nuit, qui tombe très vite sous les tropiques, nous a surpris et c’est dans la pénombre que nous avons rejoint la maison. Maman et Claude, très inquiets, m’ont sévèrement grondé et Claude a même menacé de brûler mon kayak. J’ai promis de ne plus être en retard et j’ai tenu parole par la suite.
En fin d’année 1948, nous avons quitté Bangui pour rejoindre Carnot avec un car de la STOCK, grosse compagnie de transport de la capitale. Nous nous sommes installés à WAYOMBO (le nid de l’aigle, en langue Baya) à dix kilomètres de Carnot. C’est le lieu où mon père avait acheté une concession de cinquante hectares et fait construire une maison en torchis.
Claude a été embauché comme chef d’un chantier de prospection de diamant dans la Société DULAS frères de Carnot. Je suis resté avec ma mère et mes petits frères à Wayombo pour diriger la plantation tandis que maman s’est occupée de l’instruction scolaire de Bernard, car il n’y avait pas d’école primaire à Carnot.
C’est là, comme planteur de tabac, que j’ai exercé mon deuxième métier.
Tous les bois exotiques nécessaires à la fabrication sont empilés sur des entretoises afin de pouvoir sécher sans déformation, dans des hangars bien aérés, pendant plusieurs années avant d'être utilisés.
Le chef d'atelier, Monsieur SÖRG, est un géant blond, très jovial mais très pointilleux sur la qualité du travail. Après m'avoir appris à reconnaître l'essence des différents bois et le sens de leur fil, il m'a incité à acheter à crédit les différents outils qui me seront nécessaires pour l'exécution des travaux. Ce sont de très beaux outils dont l'acier suédois est de renommée mondiale.
Il m'apprit d'abord à les affûter, car leur coupe parfaite est garante d'une grande partie de la qualité du travail. Ensuite, j'ai dû apprendre à exécuter le plan coté et détaillé d'une caisse à couvercle et à séparation où chaque outil avait sa place. Enfin le grand jour est arrivé, j'ai commencé la fabrication de ma caisse à outils. Le tracé du bois, la découpe et l'assemblage m'ont pris huit jours. J'étais fier de mon œuvre, mais Monsieur Sörg m'a démontré qu'elle n'était pas parfaite :
- "Tu as un défaut d'équerrage ici, une mauvaise jointure là, un manque de colle sur le couvercle, la teinture de teinte inégale..."
J'étais d'autant plus consterné qu'il m'assura qu'un tel travail doit être exécuté en un seul jour !
- "Recommence jusqu'à ce que cela soit parfait", me dit-il en m'appliquant une tape amicale dans le dos et il partit avec un rire tonitruant.
Un vieil ouvrier noir qui travaillait sur un établi proche du mien vint me trouver et m'encourager et me prodiguer des conseils avisés.
En quatre jours ma caisse était terminée. J'avais gagné du temps et elle était mieux construite, mais le chef d'atelier trouva encore des défauts. Patiemment, je me remis à l'ouvrage, mais il fallut que je fabrique quatre caisses pour que mon chef soit satisfait et j'avais mis deux jours pour terminer la dernière...
Mon deuxième travail a été de confectionner une table de chevet. Je n'étais pas encore autorisé à utiliser les machines outils, non pas à cause du danger qu'elles procuraient, mais pour que je me perfectionne dans l'emploi des outils manuels. Là aussi, j'ai été obligé d'en faire trois avant que la dernière soit acceptée au contrôle.
En plus de l'étude des plans et du traçage, j'ai appris ensuite à organiser mes tâches afin de gagner du temps et d'acquérir plus de rentabilité.
Le chef prit alors soin de doser la difficulté de mes travaux successifs. C'est ainsi que j'ai fabriqué un lit, puis une table, avant de confectionner une chaise et un fauteuil. Petit à petit, j'ai amélioré la qualité de mon travail et diminué les temps d'exécution. J'ai pris de l'assurance et j'ai appris à me servir des machines-outils, sous le contrôle de Monsieur SORG encore plus pointilleux sur la sécurité que sur la qualité du travail. En effet, si l'utilisation des outils manuels très affûtés est dangereux, l'emploi des machines dont les lames tournent à des vitesses vertigineuses est bien plus périlleux. Il n'est pas rare qu'un menuisier perde un ou plusieurs doigts au cours de sa carrière. J'ai moi-même assisté à deux accidents : Un ouvrier s'est coupé une phalange avec une toupie; un autre avait monté à l'envers la lame d'une scie circulaire; lors de la mise en marche, l'écrou s'est divisé libérant la lame qui en vibrant s'est brisée et les morceaux ont traversés le toit. L'ouvrier s'en est tiré avec une profonde entaille à la mâchoire, cela aurait pu être plus grave et par chance personne d'autre n'a été blessé. Ces malheureux exemples et surtout les conseils et attentions de Monsieur SORG m'ont incité par la suite à prendre conscience du danger et à appliquer et faire suivre les consignes de sécurité dans tous les métiers où j'ai exercé.
Au bout de six mois, j'ai été autorisé à apprendre la marqueterie. L'incrustation d'ébène, d'ivoire, d'acajou et d'autres bois précieux est un travail très précis qui ne supporte aucune imperfection. La patience et la minutie comptent plus que le temps passé à l'exécution. La mesure et la découpe du bois doivent être exécutés avec une très grande précision, car le moindre défaut est décelable à la vue et au toucher. La finition au racloir d'acier et au papier de verre de plus en plus fin est un travail long et fastidieux, mais le plus dur est de réussir la teinture et le vernis au tampon qui doivent mettre en valeur le ton des différentes essences de bois utilisés.
J'ai compris alors pourquoi l'ébénisterie est un travail d'artiste, comparativement à la menuiserie.
Je loue Monsieur Sörg pour ses conseils et son souci du travail bien fait. C'est grâce à lui que j'ai pu acquérir une bonne dextérité manuelle, accentuer le calme naturel de mon caractère et affermir ma patience. Cela m'a beaucoup servi par la suite.
En un an, j'avais bien progressé, beaucoup retenu et après quelques années de pratique, je serais certainement devenu un bon ébéniste, car j'étais doué manuellement et je possédais un niveau intellectuel qui me permettait de comprendre et traiter les plans, les commandes et même la gestion. Hélas, j'ai du prématurément abandonner ce métier, ma mère ayant décidé de rejoindre l'Oubangui-Chari.
Voilà pourquoi ce premier métier, exercé peu de temps, ne m'a laissé que peu de souvenirs.
Quelques mois riches en anecdotes passèrent avant que je ne débute dans ce deuxième métier.
Monsieur TAMOUR, le capitaine du "FONDER", le plus gros bateau qui assure la liaison fluviale entre Brazzaville et Bangui, est, lui aussi, un ami de longue date de mes parents, ce qui nous a permis d'effectuer gratuitement la dernière remontée du fleuve avant la saison sèche ; saison où les eaux baissent au point de ne plus permettre la navigation.
Tels les mariniers, Tamout et son épouse vivent à bord de leur bateau. L'équipage est composé d'un pilote adjoint, d'un mécanicien et de huit manœuvres chargés d'approvisionner en bois la chaudière, d'entretenir le pont et les cabines. Un cuisinier et un marmiton tiennent la cambuse et préparent les repas. Six cabines peuvent accueillir une quinzaine de passagers.
Le bateau est très large et a un faible tirant d'eau, pour éviter l'ensablement sur les bas-fonds qui jonchent le fleuve. A l'arrière, mue par deux longues bielles latérales, une énorme roue à aubes propulse le navire dans un grand bruit de clapotis. Tout l'avant du pont inférieur est chargé de bois, pour l'alimentation de la chaudière du moteur qui est fixé au centre du bateau. Le restant du pont et l'étage intermédiaire servent à emmagasiner le fret. Le poste de pilotage, les cabines et la salle à manger-salon occupent tout le pont supérieur.
Il faut trois semaines pour remonter le fort courant jusqu'à Bangui. Pour éviter les embûches causées par les bancs de sable, les troncs d'arbres flottant en surface et parfois l'occupation du Congo ou de l’Oubangui par des troupeaux d'hippopotames, on jette l'ancre, la nuit près des rives. Cela permet également de dormir sans être gêné par le bruit du moteur et le clapotis de la roue à aubes.
Tous les trois jours, le bateau accoste près d'un petit village de pêcheurs qui, payés par la société maritime, sont chargés de couper et de stérer du bois de chauffage pour les bateaux à vapeur. Le chargement effectué par les villageois et l'équipage dure deux heures, ce qui donne le temps au capitaine et aux passagers volontaires d'aller chasser des perdrix et des pintades, voire une antilope, pour améliorer l'ordinaire. La pêche à la traîne, pendant la progression du bateau, est également un passe temps agréable et nous permet de manger fréquemment du poisson frais.
Le fleuve Congo et son affluent l'Oubangui sont très larges et bordés par une forêt très dense peuplée d'une grande variété d'animaux et surtout d'une foule de singes bruyants. On voit souvent des crocodiles paresser sur les bancs de sable, la gueule grande ouverte, pour permettre à de petits oiseaux d'aller recueillir les déchets de viande ou de poisson coincés entre leurs dents écartées. En effet, les sauriens n'ont pas de langue pour s'en débarrasser eux-mêmes et acceptent ces "cures dents" emplumés sans les dévorer, malgré leur férocité proverbiale.
Des orages fréquents déversent des trombes d'eau et la visibilité devient si mauvaise que le Capitaine est obligé de ralentir le bateau ; mais ces tornades ne durent jamais très longtemps et quelques minutes après leur passage, le ciel redevient serein et le soleil séche rapidement le pont.
Le niveau de l'affluent est très haut ce qui permet de franchir le seuil de Zinga, alors qu'en saison sèche, ce n'est plus possible pour les gros vapeurs comme le Fonder.
Zinga est un petit poste de brousse situé à une centaine de kilomètres de Bangui. D'une rive à l'autre, un seuil rocheux crève la surface de l'eau en créant des rapides tumultueux ; seule une passe permet le passage des bateaux lorsque les eaux sont assez hautes. Il faut mettre toute la puissance du moteur pour franchir le goulet où le courant a une forte accélération et soulève des vagues impressionnantes.
Enfin, nous sommes arrivés à Bangui, belle ville ombragée, étirée sur la plaine bordant l'Oubangui. A cet endroit, un imposant seuil rocheux barre entièrement la rivière jusqu'à la rive opposée du Congo Belge. Le Kassaï, une haute montagne boisée, chapeaute l'Est de la ville.
En 1933, la population blanche de Bangui était de cinq cents personnes, maintenant il y en a cinq mille. Les commerces et les banques rivalisent en nombre et en ampleur avec ceux des grandes villes de la côte africaine et il y a même trois grands hôtels-restaurants : "Le Palace", le "Roc club" et le "Pindéré" (splendide en sango). C'est dans ce dernier que nous avons logé quelques jours, avant de louer une petite maison, près de l'Oubangui.
Le Pindéré est situé face à l'Oubangui et de l'autre côté de la route, sur la berge, une grande terrasse couverte a été aménagée en bar et salle de bal. Après s'être restaurés en compagnie des Tamour, nous avons été prier sur la tombe de mon père. C’est une tombe blanche, très simple, portant une seule inscription : Serge CHAUVIGNE 1899 – 1946.
Mon frère Claude à hérité de papa le don des langues. Il parle déjà couramment l’allemand et possède de bonnes connaissances en anglais. Il s’est perfectionné très vite dans cette langue en fréquentant une famille de pasteurs américains qui a une mission protestante à huit kilomètres de la ville. Les VICKERS vivent ici depuis de nombreuses années et se sont liés d’amitié avec mes parents depuis longtemps. Les connaissances linguistiques de Claude lui ont permis de trouver un emploi dans une société d’import-export à Bangui.
J’ai trouvé aussi du travail comme chef d’équipe dans une entreprise de bâtiment. Mon rôle consiste à surveiller le chargement et le déchargement du sable que les manœuvres noirs puisent sur les bancs au milieu de la rivière. Le sable est chargé dans d’énormes pirogues, dont je contrôle le va-et-vient dans une petite pirogue manœuvrée par un jeune africain de mon âge. Lors de ces déplacements, tous les piroguiers chantent une mélopée itérative scandée par le mouvement des pagaies « O mound’jou, mou na b’bi guinza. Ah ! Ah !…(O blanc donne moi de l’argent Ah ! ah !…
Avec mes premières économies, j’ai acheté du bois pour construire la carcasse d’un kayak que j’ai recouverte d’un drap enduit de goudron. La pagaie double a étonné mes manœuvres qui n’ont que des pagaies simples. Cet esquif, insubmersible grâce aux caissons étanches placés à l’avant et à l’arrière, est très léger et se manœuvre très facilement. Je me suis servi de lui pour mon travail et, le soir, j’emmène souvent mon petit frère Bernard voguer sur le fleuve. Le courant au milieu de l’Oubangui est très fort, ce qui m’oblige à remonter le long de la berge lorsque je suis déporté en aval. Un soir, le Fonder était arrimé contre la berge et la largeur du bateau créait contre son flanc un courant que je n’ai pas pu remonter malgré une heure d’efforts. Nous avons été obligés de débarquer et de porter notre embarcation pour la remettre à l’eau à l’avant du vapeur. La nuit, qui tombe très vite sous les tropiques, nous a surpris et c’est dans la pénombre que nous avons rejoint la maison. Maman et Claude, très inquiets, m’ont sévèrement grondé et Claude a même menacé de brûler mon kayak. J’ai promis de ne plus être en retard et j’ai tenu parole par la suite.
En fin d’année 1948, nous avons quitté Bangui pour rejoindre Carnot avec un car de la STOCK, grosse compagnie de transport de la capitale. Nous nous sommes installés à WAYOMBO (le nid de l’aigle, en langue Baya) à dix kilomètres de Carnot. C’est le lieu où mon père avait acheté une concession de cinquante hectares et fait construire une maison en torchis.
Claude a été embauché comme chef d’un chantier de prospection de diamant dans la Société DULAS frères de Carnot. Je suis resté avec ma mère et mes petits frères à Wayombo pour diriger la plantation tandis que maman s’est occupée de l’instruction scolaire de Bernard, car il n’y avait pas d’école primaire à Carnot.
C’est là, comme planteur de tabac, que j’ai exercé mon deuxième métier.