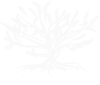Daniel Chauvigné ⌘ - Sixième métier : conducteur d'engins
Bien que m'apportant un salaire très appréciable, ce sixième métier a été pour moi un bouleversement complet. En effet, j'ai dû m'habituer à travailler avec des camarades français, plus âgés et plus expérimentés que moi dans la spécialité. Beaucoup ont également une faible ouverture d'esprit et une méconnaissance complète de la vie africaine.
Jeune et débutant dans un métier appris sur le tas, je devais donc me faire admette avec mon habilité manuelle, sans imposer mes connaissances.
Il m'a fallu quelques mois pour m'intégrer, mais ce qui m'a le plus servi a été ma connaissance de la langue et des coutumes des indigènes. Quelques camarades se heurtaient souvent avec eux par incompréhension réciproque et mes interventions conciliantes étaient toujours appréciées.
Deux camarades m'ont beaucoup aidé et beaucoup apporté :
Franck Dewil, un conducteur d'engins de 22 ans, est un géant 1,90 m, très blond il a un air Nordique. Guère plus âgé que moi et logeant dans la même case, nous sommes devenus rapidement des amis inséparables.
L'autre Roger Laurin est géomètre, un peu moins grand que Franck, il possède par contre une carrure imposante. Il est marié depuis peu avec une jeune et petite femme : Jannine. Cet homme d'une trentaine d'années est très intelligent mais il n'avait pas progressé dans ces études autant qu'il voulait suite à une mésentente avec son père. Ce dernier, possédait un petit atelier de tôlerie-carrosserie en banlieue parisienne et il voulait que son fils lui succède dans cette entreprise familiale, mais Roger avait d'autres ambitions. C'est ainsi qu'il a passé ses heures de loisir à étudier et en candidat libre il réussit son bac avec mention. Ensuite il a suivi des études pour devenir géomètre, mais il voulait aller encore plus loin. Roger a un caractère machiavélique, dans le bon sens du terme où la réflexion l'emporte sur la machination, cela lui a permis de réussir son ambition de devenir ingénieur. Un an après avoir fait sa connaissance, bien que trop âgé pour s'inscrire au concours, il a obtenu une dispense et réussi ce concours. Après trois années d'études à Bordeaux il sortit bien classé de l'école d'ingénieurs des travaux publics.
C'est en prenant exemple sur la volonté et la force tranquille de Roger que, par la suite, j'ai amélioré mes connaissances et ma condition de vie.
Revenu vers la capitale, j'ai été affecté, avec Franck, au chantier du kilomètre 7 ( P.K 7 ) où nous étions sept célibataires et sept hommes mariés. Cette coïncidence m'a rappelée celle du nombre treize, accumulé, lors de mon retour en Afrique. Mon numéro de pensionnaire au lycée, 154, revint également plusieurs fois marquer quelques étapes de ma vie, mais tous ces nombres que j'utilisais, parfois, dans des jeux de hasard ne m'ont jamais rien rapporté.
Le chantier du P.K.7 marque le départ des deux routes par une patte d'oie dont une bifurque à l'ouest vers M'baïki et l'autre au nord vers Bossembélé.
Pour élargir la piste existante au départ, nous avons déraciné et repoussé les gros manguiers qui bordent cette piste. Les noirs du village voisin, qui assistaient à cette opération, semblent médusés par la facilité avec laquelle nos engins abattent les arbres. Avec une certaine fierté je les ai interrogés. Certains répondaient placidement " ça c'est manière de blancs " mais l'un d’eux eut une réponse dont la logique me frappa : " Maintenant que les blancs ont trouvé des véhicules qui font la route tout seul, on n'aura plus à réparer avec nos petits paniers de terre !".
Sur le tracé de la future route, existe un énorme fromager, arbre à bois blanc et tendre dont les fruits sont couverts d'une enveloppe pelucheuse. A proximité de cet arbre, il y a un village indigène commandé par un vieux chef. Lorsque celui-ci comprit que l'on allait abattre le fromager, il vint avec quelques hommes armés de sagaies et de couteaux de jet, vociférer invectiver le chef de chantier qui ne comprenait rien à leur langue. On vint me chercher comme interprète. Le vieux m'expliqua que cet arbre était appelé " l'arbre du gouverneur " car il avait été planté, il y a bien longtemps par un ancien gouverneur de l'Oubangui-Chari; c'était donc un symbole que l'on ne pouvait pas abattre.
Après ma traduction, le chef de chantier jugea qu'il devait en référer à ses supérieurs et il donna des ordres pour que l'on continue à défricher sans toucher cet arbre. Pour montrer sa satisfaction, le chef du village lui remit un poulet et des œufs. Le chef de chantier voulu décliner cette offre, mais je lui ai expliqué que cela serait un affront, pour ces gens simples et accueillants, mais très pointilleux sur leurs coutumes. A mon tour, pour prouver la bonne fois des blancs, j'ai été à une centaine de mètres dans la brousse, briser une termitière haute de 3 mètres avec la lame de mon bulldozer, puis j'ai convié les indigènes à capturer les termites. Je savais qu'ils étaient très friands de ses insectes qui, grillés sur une plaque de tôle chauffée, rôtissaient en racornissant et avaient un bon goût de noisette sucrée. Les termitières de boue séchée étaient presque aussi dures que du béton et les indigènes ne possèdent pas d'outils assez robustes pour s'attaquer à de tels édifices.
Par la suite, à chaque fois que l'on trouvait une termitière le long de la route, nous ne manquions pas de réitérer cette action. Les indigènes nous remerciaient en nous offrant des poulets et devenaient de plus en plus sociables avec nous.
Petit à petit, mes camarades m'ont demandé des conseils pour traiter avec les noirs. Ainsi, pour les achats locaux, les discutions avec les boys, l'exécution de certains travaux et même la recherche d'une compagne, on faisait de plus en plus appel à moi.
Souvent, je m'insurge devant l'injustice de certains blancs qui ont tendance à maltraiter les noirs et il m'arrive de leur rappeler la devise de Savorgnan de Brazza : " Savoir, comprendre, respecter et aimer. " En suivant cette maxime tout en faisant preuve d'une juste autorité, on obtient des noirs un rendement acceptable, une grande compréhension et une franche amitié.
Monsieur Durant, notre directeur, a obtenu une audience auprès de Monsieur Cornut-Gentil, gouverneur de l'Oubangui-Chari. Celui-ci ignorait l'existence de cet arbre " du gouverneur " mais avec beaucoup de diplomatie, ce " grand chef blanc " convoqua le chef du village et lui dit :
- "Les blancs construisent une grande route pour amener plus de prospérité dans ton pays. L'arbre planté par mon lointain prédécesseur gêne le passage. Il faut donc l'abattre, mais cet arbre mérite le respect et doit être remplacé."
Il fut donc convenu, d'un commun accord, qu'une grande fête serait organisée pour abattre l'arbre du gouverneur et en baptiser un autre dans le village.
L'arbre du gouverneur possédait d'énormes racines périphériques et une profonde racine centrale, ce qui rendait impossible son terrassement au bulldozer et il n'était pas question de la faire sauter à la dynamite. En conséquence, des manœuvres ont dégagé la terre autour de l'arbre avec des pioches et des pelles. Ils ont coupé à la hache les racines périphériques, puis ils remirent la terre en place. Sur l'énorme tronc des pitons ont été cloués pour servir d'échelle et fixer un gros câble à une dizaine de mètres de hauteur.
Le jour de l'organisation, le gouverneur, le maire et son conseil municipal au grand complet ainsi que tous les notables de la ville sont venus assister au spectacle.
Le câble, long de trois cents mètres, était arrimé à 2 bulldozers, conduits par Franck et moi. Le poids du câble tendu faisait déjà osciller l'arbre...
Le gouverneur a fait un discours qui a été très applaudi, puis d'un geste grandiose a fait signe aux deux pilotes de faire avancer leur engins. Très facilement le géant s'est abattu avec un grand craquement dans un fracas de branches brisées qui, en touchant le sol, ont soulevé un nuage de poussière.
Les tam-tams ont retenti, couvrant les vivats de la foule...
Le gouverneur et sa suite se dirigèrent alors vers un autre fromager situé au centre du village. Le "grand chef blanc " refit un discours et procéda au baptême du nouvel " arbre du gouverneur " en le ceinturant d'une écharpe tricolore. La Marseillaise a été jouée par la fanfare du 9ème Régiment d'Infanterie Coloniale et les notables ont terminé cette cérémonie en sablant le champagne.
Au P.K.7 le défrichage a été rapidement achevé et nous avons équipés nos engins de scrapers pour prélever de la latérite à proximité de la route et la répandre dans les grosses dépressions. Nous écrêtons également les côtes trop importantes pour réaliser une route la plus plate possible. Les virages sont relevés pour faciliter la conduite des véhicules et de profonds fossés sont creusés pour évacuer les torrents d'eau à la saison des pluies. Les apports de latérite sont ensuite compactés par d'énormes cylindres dentés et lestés appelés " pied de mouton ". Après finition à la niveleuse, du bitume est répandu sur les neuf mètres de large de la route.
Sur ce chantier j'ai appris le fonctionnement des tracteurs-scrapers " Letourneau ", montés sur pneumatiques qui sont bien plus rapides et plus souples que les bulldozers chenillés.
Lorsque nous travaillons en scraper nous avons une prime de rendement, nos engins sont numérotés et un homme est chargé de compter le nombre de tours journaliers que nous faisons. Au dessus de cent tours journalier notre salaire s'en trouve augmenté en moyenne d'un tiers .
Le travail débute à cinq heures et se termine à treize heures. A dix heures il y a une pose casse-croûte de vingt minutes. Au petit jour nous supportons un pull-over mais à partir de dix heures la chaleur est difficilement supportable. Lorsque nous nous arrêtons, cuits par le soleil et rouge de poussière de latérite agglomérée sur la peau par la sueur, nous n'avons qu'une hâte : prendre une bonne douche tiède pour nous décrasser et nous détendre.
Un jour, souffrant d'une crise de paludisme, je suis rentré plutôt que d'habitude et j'ai surpris mon boy en train de se brosser les dents avec ma brosse à dents. Sans me montrer, j'ai fait demi-tour pour revenir quelques instants plus tard et lui dis de mettre de l'eau tiède dans le sceau suspendu dans une paillote proche de ma case. Nous n'avons pas d'eau courante et le sceau a une contenance trop faible pour se doucher entièrement, il est donc nécessaire d'appeler le boy pour remettre de l'eau pour se rincer. Lorsque mon boy a grimpé sur l'échelle pour mettre de l'eau, ostensiblement je me suis brossé la raie des fesses avec ma brosse à dents, tout en épiant sa réaction... Je suis sûr que mon boys ne s'est plus jamais resservi de ma brosse à dents. ( J'en achetais une autre de même couleur, mais je ne lui ai pas dis.)
La naïveté des noirs de la brousse est proverbiale. Un jour, un Administrateur colonial m'a raconté cette histoire. Il a un œil de verre et lorsqu'il part en tournée il laisse son faux œil sur la table de son bureau et dit à son boy :
- "Si tu me voles quelque chose pendant mon absence, mon œil me le dira à mon retour !... Une fois parti, il mettait un œil de rechange."
Rien ne disparaissais, jusqu'au jour où il vit un mouchoir jeté négligemment sur l'œil de verre !... Après avoir cherché, il s'est aperçu qu'il lui manquait une cartouche de cigarettes. Lorsqu'il accusa le boy, celui-ci répondit :
- "Comment as tu pu découvrir le vol, il y avait un mouchoir sur ton œil ?..."
Mes six camarades et moi-même mangeons ensemble dans une grande pièce. Nous sommes responsables à tour de rôle, une semaine chacun, du menu et des ordres à donner au cuisinier. Au cours des repas les discutions vont bon train, dans une très bonne ambiance et si l'un de nous n'aime pas un plat, il commande au cuisinier un plat de rechange. Quelques anecdotes viennent parfois agrémenter nos repas.
Un soir, la soupe avait un drôle de goût et de cuillerée en cuillerée, nous essayons d'en trouver la provenance, lorsqu'un camarade dit :
- "On dirait un goût de savon !"
Aussitôt Bébert, se frotta le front et appela le cuistot :
- "où as-tu pris l'eau pour faire la soupe ?"
- "Dans le gros tonneau, comme d'habitude, patron."
Bébert nous avoua qu'il s'était lavé les mains dans ce fût dont l'eau était normalement prévue pour lutter contre un éventuel incendie.
Un autre soir, mon boy Claude, apporta la soupe avec deux pouces dans la soupière.
- "Voyons Claude, tu ne vois pas que tu as les pouces dans la soupe ?" lui dis-je en colère.
- "T'inquiètes pas, patron, ce n'est pas chaud !"
Je chasse tous les week-end pour améliorer l'ordinaire à peu de frais. A proximité de notre camp, dans les plantations de manioc ou d'arachides, les perdrix et les pintades pullulent, mais il faut que je me déplace à une centaine de kilomètres pour trouver du gros gibier. Les petits singes verts, et les colombes à manteau blanc sont très nombreux dans les galeries forestières avoisinantes. Le singe est très fin et apprécié, à condition de le découper en petits morceaux et de ne pas présenter le tête, les mains ni les pieds. Les morceaux sont mis à macérer avec du vin rouge et des épices pendant trois jours et cuits à petit feu, comme un coq au vin. Pendant longtemps j'ai fais croire à mes convives que c'était du " lièvre africain ", sinon certains n'en auraient pas mangé, ...
Une fois par mois nous organisons un méchoui de célibataires qui se termine toujours en orgie Romaine. A Noël et pour le Saint- Sylvestre, un grand repas est pris en commun avec les familles. Ainsi l'ambiance est excellente, bien que parfois des heurts apparaissent suite à des cocufiages.
La route avance rapidement et je me suis bien confirmé dans le maniement des différents engins de terrassement, y compris la niveleuse dont l'emploi est très compliqué.
Lorsque nous sommes arrivés au P.K.154, deux fâcheuses aventures me sont arrivées : Un jour, je devais réparer le câble du treuil de mon bulldozer qui s'était rompu. Comme d'habitude, en pareil cas, un camarade met son engin face à celui en panne pour soulever sa pelle frontale et donner du mouvement au câble. Je venais de terminer le démontage de la fixation du câble lorsque mon camarade, par inadvertance et maladresse, a relâché son frein et son engin a reculé. Ma pelle, libérée, est tombée sur le sol en entraînant son câble qui s'est mit à fouetter l'air. Debout sur mon engin, je me suis écarté précipitamment mais le bout du câble m'atteint à l'avant bras et à la poitrine. J'ai ressenti comme un coup de marteau puis je me suis aperçu que le sang coulait mélangé au cambouis. J'ai rejoint d'urgence l'infirmerie où l'on m'a prodigué les premiers soins. Le bras était faiblement entamé mais, au niveau de la poitrine, la chair était arrachée jusqu'à l'os. J'ai été exempté de travail pendant un mois et j'en ai profité pour m'inscrire à un cours par correspondance pour acquérir la qualification de chef de chantier de Travaux Publics.
Quelle ne fut pas ma stupeur lorsque j'ai découvert que dans ces cours les méthodes étaient démodées ! En effet, les problèmes de déplacement des volumes de terre sont estimés au petit panier, à la brouette et au tombereau, alors que nous sommes équipés d'engins modernes qui font en une heure le travail de cent hommes pendant un jour !... J'en ai fais part à l'école Universelle qui m'a répondue que les cours officiel de chef de chantier n'avaient pas suivi de modification malgré l'évolution des techniques. Découragé, j'ai laissé tomber l'idée de m'élever dans la hiérarchie sociale.
Quelques mois plus tard, mon moteur étant normalement usé, Cuilleret le mécanicien qui suit notre chantier, a mit un moteur neuf sur mon engin. Au bout de cinquante heures de fonctionnement, il était nécessaire de resserrer la culasse et de tarer les injecteurs. Ce laps de temps écoulé, j'ai été voir Cuilleret pour qu'il effectue ces opérations. Il m'a répondu qu'il n'avait pas le temps et que je revienne le lendemain. De jour en jour il repoussa l'échéance, j'en ai rendu compte au chef de chantier et au chef de service, qui après avoir questionné le mécanicien, m'ont donné l'ordre de continuer mon travail, bien que mon moteur donnait déjà des signes de défaillance. Au bout de quinze jours le moteur refusa de démarrer et le mécanicien a constaté qu'il était précocement usé et irréparable. Il fit un rapport m'accusant d'avoir laissé tourner mon moteur trop longtemps au ralenti, pour expliquer l'usure prématurée des cylindres et des pistons.
J'ai été convoqué à Bangui par le directeur qui m'infligea comme sanction, trois mois de suppression de primes de rendement. Je lui ai fais part de mes connaissances en mécanique et de l'action que j'avais menée envers Cuilleret, le chef de sentier et le chef de service. Il m'écouta et me dit qu'il allait faire une enquête. Je profitais de l'occasion pour lui demander les raisons pour lesquelles mon salaire était inférieur à celui de mes camarades guère plus anciens que moi. Il m'a répondu que n'ayant pas vingt et un ans il était normal que mon salaire soit inférieur, même pour un travail égal.
Malheureusement pour moi, l'enquêteur, M. Narolle, ingénieur mécanicien de la société, était le beau-père de Guilleret. Il fit donc pression auprès des témoins pour que son gendre ne soit pas impliqué dans cette affaire. Ma prime a été supprimée et je n'ai dû qu'à ma situation d'orphelin de ne pas être licencié.
Des camarades, témoins de ma bonne foi, n'ont pas voulu intercéder en ma faveur, par crainte de représailles, mais ils m'ont promis de le faire dès que le chantier serait terminé. Bien plus tard ils ont tenu parole. Le directeur m'a fait verser mes primes que j'avais perdues et a congédia M. Narolle et son gendre.
Sur le chantier P.K 308 ( 2*154 ), une grave mésaventure m'est arrivé :
Vers 13 heures, à la fin du travail, je menais mon engin en tractant un énorme pied de mouton vers la station où l'après midi, les boys-moteurs effectuent l'entretien journalier des engins.
Comme d'habitude, pour ne pas marcher à pied, les manœuvres noirs ont grimpé sur les ballasts du pied de mouton et l'un d’eux s'est assis à côté de moi.
- "Awwé ?" (Êtes-vous prêts ? ) dis-je en me retournant, avant de démarrer.
- "Awé !" ( nous sommes prêts ! ) répondit un des indigènes assis sur le ballast.
J'ai embrayé et l'engin avait parcouru quelques mètres lorsque mon attention a été attirée par un noir, resté à terre, qui me faisait des grands gestes. Pensant qu'il voulait monter également, j'ai arrêté mon engin et mis mon moteur au ralenti. C'est alors que j'ai pu entendre les cris des indigènes assis sur le pied de mouton. L'un d'eux est venu me dire qu'un de ses camarades s'était assis le dos contre le rouleau et un bras entre les énormes dents. Au démarrage il a été happé et a été écrasé par le compacteur !
Très affligé à la vue de la masse sanguinolente mêlée au sol meuble je me suis effondré en me tenant la tête à deux mains en disant :
- "Vous m'aviez pourtant dit que vous étiez prêts ! "
Tous les noirs présents m'ont consolé en m'assurant que cet accident n'était pas de ma faute et qu'il fallait que j'aille avertir le chef de service. Je suis donc parti avec une camionnette jusqu'au camp accompagné d'une dizaine de noirs de la même ethnie que leur camarade défunt.
Lorsque je lui ai raconté le drame, le chef de service était en train de manger avec son épouse. C'était un géant roux de près de deux mètres, très bourru et peu sociable, aussi quand je lui ai demandé de désigner un chef de chantier pour constater les faits et de permettre aux noirs, de la famille du défunt d'aller l'enterrer, il s'est mis en colère.
- "Comment, Moulingué toi un vieux broussard, tu as peur de ces macaques ?"
Puis, retirant son ceinturon, il s'est précipité dehors, vers les noirs qui attendaient calmement et les a chassé en les frappant et en les invectivant !
- "Vous n'auriez pas dû faire cela, dis-je. Ces gens attendaient de vous une justice et une compréhension et non des coups ! Cela va mal tourner !"
- "Penses-tu ! Je vais prévenir la Direction par radio et ils enverront une ambulance et les gendarmes pour faire le constat. Rentres chez toi et ne t'inquiètes pas... Je vais faire chercher le corps."
Plein de pressentiments, j'ai rejoint ma case et, au passage, j'ai mis quelques camarades au courant du drame. Je leur ai demandé de préparer leurs armes pour me défendre au cas où je serais attaqué, cette nuit. Je leur ai précisé qu'il suffirait de tirer en l'air pour les faire fuir mes éventuels agresseurs.
Après avoir pris une douche, mon boy m'a demandé si je voulais manger, mais je n'avais pas faim. Celui que j'avais tué était de sa famille et il était au courant de tout ce qui s'était passé, aussi me dit-il :
- "Patron, je te connais car je suis ton boy depuis 2 ans et je sais que tu n'as pas tué mon frère volontairement, mais ton patron a mal agi ! Maintenant les dix hommes de la tribu, croient que tu as demandé au grand patron de les chasser; ils vont boire et sous l'empire de la boisson ils vont venir se venger ! Alors donne-moi la permission d'aller dans ma famille, car je ne veux pas qu'ils m'obligent à agir contre toi..."
Je l'ai remercié de sa franchise et l'ai laissé partir, en pensant que je ne serais agressé que la nuit.
Peu après, alors que sans arme, j'allais voir mon camarade Henri ROC qui loge dans une case proche de la mienne, j'ai décelé derrière des buissons des noirs armés d'arc de sagaies et de couteaux de jet... Le camp était calme à cette heure chaude de la journée où tous font la sieste; j'ai allongé le pas sans courir pour laisser croire que je n'avais rien vu, et suis rentré dans la case de mon camarade.
- "Riton, vite lèves-toi ! As-tu une arme ?"
- "Non dit-il, tu sais que je ne chasse pas. Que se passe-t-il."
- "Des indigènes vont essayer de me tuer; va chercher de l'aide !"
Les portes n'avaient pas de clefs, comprenant la situation, Riton parti par la fenêtre de derrière chercher un véhicule afin me tirer de ce mauvais pas.
Je suis sorti sur la terrasse pour tenter de calmer mes agresseurs. Luttant pour conserver mon calme et mon sang froid, je me suis adressé à eux en Sango, suffisamment fort pour éveiller l'attention des blancs des cases voisines, mais ils dormaient bien !...
- "Vous savez que je n'ai pas fait exprès de tuer votre frère... Vous étiez présents lors de l'accident..."
Mes adversaires étaient ivres et très excités et nul langage ne pouvait les raisonner !... L'un d'eux, qui me tenait par le col de ma chemise dit :
- "Viens avec nous dans la brousse !.. Le sang appelle le sang !... Nous allons te tuer pour venger notre frère !..."
Providentiellement Henry est arrivé avec une camionnette, mais le groupe était entre elle et moi... Je me suis débarrassé de celui qui me tenait et j'ai fais semblant de fuir vers l'arrière de la maison en traversant la pièce centrale. Aussitôt, le groupe s'est scindé pour contourner la maison et m'attraper à la sortie; seuls trois hommes étaient sur mes talons. J'ai fais volte face et me suis dégagé à coup de poing, puis j'ai grimpé dans la camionnette qui parti en trombe. Au passage, j'ai reçu un coup de couteau à la main gauche, mais la blessure n'était pas grave. Riton m'a emmené chez des colons qui ont une plantation à une dizaine de kilomètres de là, puis il est retourné au camp pour alerter le chef de service.
En sortant du garage où il avait garé son véhicule, Henri a été attaqué par la bande de noirs qui avaient attendu son retour. Il a été molesté à coup de pieds et poing et laissé inanimé sur le sol.
Lorsqu'il revint à lui, il se traîna chez le chef pour tout lui raconter...
Les gendarmes de Bangui, alerté par radio, sont venus prendre ma déposition et arrêter les coupables. Ceux-ci ont été condamnés à un an de prison pour coup et blessure envers mon camarade et tentative de meurtre sur ma personne.
Je suis passé au tribunal correctionnel, quelques mois plus tard, où j'ai été reconnu coupable dans l'accident qui avait occasionné la mort de ce pauvre indigène.
Un an après cette triste affaire, je suis revenu d'un congé passé en France. Dans l'avion affrété par notre société, j'ai retrouvé mes camarades et quelques nouveaux embauchés. L'un d’eux nous a questionné sur les coutumes de la vie africaine et le mode de vie qu'un Français doit avoir dans ce pays. Nous lui avons donné tous les renseignements nécessaires et Franck a ajouté :
- "Pour avoir un boy, demande à Mounlingué, il t'en trouvera un."
A l'aéroport de Bangui tous nos boys nous attendaient pour se remettre à notre service. J'ai salué le mien et, en Sango, je lui ai demandé de me trouver un boy pour un nouvel arrivant. Il m'en a présenté un. Sa tête ne m'était pas inconnue mais je n'arrivais plus à le situer.
- "Je te connais, où nous sommes nous rencontrés ? lui dis-je, toujours en sango."
- "Je t'ai connu au P.K 308 et je viens juste de sortir de prison, me répondit-il en baissant la tête."
C'était l'homme qui m'avait pris par le col de ma chemise, qui voulait me tuer ! Il poursuivit :
- "J'ai fait une bêtise, mais je l'ai payée... J'ai une femme et des enfants à nourrir... Je te demande pardon, j'avais bu et ne savais plus ce que je faisais."
- "Bien, je te pardonnes, mais soit un boy honnête avec le nouveau blanc, sinon tu auras affaire à moi !"
Lorsque j'ai dit à mon nouveau camarade que je lui avais trouvé un boy, il m'a demandé si s'était un type bien. Je lui ai répondu par l'affirmative, tout en lui précisant que ce noir avait tenté de me tuer un an plus tôt, mais je me portais garant de lui.
Devant l'air septique du nouveau et les sourires de mes camarades, je lui ai expliqué ce qui s'était passé et qu'il fallait donner à ce boy l'occasion de se racheter. (Il est resté plus de deux ans à son service et il en a été tout le temps satisfait.)
De chantier en chantier, je me suis affirmé dans mon métier de conducteur d'engins et en particulier de la niveleuse. Mes camarades et moi-même, avions eu la fâcheuse idée d'apprendre à nos boys-moteurs à manier les bulldozers entre midi et treize heures. Le travail effectué n'était pas de grande qualité et nous en rattrapions rapidement les défauts le lendemain matin. Cette combine nous permettait de ne pas souffrir pendant l'heure la plus chaude de la journée et le rendement n'en était pas trop affecté.
Les chefs de service s'étaient aperçus de cette manœuvre sans s'y opposer et au bout d'un an certains boy-moteur sont parvenus à faire un travail acceptable. C'est pourquoi, à la fin d'un contrat, le directeur a décidé d'en tirer parti. Il ne conserva que dix conducteurs d'engins français sur les cinquante que nous étions et a employé les meilleurs noirs que nous avions formés. Pour la société le gain était appréciable, car ces indigènes étaient payés avec un salaire de cinq mille francs par mois alors que nous touchions soixante-dix mille, plus les congés payés ainsi que les voyages sur la France.
J'ai néanmoins été retenu parmi les dix conducteurs d'engins français restants, mais nous sommes tristes d'avoir perdu nos anciens camarades.
L'aide MARSHALL cessant en 1951 la construction de la route a été interrompue par manque de crédits, car les fonds attribués outre mer par l'état Français sont insuffisants pour couvrir de telles dépenses.
C'est à cette période que j'ai appris que ma mère, très fatiguée par son travail et ses longues années passées aux colonies était tombée malade et se trouvait dans le coma. J'ai demandé un congé exceptionnel pour me rendre à son chevet et le directeur m'a même prêté une voiture pour que je fasse le déplacement plus rapidement.
Lorsque je suis arrivé à Bouar, maman était sortie du coma, mais elle était encore très faible. Les sœurs de la mission catholique avaient pris mes deux petits frères en charge, mais le médecin militaire de la garnison m'a conseillé de rapatrier ma mère en France au plutôt.
J'ai donc retenu des places sur un bateau pour le mois suivant et le frère jean, de la mission, m'a proposé d'emmener ma mère et mes petits frères à Douala, où une fois par mois il va chercher de la marchandise. Ma mère suffisamment rétablie, a pu supporter le voyage par terre et mer et ma grand-mère a été très heureuse de retrouver sa fille et ses petits enfants.
De retour à Bangui, j'ai appris que la société devait construire une centrale hydroélectrique pour mettre en œuvre une usine de traitement du coton, sur le site des chutes de Boali à 90 kilomètres de Bangui. La construction de la centrale et de l'usine devait durer 18 mois. Pendant ce temps on espérait qu'une solution serait trouvée pour reprendre les chantiers routiers.
Sur le plan politique l'Afrique prenait un essor en se voyant accorder le droit d'élire des députés. Le premier Député noir de l'Oubangui-Chari fut Mr Boganda. Ce prêtre avait été formé par Monseigneur Grandin, prélat de la mission catholique de Bangui, et je les connaissais très bien tous les deux. Par la suite, le député a été élu Président de la République Centrafricaine. et Monseigneur GRANDIN s'est tué dans un accident d'automobile près de Bangui.
Dans cette capitale, les premiers signes d'indépendance se font déjà sentir. Alors qu'en brousse, blancs et noirs se tutoient sans arrière pensée ; en ville le tutoiement n'est plus accepté par certains indigènes évolués. C'est ainsi, qu'un jour j'ai assisté au dialogue entre Européen et un fonctionnaire noir employé à la poste de Bangui :
- "Bonjours, donnes moi un carnet de timbres."
- "Bonjours monsieur, voici votre carnet, mais à l'avenir, je vous prie de me parler à la troisième personne."
- "Et ta sœur !"
- "Ma sœur, vous pouvez la tutoyer, elle ne fait pas partie de l'Administration Française de Postes !"
Les bureaucrates français et noirs ont souvent le même emploi à la mairie de Bangui et les français sont logés dans des petites maisons érigés à leur intention par la municipalité, mais les indigènes n'ont pas ce privilège. Leur nouveau député a donc demandé et obtenu que les employés noirs soient également logés dans des maisons du même style, ce qui a été fait pour une dizaine d'entre eux.
Dès leur occupation des lieux leur première action a été de clouer les volets de bois et les portes extérieures, autre que la porte d'entrée. En effet, si les cases des indigènes ne possèdent qu'une issue c'est parce que dans les croyances ancestrales existe un "esprit malin" jeteur de mauvais sort. Cet esprit, qui n'agit que la nuit, est un esprit "compteur" qui jette le mauvais sort lorsqu'il a fini de compter. Si l'on dort les pieds vers la porte, les orteils sont vite comptés ; alors il faut dormir la tête vers l'entrée et "l'esprit malin" n'a pas assez de temps pour compter les cheveux crépus !
Ensuite, ils ont fait du feu à même le sol dans la grande pièce centrale pour éloigner les moustiques. Enfin le cuisine extérieure a servi de maison à des frères et sœurs tandis que des amis ont érigé des bidonvilles sur la pelouse !
Ces premiers pas vers l'émancipation ont accéléré la venue en ville de villageois venus chercher fortune et le manioc, nourriture principale des noirs, vint à manquer. Pour pallier la disette, ordre a été donné à tous les adultes noirs de la brousse de cultiver chacun trois ares de manioc qui leur serait acheté pour alimenter la capitale.
Cela a été une grave erreur de commandement, car par tradition, la culture du manioc est uniquement un travail dévolu aux femmes...
Il y a eu un rapport d'ingénieurs agronomes pour délimiter les parcelles et définir les méthodes de culture intensives. Mais les noirs déterraient les piquets pendant la nuit. On a mis des gardes pour éviter ces destructions des limites et les auteurs de vandalisme ont été emprisonnés. Peu à peu il y a eu plus d'adultes prisonniers que d'actifs !... Il fallu six mois aux dirigeants pour comprendre qu'il suffisait seulement de demander aux hommes d'inciter leurs épouses à cultiver trois ares supplémentaires !
Bien des erreurs commises par l'Administration coloniale sont dues à la méconnaissance de certaines coutumes locales, par des gens instruits sur des lois métropolitaines, souvent inadaptées aux pays d'Outre mer. Ces administrateurs font un séjour trop court pour comprendre qu'il faut adapter les lois aux exigences locales et lorsqu'ils sont mutés dans d'autres colonies, l'expérience acquise n'est pas toujours utilisable envers les nouvelles ethnies qu'ils administrent.
Seuls les gendarmes qui font dix ans de séjour, en moyenne, avec un congé en France tous les deux ans, sont bien intégrés et ont une action efficace.
Il n'y avait pas non plus d'incompréhension avec les missionnaires, les commerçants où les colons qui étaient depuis longtemps sur place.
Le site de Boali est grandiose. Ses hautes chutes créent un arc-en-ciel permanent qui ceinture ses huit cents mètres de large. L'eau tombe avec grondement sourd, amorti par l'épaisse végétation. La seule voie d'accès est une petite route en terre battue qui mène jusqu'à un petit restaurant monté sur pilotis, en haut des chutes. Le plateau est recouvert par une forêt équatoriale très dense.
Après avoir agrandi et goudronné la voie d'accès, nous avons défriché le plateau pour y implanter l'usine. Tous les grands arbres déracinés sont élagués et achetés par une scierie. Les énormes rochers ont été brisés à la dynamite, puis le terrain a été aplani. Enfin, des tranchées ont été creusés à la pelleteuse pour recevoir les passages de câbles électriques et réaliser les conduites d'eau. Les fondations de l'usine ont succédé à ces travaux, tandis qu'avec nos bulldozers nous réalisons l'emplacement des futures villas des employés et le village indigène dans les collines avoisinantes.
Le travail le plus impressionnant a été la construction, en bas des chutes, de la centrale avec ses énormes turbines qui seront actionnées par l'eau tombant à travers une conduite forcée, en béton armé.
Ce chantier très important pour l'économie du pays, a été visité par M. Malraux alors ministre de la France d'outre mer. Il était accompagné du gouverneur et entouré de nombreux journalistes. A l'issue de la visite un buffet froid, où nous étions tous conviés, a été servi. Le Ministre, très affable a posé de nombreuses et pertinentes questions sur des domaines très variés et, de groupe en groupe, il toucha toutes les couches sociales, ce qui a crée une détente fortement appréciée.
M. Cornut-Gentil lui a raconté l'anecdote de l'arbre du Gouverneur en insistant sur ma participation, le Ministre est alors venu près de moi pour me féliciter et je l'assurais que ma participation avait été bien modeste. Il m'a ensuite posé des questions sur les mœurs des indigènes du pays. C'est ainsi que je lui ai appris pourquoi il n'y avait pas de jumeaux dans les peuplades de la brousse de L'Oubangui-Chari:
Lorsqu'une femme met au monde des jumeaux, le mari pense que son épouse l'a trompé, qu'un enfant est le sien et l'autre celui de l'amant. En conséquence, après avoir battu sa femme, il tue les jumeaux et les incinère. Les cendres sont mises dans des calebasses suspendues à des perches placées à l'entrée des champs de manioc, du côté des vents dominants. Ils pensent, en effet, qu'une femme qui a des jumeaux est très féconde, par conséquent la cendre de ses enfants répandue par le vent sur le sol, le rendra fertile.
Cette histoire macabre m'avait été racontée lorsque j'avais 18 ans, par un de mes pisteurs et quand je lui ai expliqué comment les jumeaux sont réellement formés, il avait répliqué :
- "Tu es encore un gamin, tu ne vas pas m'apprendre à faire des enfants !..."
Le gouverneur ne connaissait pas non plus cette coutume, mais il avoua qu'il n'avait jamais vu de jumeaux noirs en brousse.
Le chantier s'est terminé et j'ai bénéficié d'un congé de trois mois en France. A l'issue de ce congé, la société m'a proposé de continuer mon activité professionnelle sur un chantier dans l'Est de la France, car elle n'avait plus de travail en Afrique.
Depuis quelques mois, mon frère Claude était rentré en France où il avait été embauché comme interprète dans un camp américain aux environs de Nancy.
Après une longue maladie, nous avons perdu notre mère. Nos deux petits frères ont été recueillis chez des oncles et tantes qui les ont choyés et se sont chargés de leur éducation.
Monsieur Dalcer, avec qui j'étais resté très lié, envisageait de monter une entreprise commerciale en Oubangui avec un gros magasin dans la capitale et de petites factories en brousse. Il m'a demandé si j'acceptais de travailler avec lui pour m'occuper de contrôle et du ravitaillement des factories de brousse pendant qu'il tiendrait le magasin de Bangui. J'ai accepté avec empressement, tout content de retrouver la brousse, ma chienne Ketty, mes fusils et mes trophées de chasse.
Pendant mon congé, je suis devenu follement amoureux d'une Lorraine qui allait devenir rapidement mon épouse.
J'ai aussitôt prévenu mon ami Dalcer de cette union, persuadé qu'il en serait très heureux. Je lui ai demandé également de m'envoyer un contrat de travail et le montant des billets d'avion.
Je ne sais pas pourquoi cet ami ne m'a jamais répondu. Je n'ai jamais retrouvé tout ce que je lui avais laissé, je ne l'ai jamais revu et je ne suis jamais retourné en A.E.F.
Voilà pourquoi j'ai repris mon métier de conducteur d'engins à la Société de Construction des Batignolles sur le chantier de la forêt de Haye, près de Nancy.
Ce chantier a duré 9 mois, à raison de 10 heures de labeur quotidien, samedi et dimanche compris. Après la chaleur africaine, j'ai terriblement souffert du froid de l'Est. Avec les heures supplémentaires, notre salaire est acceptable, bien que nettement inférieur à celui que nous avions aux colonies.
Bénéficiant du statut particulier aux résidents français aux colonies, je suis exempté de service militaire à condition de rester jusqu'à l'âge de 30 ans outremer. Comme ce n'était plus le cas, j'ai été m'inscrire au bureau de recrutement de Nancy.
J'ai fait mon service dans une compagnie de réparation du matériel stationnée à Nancy. Pendant 8 mois, j'ai fait mes classes puis les pelotons de Brigadier-chef et de Maréchal de Logis.
C'est alors que je me suis rendu compte que le métier des armes était mieux rémunéré que mon travail de conducteur d'engins, moins fatiguant, plus stable et surtout qu'il m'ouvrait de plus belles perspectives d'avenir.