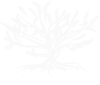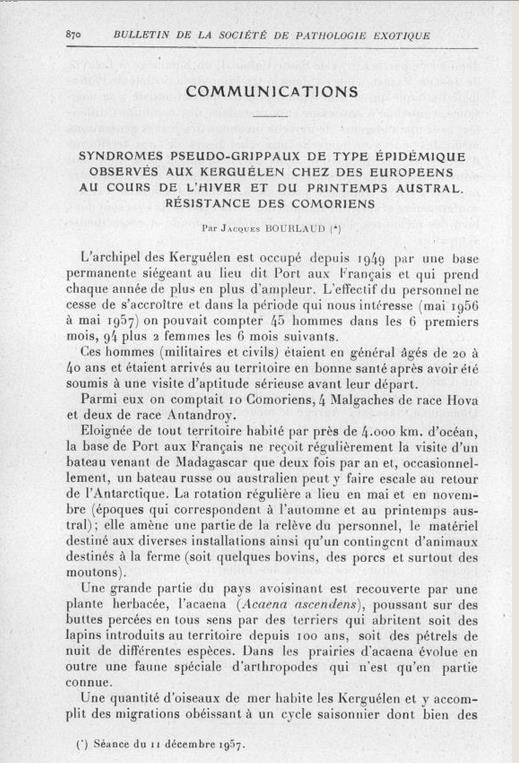Jacques Bourlaud 🩺 - Kerguelen
- Voulez-vous aller aux Kerguelen ?
Le Médecin-Chef du 1° R.I.C. brandissait la circulaire qu’il avait reçue les jours précédents et qui demandait un médecin volontaire pour les Terres Australes et Antarctiques Françaises .
Je n’étais pas très satisfait de mon affectation métropolitaine. En revenant d’Indochine, j’avais espéré effectuer un stage dans les hôpitaux militaires ou civils de la région parisienne. Mais, d’après ce qu’il m’a été dit, les régiments coloniaux manquaient de médecins et leurs besoins devaient être comblés en priorité. J’ai donc été affecté au 1° R.I.C. à Versailles. Habitant Bourg-la-Reine, ce n’était pas catastrophique. Seulement, lorsque je me suis présenté au Corps, ce fut pour apprendre que c’était justement le bataillon stationné à Dreux qui m’attendait avec impatience…
L’ambiance n’était pas désagréable ; le commandant du bataillon était sympathique et je pouvais bénéficier d’un service hospitalier en m’occupant des chambres réservées aux militaires à l’hôpital de Dreux.
Mais pour aller de Bourg-la-Reine à Dreux il fallait me lever très tôt et combiner tout un horaire de trains et de métros.
Une autre chose m’incitait à accepter cette proposition. Mon fils Michel venait de subir une série d’interventions chirurgicales qui devaient lui permettre de reprendre le cours d’une vie normale. Cependant je ne pouvais pas envisager de l’emmener avec moi lorsque viendrait le tour de départ outre-mer. En conséquence, ma famille resterait en France et la séparation durerait trente mois. Pour les Kerguelen le séjour n’était que d’un an.
Enfin je dois bien avouer qu’ayant découvert un jour, tout en bas d’une planisphère, l’existence de cet archipel étiqueté « possession française », j’étais très curieux de savoir sous quel aspect il se présentait.
C’est pourquoi, un beau matin d’Avril, je me suis réveillé à bord d’un énorme avion-cargo survolant une mer de nuages, en route vers Tananarive.
Sur notre droite le Kilimandjaro laissait scintiller son cône de neige aux rayons du soleil levant.
Mes compagnons de voyage somnolaient encore. Ils étaient une quarantaine qui entouraient Roger Pascal, le Chef de Mission : fonctionnaires de la Météorologie Nationale, militaires du Génie ou des Transmissions, agents contractuels divers.
Il me faudrait partager leur vie quotidienne pendant un an . A première vue, ils paraissaient tous avoir une bonne tête, donc cela ne devrait pas être trop dur.
Des caisses à claire-voie avaient été alignées selon l’axe de l’avion. Elles contenaient d’autres passagers : des rennes que l’on avait été chercher en Laponie et des mouflons de Corse. On voulait faire un essai d’acclimatation d’espèces nouvelles dans l’archipel. Ces espèces se sont développées ultérieurement, mais d’après les dernières nouvelles, ce ne serait pas une réussite sur le plan écologique.
Il y avait aussi à bord de notre avion un cageot qui abritait un lapin de garenne provenant du parc de Rambouillet. Il était couvert de puces et chargé officiellement de semer le désordre et la panique chez ses congénères installés depuis plus d’un siècle aux Iles Kerguelen .
En effet un voilier anglais avait, autrefois, déposé à terre quelques lapins dans le but de fournir des vivres à d’éventuels naufragés. Soutenant leur vigoureuse réputation, les lapins ont proliféré, amenant la destruction de la végétation sur presque toute la Grande Terre et accentuant ainsi les phénomènes d’érosion déjà liés aux conditions climatiques. Ils représentaient donc un fléau contre lequel les autorités avaient décidé de réagir en introduisant la myxomatose. Quelques lapins avaient été donc capturés, inoculés et lâchés dans la nature. Comme le résultat semblait se faire attendre, on a pensé qu’il manquait peut-être un insecte ou un acarien vecteur pour transmettre le virus. C’est pourquoi un natif des tirés présidentiels de Rambouillet, avec ses puces, s’était trouvé embarqué pour les Terres Australes.
Mais un mystère plane sur sa véritable destinée.
Au cours des opérations de débarquement, le cageot et son occupant furent amenés à terre et entreposés dans une pièce sombre et tranquille. Or lorsque l’on a voulu rendre la liberté au lapin on s’est aperçu qu’il avait disparu… Des mauvaises langues ont prétendu que des gens malintentionnés l’avaient convié à faire les frais d’un civet clandestin… Des bons esprits ont pensé qu’il avait réussi à s’évader.
Cela a permis d’alimenter la conversation pendant quelques jours. En tous cas de nombreux lapins atteints de myxomatose ont été découverts plus tard à la chasse.
Donc notre avion s’est posé à Arivonimano l’aéroport de Tananarive. Nous avons aussitôt été transférés sur un D.C.3 qui nous a conduit à Tamatave. Le lendemain, nous nous sommes embarqués à bord du « Galliéni » qui a appareillé le jour suivant, 21 Avril, au début de l’après-midi, mettant le cap au Sud-Est droit sur les Kerguelen.
Les premiers albatros sont aperçus le 26 et, par la suite, sont devenus de plus en plus nombreux.
Le 29 au matin, nous avons pu voir l’îlot du Rendez-vous émerger au dessus des vagues.
C’était la première terre de l’archipel.
La mer était calme et il n’y avait pas le moindre souffle de vent. La Météo était optimiste. Le Commandant a donc pris la décision de ne pas contourner l’archipel par l’Est, en suivant la route habituelle, mais de contourner la côte Ouest.
Nous avons ainsi longé, pendant toute une journée, de très hautes falaises qui plongeaient verticalement dans la mer, précédées d’amas de rochers ou de formations en aiguilles. Cà et là s’ouvraient des fjords étroits et, un peu partout, des torrents se déversaient en longues cascade . Au sol, la côte nous est apparue dominée par la masse de la calotte glacière de Coock.
La navigation se poursuivait parmi une myriade d’oiseaux de mer : sternes, damiers du Cap, skuas, goélands, cormorans tourbillonnaient autour de nous tandis que les troupes des manchots plongeaient devant l’étrave à la façon des marsouins.
Le 30, le « Galliéni » avait franchi la Passe Royale lui permettant d’entrer dans la Baie du Morbihan et mouillait devant Port-aux-Français à sept heures du matin.
Je ne sais pas si la « ville » de Port-aux-Français s’est beaucoup développée depuis toutes ces années passées mais, sous le crachin et la grisaille de ces heures matinales, l’alignement des baraques sombres m’a rappelé fâcheusement des souvenirs datant d’une douzaine d’années, l’absence de barbelés étant compensée par l’insularité et l’éloignement…
Fort heureusement cette impression s’est atténuée très vite avec l’accueil des anciens, l’aspect confortable des installations et l’ambiance trépidante du débarquement.
Car les opérations de débarquement n’étaient pas une mince affaire. Il fallait donc descendre des tonnes et des tonnes de matériel sur des portières, les remorquer jusqu’au quai où les grues transféraient tout cela sur les plate-formes des camion .
Le travail était dominé par deux impératifs.
L’un d’ordre budgétaire : les Messageries Maritimes mettaient le « Galliéni » à la disposition des T.A.A.F. (Terres Australes et Antarctiques Françaises) suivant un contrat prévoyant une durée de temps limitée. Donc chaque journée supplémentaire revenait très cher à l’État.
L’autre impératif était lié aux conditions météorologiques. Il n’était pas rare de voir passer cinq ou six jours sans pouvoir mettre une portière à l’eau. J’en ai fait personnellement l’expérience plus tard, au moment de mon départ. Ayant laissé le service de l’hôpital à mon successeur, j’étais monté à bord pour y remplir les fonctions de chef-docker ; or il nous a fallu quatorze jours pour effectuer le débarquement. Deux fois le « Galliéni », pour ne pas risquer de rompre ses amarres et d’être jeté à la côte, a dû quitter le Baie du Morbihan et attendre au large que la tempête soit calmée, tandis qu’à Port-aux-Français un coup de vent avait mis les embarcations à terre et les bulldozers dans l’eau..
Mais, lorsque nous sommes arrivés (début Mai 1956) nous avons eu de la chance car l’accalmie, qui nous avait permis de faire le tour de la Grande Terre par l’Ouest, s’est prolongée si bien que les opérations de débarquement ont été achevées en moins de quatre jours.
Arrivés dans la matinée du 30 Avril nous avons donc pu voir, dans la soirée du 3 Mai, le « Galliéni » s’éloigner pour retourner à Madagascar.
Nous allions rester six mois sans le revoir et sans autres nouvelles de nos familles qu’un message de vingt-cinq mots par semaine.
Nous étions soixante en comptant dix Comoriens et deux Malgaches recrutés à Tananarive pour s’occuper des travaux ménagers ou des fonctions d’aides mécaniciens.
Avec le système institué qui assurait la relève du personnel par moitié deux fois par an, il y avait donc deux groupes : les anciens qui savaient tout, prenaient des airs blasés ou condescendants et les nouveaux qui s’étonnaient de tout et se refusaient à l’avouer… Ces deux groupes s’observaient avec méfiance, échangeant parfois des escarmouches verbales. Mais l’équilibre s’est rétabli assez vite parce que ceux qui émergeaient du lot et siégeaient au restaurant à la table dite « des officiers » se sont bien entendus entre eux, anciens comme nouveaux.
D’autre part, trois semaines après notre arrivée, « L’Ob » bateau océanographique russe revenant de l’Antarctique, s’est présenté devant la Passe Royale demandant l’autorisation de faire escale à Port-aux-Français. Ce qui lui fut accordé.
Cela a donné lieu à une journée mémorable de fraternisation franco-soviétique avec déjeuner à terre particulièrement soigné (c’était d’ailleurs le jour de la Pentecôte) suivi d’une visite du bâtiment et d’un dîner à bord. D’un côté Champagne, Cognac et vins de France, de l’autre Vodka et Champagne de Crimée. L’ambiance joyeuse et le souvenir de quelques cuites sensationnelles a achevé de cimenter la cohésion des habitants des Kerguelen.
Les six premiers mois se sont donc déroulés avec une certaine sérénité. Les suivants ont été, peut-être, moins heureux. D’abord nous étions devenus des anciens blasés, préoccupés surtout par le retour du « Galliéni » qui devait nous reprendre. Ensuite nous étions plus de cent avec un détachement du Génie de l’Air chargé de l’implantation d’un aéroport dont on avait rêvé en haut lieu. Ce détachement logeait à l’écart dans des bâtiments qu’il avait édifiés lui-même et ne prenait pas ses repas dans la salle du restaurant devenue trop petite.
Enfin il y avait avec nous deux femmes. L’une était l’épouse de l’Administrateur Supérieur des Terres Australes et Antarctiques qui avait suivi son mari pour lui servir de secrétaire. L’autre était l’épouse d’un capitaine du Génie. Celui-ci, qui avait déjà fait trois ou quatre séjours, était considéré comme un homme précieux. Il n’avait accepté de revenir une fois de plus qu’à la condition d’emmener sa femme avec lui. Un peu plus âgée que nous, elle était discrète et gentille, nous rendant volontiers de grands services lorsque nous étions en face d’un problème d’ordre vestimentaire trop ardu à résoudre avec nos pauvres compétences.
J’avais à ma disposition un petit hôpital avec une installation de radio, une salle d’opération, un fauteuil de dentiste et un équipement médico-chirurgical limité mais toutefois suffisant pour faire face à un coup dur.
Il me manquait un personnel qualifié car les T.A.A.F., à l’époque, refusaient de prendre en charge la solde d’un infirmier. Lorsque j’avais besoin d’aide, j’étais obligé de faire appel à des bonnes volontés. C’est ainsi que j’ai converti mon ami André Beaugé, ancien prêtre-ouvrier qui était venu aux Kerguelen espérant y trouver quelque apaisement à ses cas de conscience, en aide-soignant. Et Monsieur Redonnet, l’adjoint au Chef de District était ravi de pouvoir me prêter main forte au cours de petites interventions chirurgicales.
Ma qualification apportait une note sécurisante à l’Administration des T.A.A.F. qui rappelait avec angoisse le souvenir de deux ou trois appendicites qui avaient donné du souci à des prédécesseurs peu habitués à manier un bistouri.
Or, par ironie du sort, je n’ai eu presque aucun acte chirurgical à pratiquer à l’exception de quelques fractures sans déplacement, de quelque plaies sans gravité et de deux circoncisions chez des bergers malgaches appartenant à l’ethnie Antandroy et qui devaient traditionnellement subir cette opération aux environs de la vingtième année.
A côté de cela, pendant plusieurs semaines, j’ai été tracassé par une épidémie d’allure grippale, dont j’ai d’ailleurs été une des premières victimes, qui se présentait comme une fièvre prolongée et très élevée rebelle à tous traitements. Ne pouvant pas établir un diagnostic, je me suis mis en rapport par phonie avec un médecin de l’Hôpital Girard et Robic de Tananarive qui a pu me soutenir par quelques conseils et, ultérieurement, m’a aiguillé vers l’Institut Pasteur dès notre retour en France. Des prises de sang ont été faites à une dizaine d’entre nous ; ce qui a permis au Professeur Giroud d’annoncer avec enthousiasme les cas les plus austraux de la Fièvre Q., probablement introduite dans l’archipel avec le fourrage provenant de Madagascar et destiné à notre bétail. Vétérinaire d’occasion, je m’étais fait contaminer ainsi que tous ceux qui allaient faire un tour à la ferme comme ils auraient été le Dimanche au Zoo.
Communication de Jacques Bourlaud sur les syndromes pseudo-grippaux ...
(Cliquer sur chaque image pour la voir en plus grand)
[si vous souhaitez lire la totalité de la communication, vous la trouverez là : http://web2.bium.univ-paris5.fr/livanc/?cote=bspex1957&p=929&do=page]
Malgré cela, en présence d’un personnel relativement jeune et ayant subi une sélection avant l’embarquement, mon activité professionnelle était assez réduite. J’occupais mes loisirs en récoltant quelques échantillons pour le Museum d’Histoire Naturelle. Recherche de certains poissons, préparation de crânes d’otaries ou de léopards de mer, « mise en peau » de différents oiseaux de mer comme les pétrels, tout cela me permettait de ne pas m’ennuyer .
Au cours de mes promenades je tirais des lapins et des sarcelles ou bien je prenais des photos dans les harems d’éléphants de mer et dans les roockeries de manchots. Ces animaux n’éprouvaient aucune crainte à notre égard sauf, bien sûr, les lapins et les sarcelles. Nous pouvions circuler au milieu d’eux et c’est à peine s’ils s’écartaient pour nous laisser passer. Il fallait cependant se méfier des grands mâles éléphants de mer qui, en période de reproduction, devenaient agressifs et pouvaient alors charger. Ils n’étaient pas rapides mais ils pesaient deux tonnes…
Pour qui aimait la nature et les animaux, le spectacle était passionnant mais sa répétition quotidienne finissait par le rendre monotone. Les nouvelles de nos familles arrivaient « au compte-gouttes » . Personne n’en parlait mais chacun gardait un fond de mélancolie qu’il cherchait à dissimuler par des propos égrillards ou une attitude fanfaronne.
Je me suis mis alors à écrire.
D’abord un conte destiné à nos enfants, Le Manchot Papou. (cliquer là pour le lire)
Ce conte est daté du 13 Août 1956 et j’ai eu, ensuite l’idée saugrenue de reculer un peu plus loin dans le passé la découverte des Iles Kerguelen. Ce qui m’a conduit à rédiger le texte sur la véritable histoire de la découverte de Kerguelen. (cliquer là pour le lire)
Depuis 1949, époque où une base permanente a été établie au lieu-dit Port aux Français, les îles Kerguelen ont fait l’objet de nombreuses publications : aussi bien des articles sérieux d’une solide valeur scientifique que des reportages dans la grande presse.
C’est pourquoi je n’ai pas l’intention de m’appesantir sur l’aspect de l’archipel, sur les paysages, sur les conditions climatiques dominées par la très grande fréquence des vents d’Ouest atteignant parfois 250 kilomètres à l’heure, sur la flore et la faune. Tout cela a été décrit maintes fois.
Je voudrais cependant rappeler quelques images que je ne saurais oublier .
Une promenade de deux jours par calme plat, en plein hiver austral dans la Baie du Morbihan. Une mer limpide, un ciel bleu, de la neige partout, le cheminement de notre petit bateau entre les îlots déchiquetés et le long des hautes falaises de basalte . Nous étions cinq à nous laisser envahir en silence par une impression envoûtante de paix et de sérénité grandiose que je n’ai plus jamais ressentie ailleurs ;
Ce sentiment que nous avions éprouvé alors était absolument opposé à celui qui nous a agressé une autre fois lorsque nous sommes partis à bord de véhicules chenillés sur la côte Est pour effectuer un recensement des éléphants de mer. Il y en avait des milliers répartis en harems sur de longues plages, dans un grouillement effarant d’énormes corps vautrés sur le sable ou les galets. Les femelles mettaient bas, les mâles s’activaient à les couvrir presque aussitôt ou encore se battaient sauvagement contre les célibataires qui attendaient au bord de l’eau pour essayer de tenter leur chance. Le tout dans un vacarme assourdissant : grognements et éructations des éléphants de mer, piaillements des oiseaux qui venaient s’associer à ce tableau dantesque. On voyait tournoyer sous un ciel bas et gris les skuas et les pétrels géants. Par moments, ils piquaient sur la masse des grands phoques et se disputaient les placentas tandis que les chionis, semblables à des petits poulets blancs, circulaient à terre, guettant par ci, par là un bon morceau.
Lorsque le 27 Mai 1957, le « Galliéni » nous a ramené vers des rivages plus fréquentés, nous étions, bien sûr, heureux à la pensée de revoir bientôt nos familles, cependant en regardant la côte s’estomper dans la brume, nous avions conscience d’avoir vécu là-bas non pas des aventures extraordinaires mais dans une ambiance, somme toute cordiale, quelques moments hors du commun.