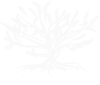Jacques Bourlaud 🩺 - Jeunes années
La rue de la Tranchée est une des plus anciennes rues de Poitiers. Elle tire son nom de l’existence à l’époque gallo-romaine (et sans doute bien avant) d’un fossé creusé de main d’homme qui reliait la vallée de la Boivre à celle du Clain et complétait ainsi le système de défenses naturelles formé par la confluence de ces deux rivières qui ont entaillé profondément le plateau calcaire.
Bien sûr le tracé et l’aspect de cette rue a beaucoup évolué au cours du temps, mais son apparence actuelle date de la fin du XVIII° siècle lorsque le Comte de Blossac, Intendant du Poitou, a fait aménager le parc qui porte son nom et surtout du XIX°, correspondant à l’essor d‘une bourgeoisie active et aisée.
Les deux premiers tiers de la rue offrent une succession de maisons hautes et massives dont la façade austère laisse une impression de solidité et de respectabilité. Aspect heureusement égayé par la présence de deux ou trois petits hôtels particuliers évoquant les fastes frivoles d’une époque sans souci (du moins pour certains).
Mais au delà de la grille de Blossac la rue prend un autre visage. Elle est en pente, nettement moins large, avec des trottoirs plus étroits, parfois même inexistants. Les maisons sont beaucoup plus basses, plus vieilles et ne respectent pas toujours l’alignement. On voit un peu partout s’ouvrir des boutiques de petits commerçants ou des ateliers d’artisans.
Très net autrefois, le contraste entre les deux parties a tendance à s’estomper du fait de la création récente d’immeubles et aussi d’une certaine évolution sociale.
Mais dans mon enfance, les familles notables et plus ou moins bien rentées qui vivaient en deçà de la grille de Blossac faisaient bien remarquer qu’elles habitaient « rue de la Tranchée », tandis qu’au delà de la grille des gens très dignes mais de condition plus modeste s’entassaient dans « La Tranchée ». Distinction subtile qui ne témoignait pas tellement d’un quelconque mépris mais plutôt d’une sorte de bonhommie paternaliste. Les patrons demeuraient « rue de la Tranchée », leurs employés qu’ils aimaient bien, disaient-ils, dans « la Tranchée »…
Je suis donc né fin Décembre 1919 au 35 bis rue de la Tranchée (on a sa petite vanité…) dans une maison à trois étages que mon arrière-grand-père, entrepreneur en bâtiments, avait fait construire aux environs de 1870.
Par derrière, la maison s’ouvrait sur un jardin assez plaisant avec un palmier, un sapin, des lilas et une volière, jardin qui se prolongeait par une terrasse formant un balcon surplombant de quelques mètres le parc de Blossac.
Un couloir central d’où partaient deux grandes cages d’escalier divisait a maison en deux parties. À droite habitait ma grand-mère, à gauche mes parents. En outre le second étage avait été aménagé pour constituer un appartement destiné à des locataires.
Les quinze premières années de ma vie se sont déroulées dans ce cadre avec, en plus, les périodes de vacances à la campagne, à Coulombiers.
Petit garçon venu au monde assez longtemps après mon frère et mes sœurs, « ricoquet » comme on dit en Poitou, je me sentais un peu seul dans cette grande maison et, de ce fait, porté à la rêverie.
Or, dans ce couloir que je traversais vingt fois par jour et où j’allais quelquefois jouer, deux grandes panoplies accrochées au mur attiraient toute mon attention. L’une présentait un éventail de lances et de sagaies, l’autre un ensemble d’épées touarègues, de couteaux, d’arcs et de carquois. De plus, dans le renfoncement qui permettait l’accès à une des cages d’escalier, un pélican empaillé déployait ses ailes sur un rocher artificiel.
A cette vue mon imagination prenait son essor et m’entraînait vers des horizons lointains à la découverte de paysages exotiques, à la recherche d’aventures héroïques que je réalisais aussitôt d’une façon concrète dans le jardin ou à Blossac et encore mieux à Coulombiers.
Je puisais mon inspiration dans mes lectures d’alors : « Gédéon en Afrique », « La Famille Fenouillard », « Robinson Crusoé », « Robinson Suisse » et bien d’autres. Mais j’avais aussi trouvé une source au débit plus vigoureux dans la bibliothèque de mon père sous la forme du « Journal des Voyages » datant de 1890 à 1905. Cette publication abondamment illustrée offrait au lecteurs des romans d’aventures mais aussi des articles plus sérieux : récits d’explorateurs, journaux de bord de marins, souvenirs d’officiers. Tout cela se situant à la grande époque d’expansion coloniale. Cela représentait une dizaine de volumes que je parcourais dans tous les sens, m’attardant d’ailleurs beaucoup moins sur les textes que sur les illustrations.
Les Poitevins sont assez volontiers attirés par les mirages d’Outre-Mer. De Nantes à Bordeaux la façade atlantique n’est pas très éloignée. Mon père avait donc, lui aussi, subi cette tentation mais ne lui avait pas donné suite, sans doute parce qu’il s’était marié très jeune. Pourtant, au retour de la guerre de 1914/18, aux alentours de ma naissance, il était allé travailler deux ans au Maroc dans une société d’import-export.
Cependant son meilleur ami, Fernand, y avait succombé.
Il était devenu Administrateur des Colonies. C’était lui qui avait fait cadeau à ma mère du pélican. La mode voulait alors que les femmes portent des chapeaux décorés d’ailes, voire d’oiseaux entiers… Estimant l’envergure du pélican un peu démesurée, ma mère avait renoncé de l’utiliser dans ce but et préféré le faire empailler.
Homme d’une haute stature et d’une belle apparence, généreux et sympathique, il était très enclin à courtiser les femmes élégantes et avait fini, sur le tard, par épouser une femme charmante beaucoup plus jeune que lui et qui s’efforçait de l’assagir.
Entre les deux guerres il avait quitté l’Administration pour tenter sa chance dans le secteur privé en participant à la création de sociétés destinées à mettre en valeur les terres lointaines. Il avait ainsi brassé beaucoup d’argent et terminé sa vie ruiné, mais toujours grand seigneur.
On le voyait surgir inopinément tous les deux ou trois ans ; il demeurait quarante-huit heures chez nous puis repartait pour le Soudan ou la Haute-Volta .
Intelligent et cultivé, il tenait toute la famille sous le charme de sa conversation, racontant des histoires passionnantes, habilement enjolivées, que mes parents accueillaient avec une nuance de scepticisme amical mais que je gobais sans la moindre restriction mentale.
Ces courtes apparitions me replongeaient, bien sûr, dans mes rêves avides de merveilleux et quelque-peu divagants mais, plus tard alors que ma décision était prise, je l’ai revu plusieurs mois avant sa mort et je lui sais gré de m’avoir encouragé et de m’avoir montré les difficultés mais aussi les grandeurs du métier que j’avais choisi.
Dans mon enfance je voyais aussi très souvent deux jeunes filles d’origine antillaise dont le père était fonctionnaire des douanes à Dakar. Amies de mes sœurs qui les avaient connues au collège, elles apportaient, rue de la Tranchée, une note d’exotisme les soirs d’hiver en parlant de leur pays ensoleillé, de leur famille et de voyages en mer.
Mais j’avais huit ans lorsque ma sœur aînée épousa un colonial qui devait l’emmener avec lui dans une plantation de palmiers à huile dont il assurait la gérance au Gabon.
Le Gabon devint donc le sujet d’entretien de toute la famille. Ma grand-mère faisait remarquer que Monseigneur Augouard, un Poitevin, y avait vécu. Cependant les esprits chagrins affirmaient que c’était-là un pays malsain et que ma sœur et son mari y contracteraient toutes « les fièvres »…
Pour moi, j’étais délirant. Le Gabon c’était le pays qui avait de si jolis timbres avec un guerrier pahouin emplumé, au visage couturé d’incisions raciales ; le pays de la forêt-vierge, des éléphants, des gorilles… Justement mon beau-frère, connaissant ma curiosité pour les animaux, m’avait envoyé un magnifique crâne de gorille…
Je suis ainsi resté pendant deux ans dans l’attente fascinante de colis mystérieux, de photos exaltantes montrant des paysages insoupçonnés ou des trophées de chasse.
Lorsque, de retour à Poitiers, le jeune ménage avec deux neveux tout neufs s’est installé dans l’appartement du second étage je m’y rendais tous les jours pour poser des tas de questions sur la vie outre-mer, l’Afrique en général et le Gabon en particulier.
J’étais bien décidé maintenant à me lancer dans une carrière coloniale .
Mais quelle carrière ?
En grandissant j’avais dû écarter quelques options jugées peu réalistes mais qui, pourtant, m’avaient tenu à cœur.
C’est ainsi que la capture des grands fauves et autres animaux sauvages dans le but de peupler les parcs zoologiques de France et de Navarre n’avait pas rencontré dans ma famille l’accueil enthousiaste que j’avais espéré… C’était, paraît-il, un métier plein d’aléas et dont le profit n’apparaissait pas évident.
Je m’étais donc rabattu sur la profession d’explorateur dont le prestige aurait dû impressionner mon entourage. Mais on m’avait objecté que, pour me lancer sur cette voie, il fallait disposer d’une foi d’une platitude écœurante.
.
Les adultes ramènent tout à des préoccupations contingentes d’ordre scolaire comme si les subtilités d’une version latine ou la recherche d’un plus petit commun multiple étaient nécessaires pour découvrir les sources du Congo !
Il fallait bien en passer par là !..
- Pourquoi ne cherches-tu pas à entrer dans l’Administration Coloniale ? me dit un jour ma sœur.
Tu fais une Licence en Droit. Tu passes un concours.
Après c’est la belle vie… Tu es le patron d’un grand territoire. Tu traces des routes, tu bâtis des écoles, des hôpitaux…
Pourquoi pas, en effet ?
J’avais à l’époque treize ans et ne doutais de rien.
Pour administrer tout un territoire, je n’aurais qu’à suivre les instructions qui me seraient données d’en haut ! C’était simple…
Pour tracer les routes, comme je parcourrais tout le pays à pied, à cheval ou en voiture, je n’aurais qu’à me faire suivre d’une armée de débroussailleurs ! Quant aux constructions, rejeton d’une longue lignée de maîtres-maçons, l’atavisme me ferait spontanément trouver toutes les solutions et d’ailleurs je n’aurais qu’à commander pour que tout soit exécuté…
Les études de Droit me tracassaient un peu. Je n’avais aucune idée de ce que cela pouvait bien être. J’imaginais des cours fastidieux dans un jargon désuet sur des sujets sordides, le tout dans l’ambiance triste et poussiéreuse d’une étude de notaire. Mais il suffirait de s’y mettre et j’en arriverai bien à bout.
Peu après ce choix qui me paraissait avoir été dicté par la raison, il advint que le banquet annuel des anciens élèves du Lycée Henri IV fut présidé par une notabilité poitevine qui avait achevé une brillante carrière comme Gouverneur-Général de l’Indochine .
Mon père, ancien élève, avait ainsi eu l’occasion de le rencontrer de parler avec lui et de lui confier que son plus jeune fils se destinait à l’Administration Coloniale.
- C’est un métier passionnant mais qui est tellement astreignant ! Il réclame la vigilance de tous les instants et les journées n’ont pas trop de vingt-quatre heures pour accomplir la moitié de ce qu’il aurait fallu faire…
On ne connaît ni Dimanches ni Fêtes… On est toujours sur la brèche, sans trêve ni repos…
Mais il y a d’autres carrières : la Magistrature Coloniale… la Médecine Coloniale, par exemple…
Ces propos qui me furent rapportés le lendemain me rendirent tout perplexe.
Pouvais-je envisager une profession dont les exigences ne me laisseraient aucun moment de loisir ?
Ce n’était pas pensable !..
Alors que faire ?
La Magistrature ne me tentait pas du tout .
Mais la Médecine ?
Mis à part deux cousins installés dans le Midi et qui ne venaient que rarement à Poitiers il n’y avait pas de médecin dans notre entourage immédiat pour me conseiller sur ce point . Cependant l’intérêt que je portais aux Sciences Naturelles m’inclinait à penser que mes études pourraient en être facilitées.
Je serai donc Médecin Colonial .
Ma sœur et mon beau-frère m’encouragèrent vivement sur cette voie.
Et les années suivantes me permirent progressivement de réaliser ce projet.
J’avais donc choisi une carrière pour pouvoir voyager en des pays nouveaux et aussi pour ne pas être trop écrasé par le travail et bénéficier ainsi de temps libre pour flâner et rêver…
Comme je me suis rapidement orienté vers la Chirurgie et l’Obstétrique et que j’ai été le plus souvent seul à mon poste pour exercer ces disciplines, il est facile d’imaginer le nombre de week-ends paisibles et de nuits reposantes que j’ai connus ...