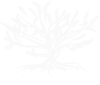Jacques Bourlaud 🩺 - Indochine
- Ah ! C’est vous le nouvel assistant ?
- ……………
C’est à peu-près ce que m’a dit le Médecin-Général.
Passif et indifférent, je l’écoutais parler, ou plutôt, j’entendais le son de sa voix.
J’avais l’impression d’être au théâtre, spectateur d’une pièce où j’aurais été moi-même figurant.
Je devais avoir l’air particulièrement abruti car il m’a demandé, avant de me congédier, si j’avais fait bon voyage.
Il n’y avait guère plus d’une heure que l’avion m’avait déposé à Tran-Son-Nut après trois nuits écourtées, passées sur des sièges inconfortables. Au début c’était pourtant assez agréable . Nous avions survolé la Méditerranée, la Sicile et les îles grecques. Escale à Beyrouth, suivie d’une vue plongeante sur le désert syrien. Réveil à Bagdad, qui paraissait bien cacher aux voyageurs en transit les splendeurs des Mille et une Nuits. Puis nous avons suivi la côte du Golfe Persique : à droite le bleu de l’Océan, à gauche l’ocre du sable . Mais à partir de Karachi, les nuages nous ont privé de tout paysage terrestre que nous n’avons retrouvé qu’en atterrissant à Calcutta dans la nuit sous l’aspect de milliers et de milliers de points lumineux perçant l’obscurité.
Les changements de fuseaux horaires nous avaient imposé un rythme de vie incohérent, nous arrachant à quelques heures d’engourdissement pour nous jeter sans transition devant des tables de restaurants.
Si bien qu’en me présentant à la Direction du Service de Santé des Forces Terrestres d’Extrême-Orient, à une heure très matinale, je ne savais plus exactement où j’en étais.
_ « C’est le poste chirurgical de Dong-Hoï. », avais-je cru entendre.
Ainsi-donc on m’avait affecté à Dong-Hoï. Dong-Hoï ou ailleurs à première vue cela m’était égal .
Mais en descendant l’escalier, je me suis aperçu qu’à Dong-HoÏ je serai seul alors que j’aurais préféré, au moins pour quelques mois, travailler en second sous la direction d’un camarade plus expérimenté.
D’autant plus que mes connaissances en chirurgie de guerre étaient uniquement livresques, ne voulant pas m’appuyer sur une très petite pratique acquise en Autriche en 1945.
C’est pourquoi j’ai fait part de mes scrupules au Chirurgien-Consultant des F.T.E.O. et celui-ci, après m’avoir considéré un instant de son œil unique, finit par trouver une solution. Il était inutile que je rejoigne Dong-Hoï avant deux ou trois semaines ; en attendant il m’envoyait à l’Hôpital 415 où je m’installerai en permanence au bloc opératoire, participant au travail des équipes chirurgicales qui se relayaient sur le rythme des trois-huit .
Le lendemain j’étais donc sur place et je n’ai, pour ainsi dire, pas quitté le bloc opératoire jusqu’au jour où j’ai pris l’avion pour Hué et, de là, pour Dong-Hoï .
La Province de Dong-Hoï se présentait sous l’aspect d’une plaine allongée du Sud au Nord, constituée par des rizières, des marais et une brousse à la végétation peu élevée. A l’Ouest elle se perdait dans les premiers contreforts de la Chaîne Annamitique ; à l’Est elle était bordée par la mer mais la côte n’était guère accessible qu’à l’embouchure des fleuves côtiers, là où s’élevaient d’ailleurs les villes les plus importantes : Dong-Hoï et, plus au Nord QuangKhé. Au delà de Quang-Khé s’étendait la Province de Vinh, entièrement occupée par le Viet-Minh et qui séparait le Centre-Vietnam du Tonkin.
Bâtie entre le fleuve et les rizières, Dong-Hoï était constituées de deux agglomérations distinctes situées de part et d’autre de la vieille citadelle. D’un côté le centre commercial et administratif avec des maisons « en dur », des entrepôts, des restaurants et même un cinéma . De l’autre, des constructions en matériaux légers, entourées de haies de quassias et plus ou moins alignées sur des rues convergeant vers la place de l’église. Entre les deux agglomérations, l’ensemble massif et polygonal de la citadelle construite en briques et encerclée par un fossé à sec où étaient disposées des tombes de soldats datant de la conquête.
La défense du Secteur était assurée par une grosse garnison cantonnée à Dong-Hoï dans la forteresse et ses alentours immédiats ainsi que par un certain nombre de postes isolés échelonnés du Nord au Sud depuis Quang-Khé tout le long de la R. C.1 (la Route Mandarine) ou bien placés pour contrôler les pistes qui s’enfonçaient vers la montagne.
Le commandant du Secteur avait à sa disposition un bataillon de Légionnaires et au moins un bataillon de l’Armée Nationale Vietnamienne.
Ces forces bénéficiaient de l’appui d’un escadron du 1° R.E.C., d’une batterie de 105, d’une compagnie de Génie et d’une unité des Transmissions ainsi que d’un contingent assez important de supplétifs.
Cependant, à proximité de la Province de Vinh et de la montagne où les Viets allaient et venaient comme ils le voulaient, notre situation n’était pas des plus confortables. Nous ne pouvions pas nous promener en dehors de la ville et, pour se rendre au terrain d’aviation distant de six à sept kilomètres, il était plus prudent de se faire accompagner par un chauffeur armé d’un pistolet-mitrailleur.
Nous pensions tous qu’un jour ou l’autre l’adversaire chercherait à effectuer un coup de force sur Dong-Hoï.
En fait il n’a rien tenté de sérieux avant la fin des hostilités. Mais, chaque jour, chaque nuit, des éléments viet-minh plus ou moins étoffés réussissaient à s’infiltrer pour aller poser des mines sur les routes ou rançonner les villageois. Les postes extérieurs à Dong-Hoï étaient mis en alerte. Parfois même ils étaient attaqués et ripostaient. Si la pression des Viets était trop forte, les postes faisaient alors appel à l’artillerie. La pression se relâchait mais, le lendemain, on voyait arriver à Dong-Hoï des blessés civils qui avaient reçu des « éclaboussures » des deux côtés.
Deux ou trois fois par semaine, le Commandant du Secteur faisait procéder à des ouvertures de routes pour aller ravitailler les postes isolés. Au cours de ces opérations, il se produisait assez fréquemment des petits accrochages avec échange de coups de feu et il arrivait encore plus souvent de voir un véhicule sauter sur une mine.
Tout cela entraînait un apport quotidien de blessés à l’hôpital. Ils arrivaient soit pas cas isolés soit par groupes d’une trentaine lorsque l’accrochage avait été sérieux. Nous recevions indifféremment les militaires des Forces Françaises d’Extrême-Orient, les soldats vietnamiens, les supplétifs et les prisonniers viet-minhs. Les blessés civils étaient présentés pour être opérés chez nous car il n’y avait pas de chirurgien à l’hôpital de la Province et, lorsque leur état était stabilisé, nous les renvoyions dans leur formation sanitaire qui se trouvait d’ailleurs de l’autre côté de la rue.
L’Infirmerie-Hôpital où j’avais été affecté portait le nom du Médecin-Sous Lieutenant Robuchon, tué à l’ennemi au début de la campagne du Corps Expéditionnaire. Elle était construite en bordure du fleuve et se présentait sous l’aspect d’une dizaine de pavillons « en dur » auxquels étaient annexés trois baraques « Adrian ». Ces bâtiments étaient répartis parmi les filaos et les ficus dans un enclos bien entretenu limité par des haies de quassias.
Compte tenu de l’époque et des circonstances, mon service était correctement équipé pour me permettre d’effectuer un travail assez précis. J’ai pu bénéficier de l’aide efficace d’infirmières anesthésistes très compétentes et d’un personnel bien entraîné . Les séances opératoires étaient évidemment dominées par des actes de chirurgie de guerre : parages de plaies, extractions d’éclats, appareillage provisoire des fractures avant leur évacuation, laparotomies exploratrices suivies de sanctions thérapeutiques comme des résections intestinales ou des extériorisations coliques se succédaient chaque jour.
Et ainsi passaient les semaines . Les soucis ou les satisfactions professionnelles permettant de supporter avec patience l’éloignement et l’attente du courrier, attente d’autant plus aiguë que j’avais laissée en France ma femme enceinte de son cinquième enfant.
Mais si la situation était relativement calme à Dong-Hoï, il n’en était pas de même ailleurs . En Mai nous avons appris la chute de Dien-Ben-Phu . L’effort des adversaires allait-il, maintenant, se porter sur le Centre-Vietnam ? La région de Tourane fut effectivement menacée . Le tour de Dong-Hoï viendrait sans doute après ? C’est ce que beaucoup semblaient penser et c’est probablement la raison qui a poussé la Direction du Service de Santé des F.T.E.O., après une visite d’inspection, à vouloir augmenter le nombre du personnel et améliorer l’équipement comme l’infrastructure de mon hôpital.
Mon camarade Peretti, rapatrié en Juin pour fin de séjour, avait été remplacé par Mademoiselle Wilm, femme d’une haute valeur morale et professionnelle. De ce fait j’étais devenu Médecin-Chef.
A ce titre il m’a été prié de commander du matériel pour que notre laboratoire puisse faire autre chose que des « gouttes épaisses », des numérations-formules et des examens de selles. Lorsque la commande serait honorée, on me promettait l’affectation d’une laborantine . A sa place se présentait un dentiste athlétique et alsacien dont la principale occupation fut bientôt de nous aider à déménager …
Car, pendant que je rêvais d’embellissements pour mon hôpital, (n’avais-je pas appris qu’une somme élevée avait été mise à ma disposition pour entreprendre des travaux d’assainissement), des gens beaucoup plus importants que moi négociaient à Genève les conditions d’un « cessez le feu ».
Or la Province de Dong-Hoï, située au Nord du dix-septième parallèle devait être mise entre les mains des Viets.
C’est pourquoi il fallait désormais préparer ses bagages, emballer le matériel et les médicaments, démonter les lits, évacuer les blessés et les malades sur Hué ou sur Tourane tout en continuant une activité chirurgicale.
En effet, dans la dernière semaine de Juillet, les Viet-Minh se sont manifestés. Ils auraient voulu prendre pied à Dong-Hoï, attirés par la présence de dépôts d’hydrocarbures et de vivres. Le Commandant a dû faire appel à un bataillon de parachutistes pour dégager la ville et éloigner les assaillants.
Mais l’hôpital se vidait. Il n’était plus possible d’opérer correctement les blessés. Il fallait, sauf en cas d’extrême urgence, les mettre en condition pour être évacués par le premier avion disponible.
Les hostilités se sont arrêtées le 1° Août au matin. Il ne devait donc plus, en principe, se présenter d’autres blessés. Mais, pour ne pas perdre la main, nous avons reçu des accidentés de la route et même une hernie étranglée.
Puis nous avons rassemblé les familles de nos militaires vietnamiens (infirmiers ou chauffeurs) et un L.C.M. de la Marine les a prises à son bord pour les emmener à Tourane.
Avec elles se sont embarqués la plupart de nos employés civils.
La situation de ces derniers était réellement tragique. On leur avait donné le choix : partir ou demeurer sur place.
Nguyen-Van-Chau, le stérilisateur, qui depuis plus de vingt ans travaillait au bloc opératoire, avait pris la décision de rester. Il ne pouvait pas se résigner à quitter la région où il était né, où il avait toujours vécu, où se trouvaient les tombeaux de ses ancêtres. Il collectionnait les certificats élogieux que tous les chirurgiens français qui se sont succèdés à Dong-Hoï lui avaient établis avant leur départ. Il m’en a donc demandé un, à moi qui étais le dernier à occuper ce poste. Je n’ai pas pu refuser de lui accorder cette ultime satisfaction. A quoi son certificat a-t-il pu lui servir quand les Viets se sont présentés le lendemain ?
Notre vieux cuisinier, que l’on avait surnommé Ho-Chi-Minh, était catholique et avait préféré partir. Avant que le bateau n’appareille il est descendu sur le quai pour venir m’embrasser… J’ai pensé au baiser de Judas… et c’était moi Judas…
Ce sont toujours les humbles qui font les frais des grands événements et cela laisse inévitablement une impression amère à ceux qui ont conscience de les avoir abandonnés.
Les accords prévoyaient que les bâtiments « en dur » devaient être laissés intacts mais vides. Le baraques « Adrian » n’entrant pas dans cette catégorie, nous les avons démontées pour en emporter les éléments.
Non seulement le matériel technique mais aussi tout le mobilier a pris la route du Sud. Le mât de pavillon a été scié et emmené ; son socle, où avait été moulé en relief l’insigne du Corps de Santé des Troupes Coloniales, a été recouvert d’une chape en ciment.
Enfin, le 1° Août au lever du jour, nous sommes partis. Au volant de ma jeep, je prenais la tête d’un convoi d’une dizaine de véhicules qui, grâce à l’acharnement et à la débrouillardise de Conchon, jeune sous-officier du Train des Équipages chargé de leur entretien, pouvaient sans trop de difficultés, si on ne pressait pas trop l’allure, nous mener au but qui nous avait été désigné.
De toutes façons il n’était pas possible de faire de la vitesse sur une route qui avait subi depuis dix ans les tirs de mortiers et d’artillerie et sur laquelle les Viets avaient disposé un nombre incalculable de mines. Il fallait chercher son chemin en louvoyant entre les trous et, s’ils étaient trop rapprochés ou trop grands, descendre jusqu’au fond pour remonter de l’autre côté. Tous les ponts étaient coupés . Le Génie avait bien rétabli le passage sur les grandes rivières mais, pour les autres, nous devions les franchir à gué tant bien que mal.
Nous sommes enfin arrivés à Quang-Tri au début de l’après-midi sans avoir eu à déplorer d’incidents mécaniques. Le soir, nous étions à Hué et, le lendemain, nous avons passé le Col des Nuages pour redescendre sur Tourane.
Là, j’ai dû discuter avec les services administratifs de l’hôpital qui, pour des raisons d’ordre budgétaire, hésitaient à embaucher mon personnel civil à qui on avait promis un reclassement. Puis on me fit comprendre gentiment que le mobilier que j’avais ramené ne valait pas grand chose, que j’aurais pu tout aussi bien le laisser aux Viets et que cela n’aurait pas été une très grosse perte…
Je ne suis donc pas resté trop longtemps dans cette ville et suis reparti pour Quang-Tri rejoindre ma nouvelle affectation avec la moitié de mon personnel militaire et quelques-uns de mes véhicules
La Province de Quang-Tri, avec ses rizières et le point de départ d’une route en direction du Laos avait particulièrement souffert pendant la guerre .
L’hôpital avait subi les conséquences de cet état de choses. On n’avait jamais eu le temps d’en améliorer l’aspect pour lui donner, comme à Dong-Hoï, un visage plus attrayant .
De plus, installé dans les bâtiments réquisitionnés d’un collège avec des constructions annexes entassées dans un espace restreint, il n’avait rien de fonctionnel .
J’étais-là, en quelque sorte, dans la situation d’un locataire d’un immeuble car je n’avais pas été affecté à l’Infirmerie-Hôpital de Quang-Tri mais comme Médecin-Chef d’une Antenne Chirurgicale Mobile stationnée dans cette formation sanitaire (et qui d’ailleurs n’était mobile que sur le papier . Cela me mettait en « porte à faux » vis à vis du camarade à qui incombait la direction de l’hôpital et qui était moins ancien que moi .
Ainsi une grande partie de mon ancien personnel de Dong-Hoï (et notamment les Vietnamiens) avait été affectée à l’hôpital et non à l’antenne . Je n’avais donc plus autorité sur eux mais ils me considéraient toujours comme leur patron et avaient systématiquement recours à moi lorsqu’ils avaient des problèmes à régler .
D’autre part pour des raisons que je n’ai pas cherché à connaître et qui remontaient à une époque antérieure à mon arrivée à Quang-Tri, il semblait qu’il y eut un certain désaccord entre le commandement et l’hôpital .. Ce qui ne facilitait pas les choses si l’on avait besoin d’aide pour des travaux d’amélioration des locaux ou même de nettoyage .
Cependant, à partir de Novembre 1954, la nomination d’un Médecin-Chef qui avait la même ancienneté que moi et une assez forte personnalité a permis de redresser la situation.
J’ai malgré tout connu de bons moments à Quang-Tri en compagnie de gens sympathiques et en profitant de la période calme quia succédé aux hostilités. En effet le Viet-Minh s’étant retiré officiellement au Nord du dix-septième parallèle, la circulation était devenue libre et rien ne nous empêchait d’aller nous promener en direction de la montagne, de nous enfoncer dans les galeries forestières, de faire une halte au bord des rivières, recherchant des plages où nous pouvions nous baigner et découvrant au bord de l’eau des empreintes de cerfs ou de tigres.
En dépit de ces moments de détente, nous ressentions tous amèrement l’absence de nos familles. La guerre était finie mais nous devions terminer nos séjours de vingt-sept mois. Les fêtes de Noël 54 ne furent pas très gaies .
Pour secouer mes idées noires, je me suis mis à imaginer le transfert de nos aventures au Grand Siècle. Ce qui donna ce récit : cliquez-là pour le voir
En Janvier 1956 la décision fut prise de retirer les forces françaises du Centre-Vietnam. Il y eut d’abord une série de mutations individuelles et c’est ainsi qu’en quelques jours je me suis retrouvé au Laos, Médecin-Chef d’une Antenne Chirurgicale implantée dans l’hôpital de Lang-Prabang.
Malgré l’état de guerre qui avait duré plus de dix années et les menées subversives du Pathet-Lao, le Laos était encore un pays charmant où nous avions l’impression de vivre sur un autre rythme. Tout était prétexte à des fêtes où nous étions gentiment conviés.
Des images reviennent pêle-mêle à ma mémoire : le Roi sur son éléphant, traversant la ville pour aller visiter les pagodes ; les bonzes tenant à la main un flambeau allumé et descendant, la nuit, les pentes du Phu-Si par un chemin en lacets rappelant symboliquement les ondulations du serpent qui avait, un jour en ce lieu, protégé de l’ardeur du soleil Bouddha pendant sa méditation ; le confluent du Mékong et de la Nam-Ou ; les routes de forêt ou de montagne ; les plantations de pavots avec leurs corolles d’un blanc éclatant marquées au centre d’une tache rouge-vif ; les villages méos sur les crêtes où les femmes portent de lourds colliers d’argent et où nous avons, un jour, rendu visite à un missionnaire français vivant là-haut avec sérénité dans des conditions d’isolement et d’inconfort à peine croyables.
Si ma famille avait pu me suivre, j’aurais sûrement été très heureux à Luang-Prabang. Malheureusement ce n’était pas le cas et la santé de mon fils aîné, Michel, qui souffrait d’une grave affection chronique, me tracassait beaucoup. J’aurais aussi voulu connaître ma nouvelle fille qui avait maintenant plus d’un an.
C’est pourquoi j’ai demandé à écourter mon séjour en Extrême-Orient. Ce qui me fut accordé .